La légende de Danko
Nous prononçons ce mot significatif - exploit, et après cela un autre mot devrait apparaître dans notre conscience - ascétique, car sans l'un il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'un exploit ? À quoi devrait ressembler la personne qui le fait ? Nous réfléchissons à ces questions en lisant la légende de Danko tirée du conte de M. Gorky « La vieille femme Izergil »
Les légendes sont connues depuis l'Antiquité. En les créant, les gens cherchaient à raconter de manière vivante et figurative des héros et des événements, à transmettre la sagesse et les rêves populaires. Danko est cet ascète qui a courageusement regardé la mort dans les yeux, sans pour autant chercher un gain personnel, il accomplit un acte altruiste au nom des gens.
La légende de Danko constitue la dernière partie de l’histoire de M. Gorki. Il est précédé de l'histoire de Larra et du récit de la vie de la vieille femme Izergil elle-même.
L'écrivain semble nous préparer, nous lecteurs, à la naissance de la légende de Danko à l'aide d'un paysage romantique, qui donne à l'histoire un mystère et une énigme particuliers : « A la place de la lune, il ne restait qu'une tache d'opale nuageuse , parfois elle était entièrement recouverte par une tache nuageuse bleuâtre. Et au loin de la steppe, désormais noire et terrible, comme cachée, cachant quelque chose en elle-même, de petites lumières bleues brillaient.
Le début de la légende ressemble à un conte de fées : « Autrefois, seuls des gens vivaient sur terre ; des forêts infranchissables entouraient les camps de ces gens sur trois côtés, et sur le quatrième il y avait la steppe. » Des motifs d’anxiété et de peur s’insinuent dans le récit.
Pour montrer dans quelle situation difficile les gens se trouvaient, M. Gorki crée une image inquiétante d'une forêt dense à travers laquelle les membres de la tribu sont obligés de se frayer un chemin, fuyant les ennemis : « ... les arbres de pierre se tenaient silencieux et immobiles pendant la jour dans le crépuscule gris et se déplaçait encore plus densément autour des gens le soir, lorsque les feux étaient allumés..."
L'auteur peint un paysage romantique inhabituel en utilisant des épithètes, des métaphores et des personnifications. Le vent frappe la cime des arbres, la forêt bourdonne « bêtement », le bruit de la forêt est comparé à un « chant funèbre ». Sur fond d'image sombre et terrible, une image lumineuse de Danko apparaît. C'est lui qui sera le sauveur, c'est lui qui conduira les gens hors des marécages et des forêts mortes. La vieille Izergil, racontant l'histoire, caractérise ainsi le héros romantique : « Danko fait partie de ces gens, un beau jeune homme. Les belles personnes sont toujours courageuses.
Les membres de la tribu croient Danko et le suivent : ils « ont vu qu'il était le meilleur de tous, car beaucoup de force et de feu vif brillaient dans ses yeux ». Mais les gens ne peuvent pas le suivre longtemps. Fatigués et épuisés, ils commencent à blâmer Danko pour tous les problèmes et sont prêts à le tuer. Mais il « aimait les gens et pensait qu’ils mourraient peut-être sans lui ».
Il fallait un miracle pour sauver les gens, et le héros a accompli ce miracle ! Ainsi arrive le point culminant du développement de l’action. Danko arrache son cœur de sa poitrine et l'utilise pour éclairer le chemin des gens. Le cœur du héros est représenté par M. Gorki à l'aide de divers moyens d'expression. La gradation (« Il brûlait aussi fort que le soleil et plus brillant que le soleil ») et les répétitions (« flamboyant », « brillant », « soleil », « illuminé ») ajoutent une émotivité particulière. Une sorte de périphrase - «le flambeau du grand amour pour les gens» - symbolise l'amour sacrificiel pour le prochain, la noblesse et le courage du héros.
Danko meurt. Sa mort a-t-elle été vaine ? Non, la mort du héros n’est pas vaine ! Il sauve toute une tribu de la mort. Et même si les gens se sont montrés ingrats, le désir de Danko de se sacrifier pour le bonheur de son peuple est déjà un exploit. Tout le monde n’est pas capable d’un acte courageux et altruiste. Mais le plus important est d’avoir de tels héros dans nos vies – des gens courageux, gentils et aimants.
Danko a tenu parole, il a sauvé le peuple, mais la tribu a oublié son sauveur, les gens « n'ont pas remarqué la mort et n'ont pas vu que le cœur courageux du héros national brûlait encore. Une seule personne prudente s'en aperçut et, craignant quelque chose, marcha du pied sur le cœur fier.
Dans l'histoire, l'auteur souligne également la fierté d'un autre héros, Larra, contrastant cette image avec celle de Danko. Larra, voulant tout avoir, ne voulait rien donner, pour lequel les gens lui ont proposé une terrible punition: une liberté illimitée. Larra nie les lois de la société, ses principes moraux. Il est fort, mais sa force ne fait pas de bien aux gens, sa liberté illimitée fait de lui un paria, un exilé. Danko est courageux, libre, c'est à propos de ces gens-là que, à la suite de M. Gorki, on peut dire : "Un homme – ça a l'air fier...". Danko est immortel, son immortalité est une récompense pour son exploit au nom du peuple. Contrairement à Larra, qui ressemble à une bête puissante qui n'a pas rencontré les gens « face à face », Danko aime énormément les gens, ceux qui « étaient comme des bêtes », « comme des loups ».
La philanthropie de Danko contraste avec l’image de la vieille femme Izergil elle-même. L'héroïne est égoïste, indifférente et cruelle : elle oublie facilement son ancien amour pour un nouveau, quitte les gens qu'elle aimait autrefois, ne vit que pour elle-même et est désormais vouée à la solitude. Malgré cela, c’est la vieille Izergil qui prononce la phrase clé : « Dans la vie, vous savez, il y a toujours de la place pour les exploits. » Et M. Gorki lui-même y croit, décrivant de magnifiques images de la nature entourant les héros.
L’image de Danko nous intéresse, nous les gens modernes. Les héros qui se sacrifient pour sauver les gens méritent certainement le respect. L'exploit de Danko rappelle l'exploit du mythique Prométhée, qui a volé le feu pour les gens et a lui-même subi un terrible châtiment pour cela.
À quoi devrait ressembler une vraie personne ? Les gens qui nous entourent méritent-ils toujours d’être aidés et soutenus ? Ont-ils besoin de sauveurs nobles et courageux ? La légende que j'ai lue sur Danko et toute l'histoire en général me fait réfléchir à ces questions et à d'autres sur l'essence de l'Homme, sur son but dans ce monde.
Option n° 18337
Lorsque vous effectuez des tâches avec une réponse courte, saisissez dans le champ de réponse le numéro qui correspond au numéro de la bonne réponse, ou un chiffre, un mot, une séquence de lettres (mots) ou des chiffres. La réponse doit être écrite sans espaces ni caractères supplémentaires. La réponse aux tâches 1 à 7 est un mot, une phrase ou une séquence de chiffres. Écrivez vos réponses sans espaces, virgules ou autres caractères supplémentaires. Pour les tâches 8 à 9, donnez une réponse cohérente en 5 à 10 phrases. Lors de l'exécution de la tâche 9, sélectionnez deux œuvres d'auteurs différents à comparer (dans l'un des exemples, il est permis de faire référence à l'œuvre de l'auteur propriétaire du texte source) ; indiquer les titres des œuvres et les noms des auteurs ; justifier votre choix et comparer les ouvrages avec le texte proposé dans un sens d'analyse donné.
Effectuer les tâches 10 à 14 consiste à utiliser un mot, une phrase ou une séquence de nombres. Lorsque vous effectuez la tâche 15-16, comptez sur la position de l'auteur et, si nécessaire, exprimez votre point de vue. Justifiez votre réponse en vous basant sur le texte de l'ouvrage. Lors de l'exécution de la tâche 16, sélectionnez deux œuvres d'auteurs différents à comparer (dans l'un des exemples, il est permis de faire référence à l'œuvre de l'auteur propriétaire du texte source) ; indiquer les titres des œuvres et les noms des auteurs ; justifier votre choix et comparer les ouvrages avec le texte proposé dans un sens d'analyse donné.
Pour la tâche 17, donner une réponse détaillée et motivée sous la forme d'un essai d'au moins 200 mots (un essai de moins de 150 mots obtient zéro point). Analyser une œuvre littéraire à partir de la position de l’auteur, en utilisant les concepts théoriques et littéraires nécessaires. Lorsque vous donnez une réponse, suivez les normes de discours.
Si l'option est spécifiée par l'enseignant, vous pouvez saisir ou télécharger des réponses aux tâches avec une réponse détaillée dans le système. L'enseignant verra les résultats de l'exécution des tâches avec une réponse courte et pourra évaluer les réponses téléchargées aux tâches avec une réponse longue. Les scores attribués par le professeur apparaîtront dans vos statistiques.
Dans l’histoire de M. Gorky « Vieille femme Izergil », l’indifférence et la réactivité s’opposent. L'indifférence envers les gens s'exprime à l'image du fils de l'aigle, Larra, un jeune homme fier et égocentrique qui veut rester complètement libre des gens et de leurs responsabilités. La réactivité s'exprime à l'image de Danko - c'est un héros courageux, fort et responsable qui a décidé de conduire les gens hors des forêts et des marécages et de leur montrer le chemin. Par conséquent, cet ouvrage est parfaitement adapté pour devenir un matériau littéraire servant d’argumentaire pour l’essai final.
- L'indifférence ne mène jamais une personne au bonheur. Par exemple, Larra, le fils d'un aigle, méprise les lois humaines et est indifférent aux sentiments humains qu'il ne ressent pas. Il ne respecte personne, tue une fille devant des gens de sa tribu, sans se rendre pleinement compte qu'il agit avec cruauté : il n'entend que lui-même et ses désirs. Mais pour cela, il est voué à la souffrance éternelle de la solitude. Il a été expulsé de la tribu et Dieu a « récompensé » le héros avec la vie éternelle afin qu'il connaisse l'abîme du désespoir pour son orgueil. Ainsi, le personnage malheureux est devenu un vagabond, aux yeux duquel il y avait toujours un désir que ni le temps ni l'espace ne pouvaient satisfaire.
- Malheureusement, les gens ne comprennent pas et n’apprécient pas toujours la réactivité. Par exemple, le noble Danko se sacrifie aux intérêts de la tribu, et son peuple reste indifférent à l'exploit et ne réalise pas son rôle dans leur salut. Sans le courageux jeune homme, ils ne s’en seraient jamais sortis. Même en route vers le but, les membres de la tribu ont commencé à condamner et à reprocher au chef de ne pas savoir où il les conduisait. Puis, dans un accès de philanthropie, il arracha le cœur enflammé de sa poitrine et, illuminant le chemin avec, il conduisit la foule vers la liberté, et il mourut lui-même. Et quelqu'un a même piétiné son cœur - dans cet acte, Gorki a dénoncé l'ingratitude noire de la société pour son attitude réactive envers elle-même.
- Dans la légende de Larra, les gens sont plus réactifs que dans la légende de Danko. Ils essaient de parler au tueur, de le comprendre, de lui expliquer les règles de la vie en société humaine. Mais le héros est leur antagoniste, il est insensible, indifférent et ne veut pas plonger dans l'essence des gens. Il les considère comme faibles et limités : où est leur liberté par rapport à sa permissivité ? Mais c’est précisément cette « limitation » qui élève la tribu au-dessus du fils de l’aigle. Les personnages n'osent pas ôter la vie à un criminel ; ils n'osent pas empiéter sur ce droit sacré, même si Larra a donné lieu à un châtiment cruel. La communauté l’a simplement envoyé en exil, et on ne peut imaginer une solution plus sage dans ce cas. Si les gens sont gouvernés par la réactivité, l’harmonie et la sagesse leur viennent, mais l’indifférence ne promet que destruction et cruauté.
- La capacité d’un individu à réagir n’est pas influencée par la société. Par exemple, à l'image de Larra et Danko, deux côtés opposés de la nature humaine s'expriment : l'indifférence et la réactivité. Dans la première légende, les images de personnes contiennent dans une certaine mesure les traits du réactif Danko, et dans la troisième légende, les traits de l'indifférent Larra. Les images des personnages secondaires contrastent avec les personnages principaux des deux légendes. C'est ainsi que l'auteur montre au lecteur que chaque personne contient simultanément les qualités de Larra et Danko, et qu'elles se manifesteront quelle que soit la manière dont l'environnement traite l'individu.
- L'indifférence conduit une personne à la solitude. Par exemple, la vieille femme Izergil de l’histoire du même nom de Gorki s’est livrée toute sa vie à des passe-temps frivoles, n’épargnant pas les sentiments de ses messieurs. Elle brisait souvent les cœurs et ne faisait que s'amuser dans cette démarche. Mais sa beauté et sa force ont été gaspillées, car elles n'étaient pas suffisantes pour le véritable amour. L'homme qu'elle a sauvé de la captivité, au risque de mourir, ne pouvait l'aimer que par gratitude, mais par fierté, elle n'a pas accepté l'aumône. En conséquence, la « beauté fatale » a vécu une vieillesse solitaire, parce que la jeunesse, le succès et les hommes l’avaient abandonnée. C'est à cela que conduit son indifférence à l'égard des sentiments des autres. Désormais, personne ne se souciait d'elle.
- La véritable réactivité est la philanthropie. Par exemple, Danko se sacrifie pour le bien du peuple, et seul un amour dévorant pour les gens pourrait lui permettre de pardonner les reproches et les rires d'une tribu lointaine. Lui, malgré le comportement ingrat de ses compatriotes et le manque de soutien, s'est dirigé vers le but et a mené la foule. N'importe qui à sa place aurait renoncé à un tel traitement. Cependant, le héros avait un soutien inébranlable pour sa réactivité - l'amour, qui força autrefois le Christ à monter au Golgotha. Intéressant? Enregistrez-le sur votre mur !
Partie 1.
Lisez le fragment du travail ci-dessous et effectuez les tâches 1 à 7 ; 8, 9.
« Vieille femme Izergil » A.M. Amer
J'ai entendu ces histoires près d'Akkerman, en Bessarabie, au bord de la mer.
Un soir, après avoir fini les vendanges de la journée, le groupe de Moldaves avec qui je travaillais se rendit au bord de la mer, et moi et la vieille Izergil restâmes sous l'ombre épaisse des vignes et, allongés sur le sol, restâmes silencieux, regardant comment les silhouettes de ces gens qui allaient à la mer.
Ils marchaient, chantaient et riaient ; les hommes - bronze, avec des moustaches noires luxuriantes et d'épaisses boucles jusqu'aux épaules, en vestes courtes et pantalons larges ; les femmes et les filles sont gaies, flexibles, avec des yeux bleu foncé, également bronze. Leurs cheveux, soyeux et noirs, étaient détachés, le vent, chaud et léger, jouait avec eux, faisant claquer les pièces qui y étaient tissées. Le vent soufflait en une vague large et régulière, mais parfois il semblait sauter par-dessus quelque chose d'invisible et, provoquant une forte rafale, soufflait les cheveux des femmes en crinières fantastiques qui s'enroulaient autour de leurs têtes. Cela rendait les femmes étranges et fabuleuses. Ils s'éloignaient de plus en plus de nous, et la nuit et la fantaisie les habillaient de plus en plus joliment.
Quelqu'un jouait du violon... la fille chantait d'une douce voix de contralto, on pouvait entendre des rires...
L'air était saturé de l'odeur âcre de la mer et des riches fumées de la terre, fortement humidifiées par la pluie peu avant le soir. Même maintenant, des fragments de nuages erraient dans le ciel, luxuriants, de formes et de couleurs étranges, ici - doux, comme des bouffées de fumée, gris et bleu cendré, là - nets, comme des fragments de roches, noirs mats ou bruns. Entre eux, des pans de ciel bleu foncé, décorés de points dorés d'étoiles, scintillaient tendrement. Tout cela - les sons et les odeurs, les nuages et les gens - était étrangement beau et triste, cela ressemblait au début d'un merveilleux conte de fées. Et tout semblait cesser de grandir, de mourir ; le bruit des voix s'éteignait, s'éloignait et dégénérait en tristes soupirs.
Pourquoi n'es-tu pas allé avec eux ? - Demanda la vieille femme Izergil en hochant la tête.
Le temps l'a pliée en deux, ses yeux autrefois noirs étaient ternes et larmoyants. Sa voix sèche semblait étrange, craquante, comme si la vieille femme parlait avec des os.
«Je ne veux pas», lui ai-je répondu.
Euh !., vous, les Russes, naîtrez vieux. Tout le monde est sombre, comme des démons... Nos filles ont peur de toi... Mais tu es jeune et fort...
La lune s'est levée. Son disque était grand, rouge sang, elle semblait sortir des profondeurs de cette steppe qui, au cours de sa vie, avait absorbé tant de chair humaine et bu du sang, ce qui explique probablement pourquoi elle est devenue si grasse et généreuse. Les ombres de dentelle des feuilles tombaient sur nous, et la vieille femme et moi en étions couvertes comme un filet. Au-dessus de la steppe, à notre gauche, flottaient les ombres des nuages, saturées de l'éclat bleu de la lune, elles devenaient plus transparentes et plus claires.
Lors de l'exécution des tâches 1 à 7, la réponse doit être donnée sous la forme d'un mot ou d'une combinaison de mots. Écrivez des mots sans espaces, sans signes de ponctuation ni guillemets.
1
Déterminez le genre de l’œuvre.
2
Quel terme est utilisé pour décrire la description de la nature : « L'air était saturé de l'odeur âcre de la mer et des vapeurs grasses de la terre, qui peu avant le soir avaient été fortement humidifiées par la pluie. Même maintenant, des fragments de nuages erraient dans le ciel, luxuriants, de formes et de couleurs étranges, ici - doux, comme des bouffées de fumée, gris et bleu cendré, là - pointus, comme des fragments de roches, noir mat ou marron ?
3
Le monde de la nature exotique du sud plonge le lecteur dans une atmosphère de mystère, de mystère et d'insolite. Quel type de pensée artistique se caractérise par de telles attitudes esthétiques ?
4
Établissez une correspondance entre les héros de l'œuvre et les qualités dominantes de leur personnalité : pour chaque position de la première colonne, sélectionnez la position correspondante dans la deuxième colonne.
Pour chaque position de la première colonne, sélectionnez la position correspondante dans la deuxième colonne.
Écrivez votre réponse en chiffres sans espaces ni autres symboles
5
Indiquez le dispositif artistique avec lequel l'auteur confère aux phénomènes naturels des propriétés et des qualités humaines (« ... elle semblait sortir des profondeurs de cette steppe, qui au cours de sa vie avait absorbé tant de chair humaine et bu du sang, ce qui est probablement pourquoi il est devenu si gras et généreux").
6
Quels moyens de représentation artistique sont utilisés dans ce fragment : « Tout le monde est sombre, comme des démons… » ?
7
L'un des moyens de caractériser les personnages est de représenter leur apparence : « les hommes sont de bronze, avec une moustache noire et luxuriante et d'épaisses boucles jusqu'aux épaules, en vestes courtes et en pantalons larges ; les femmes et les filles sont gaies, flexibles, avec des yeux bleu foncé, également bronze. Leurs cheveux, soyeux et noirs, étaient dénoués, le vent, chaud et léger, jouait avec eux, faisant vibrer les pièces qui y étaient tissées. Comment s’appelle cette description ?
Niveau de difficulté accru
Partie 2.
Lisez le travail ci-dessous et effectuez les tâches 10 à 14 ; 15, 16.
« Chuchotement, respiration timide… » A.A. Fet
Chuchotement, respiration timide.
Le trille d'un rossignol,
Argent et influence
Ruisseau endormi,
Veilleuse, ombres nocturnes,
Des ombres sans fin
Une série de changements magiques
Doux visage
Il y a des roses violettes dans les nuages enfumés,
Reflet ambré
Et des baisers et des larmes,
Et l'aube, l'aube !..
La réponse aux tâches 10 à 14 est un mot ou une phrase, ou une séquence de nombres. Entrez vos réponses sans espaces, virgules ou autres caractères supplémentaires.
10
Quel terme est utilisé pour désigner dans la critique littéraire le début narratif le plus affaibli des paroles de A. A. Fet, lorsque les noms prédominants dans le texte nomment les vives impressions visuelles et auditives du héros et traduisent son état tendu et jubilatoire ?
11
Nommez le numéro de ligne dans lequel le pick-up apparaît - la répétition d'un mot, d'une phrase, d'une ligne poétique au début du segment de discours correspondant qui le suit.
12
Indiquez le nom du phénomène stylistique caractéristique du style artistique de A. A. Fet et caractérisé par une approche particulière pour représenter un sentiment, le transmettre par l'expression de la couleur et de la lumière et reproduire « l'impression » d'un objet.
13
Dans la liste ci-dessous, sélectionnez trois noms de moyens et techniques artistiques utilisés par le poète dans les quatre derniers vers de ce poème. Notez les numéros sous lesquels ils sont indiqués.
2) gradation
3) épiphore
4) métaphore
14
Déterminez la méthode de rime.
Lorsque vous réfléchissez à une question sur un sujet donné, utilisez des documents de référence et l'appareil conceptuel de la critique littéraire. Imaginez le terme que vous utiliserez pour caractériser la notion de « paysage ».
Analysez le fragment qui vous est proposé du point de vue de ses caractéristiques typologiques. Montrer que le paysage est en harmonie avec le ton insolite et fantastique de la légende. A noter que les images de la nature sont créées sur la base du contraste (le sublime y prime sur l'ordinaire, le poétique sur le prosaïque, etc.). Insistez sur le fait que la nature - lumineuse, exotique, inhabituelle, pleine de pouvoir élémentaire - agit comme un être mystérieux et spirituel. Assurez-vous que le paysage soit largement conditionnel, généralisé et que le miraculeux et le fantastique s'y actualisent. Montrez que les lignes, les formes et les couleurs de l’image créée de la nature créent un fond émotionnel expressif.
Concluez qu'il s'agit d'un paysage romantique. Les moyens d'expression artistique (métaphores, comparaisons, épithètes, animation d'éléments naturels, etc.) servent de moyen de créer un paysage avec une attitude évaluative franchement exprimée de l'écrivain à son égard.
Lors de la formation d'un concept de jugement sur le sujet proposé, montrez que les origines littéraires de l'image des hydronymes sont enracinées dans la littérature russe ancienne.
Rappelez-vous que les rivières dans « Le Conte de la campagne d’Igor » apparaissent comme des espaces géographiques réels et conditionnellement mythologiques. Notez que l’élément eau fait partie du paysage dans « Le Cavalier de bronze » de A. S. Pouchkine. Montrez que la fin du premier rendez-vous amoureux entre Gurov et Anna Sergueïevna est un voyage à Oreanda, où les héros contemplent le magnifique paysage marin (« La Dame au chien » d'A.P. Tchekhov). Souvenez-vous du roman "Guerre et Paix" de L.N. Tolstoï et soyez convaincu de la grande importance fonctionnelle des plans d'eau représentés dans cette œuvre (traversée de l'Enns, traversée du Neman). Donnez d'autres exemples.
En résumant vos observations, notez que l'inclusion de plans d'eau dans le paysage permet à l'écrivain de montrer que l'homme est organiquement intégré au monde naturel, il est soumis à la fois au cycle quotidien et au mouvement éternel du monde. Le paysage aquatique devient un moyen de symboliser l’espace et le temps et reflète les processus qui se déroulent dans l’âme du personnage.
Au début de la tâche, clarifiez le sens du terme « émotion ». Pour ce faire, référez-vous à la littérature de référence et montrez que « émotion » est définie à l'aide des mots « sentiment et expérience » : « expérience mentale, excitation », « sentiment émotionnel fort, expérience ». Montrez que les sentiments peuvent avoir un ton émotionnel positif et négatif (joie - tristesse), un groupe spécial est formé de sentiments supérieurs - moraux, esthétiques, intellectuels. Insistez sur le fait que les paroles de A. A. Fet sont avant tout des paroles d'amour et de nature, c'est pourquoi les noms d'émotions sont le plus souvent utilisés pour décrire le monde intérieur de l'homme et le monde naturel, qui sont étroitement liés les uns aux autres.
Notez que le fond émotionnel du poème « Chuchotement, respiration timide… » est créé par une combinaison d’émotions, de sentiments et d’humeurs positifs. Analysez le texte et assurez-vous que l’émotion fondamentale qu’il contient est l’amour. Montrez la structure complexe du fond émotionnel. N'oubliez pas que dans les paroles de A. A. Fet, le sentiment amoureux a des manifestations physiologiques. Imaginer la gradation des émotions, caractériser leurs manifestations physiologiques (chuchotements, baisers, larmes). Notez la signification émotionnelle, l’inclusivité (« Et l’aube, l’aube !.. »).
Complétez vos observations par une conclusion sur la haute signification esthétique du fond émotionnel créé dans le poème.
Afin de réussir à construire un énoncé cohérent sur un sujet donné, utilisez l’appareil conceptuel de la critique littéraire. Rappelez-vous l'opinion scientifique actuelle selon laquelle A. A. Fet est l'un des premiers impressionnistes de la poésie russe.
Décrire l'originalité de la vision impressionniste du monde (un état de conscience particulier, une réaction intuitive au monde qui nous entoure, la priorité des sensations, la capacité de transmettre des états transitionnels de la nature et des nuances de mouvements mentaux, la capacité d'enregistrer des mouvements éphémères impressions, etc).
A noter ensuite qu'une telle vision du monde (psychologisme exacerbé, intuitivité, associativité, métaphore, suggestivité, musicalité, etc.) n'est pas caractéristique seulement de l'œuvre de A. A. Fet. Une vision impressionniste profondément individuelle du monde est caractéristique des poètes K.D. Balmont, I.F. Annensky, A. A. Blok, A. Bely, V. Ya.
Notez qu'en prose, A. P. Chekhov, I. A. Bunin, B. K. Zaitsev et d'autres se sont tournés vers l'impressionnisme.
En résumant vos observations, tirez une conclusion sur le point commun des principes esthétiques de A. A. Fet et des écrivains répertoriés.
Avant de commencer à formuler le concept de l'essai, rappelez-vous que l'opposition « l'homme et le monde » est la principale dans les paroles de M. Yu. Lermontov et que la solitude est une caractéristique constante du héros lyrique.
Analysez le poème « Combien de fois, entouré d'une foule hétéroclite… ». Montrer que le rapport du poète au monde se révèle chez lui à travers le conflit interne du héros avec la société. Notons que la résolution de ce conflit est possible soit sous la forme d’une évasion salvatrice dans le domaine des souvenirs, des rêves, des « sons sacrés », soit par un appel à la créativité poétique, au « vers de fer ». Nommer les principaux centres sémantiques et spatiaux de l'œuvre (images d'une mascarade et d'une maison). Insister sur la relation entre les principes satiriques et élégiaques, qui correspondent à différentes facettes de l’apparence du héros lyrique.
Montrer l'originalité idéologique et artistique du poème « Douma ». Assurez-vous que la base de ce travail est l'image de l'image de l'époque et du héros de l'époque. Notez que le drame de l'existence de l'homme moderne dans le monde se manifeste dans le décalage entre les paroles et les actes, dans la combinaison du « fardeau de la connaissance » avec l'inaction.
Observez quel contenu le thème « homme - monde » reçoit dans le poème « Nuages ». Montrez qu’il esquisse deux manières possibles pour une personne de « rester » dans le monde : l’errance et l’exil. Ils supposent deux modèles de comportement personnel d'une personne : une rupture consciente avec le monde, laissant comme opportunité d'acquérir un « je » supérieur ou une implication organique dans la vie du pays, de la nature et des autres personnes dont une personne est forcée arraché.
Reportez-vous au contenu du poème « Je sors seul sur la route… », dont le héros lyrique se sent agité et sans abri dans le monde. Décrivez les spécificités d'un autre chemin - le « départ » vers l'oubli, dans lequel le héros lyrique voudrait préserver l'originalité unique de sa propre personnalité, de ses idéaux.
En conclusion, notons que la discorde dans la relation entre l'homme et le monde dans les paroles de M. Yu Lermontov est due aux particularités de la vision du monde de l'artiste et aux spécificités de l'époque dans laquelle le poète a vécu.
Lorsque vous commencez à répondre à la question, souvenez-vous de l'évaluation de l'auteur donnée dans une lettre à O. L. Knipper-Chekhova : « C'est le meilleur rôle... » Montrez pourquoi un personnage épisodique à sa place dans la liste des personnages acquiert une importance extraordinaire pour l'auteur. Identifiez comment la signification scénique de cette image est soulignée. A noter que chacune des rares apparitions de Charlotte est accompagnée d'un commentaire détaillé (apparition, actions, etc.), toutes ses remarques et actions semblent inattendues et non motivées par la logique extérieure d'une situation particulière, etc. Faites une conclusion intermédiaire sur l'attention portée par l'auteur à ce personnage.
Expliquez ensuite comment se crée l’effet de mystère sémantique et artistique de l’image de Charlotte. A noter que ce personnage se caractérise par un « flou » absolu des signes individuels : âge inconnu (« Je n'ai pas de vrai passeport, je ne sais pas quel âge j'ai, et il me semble encore que je suis jeune »); nationalité inconnue (« Et quand mon père et ma mère sont morts, une dame allemande m'a accueilli et a commencé à m'enseigner ») ; on ne sait rien de l'origine et de l'arbre généalogique (« Qui sont mes parents, peut-être qu'ils ne se sont pas mariés... je ne sais pas »).
Considérons un autre détail du concept artistique du personnage : les vêtements de Charlotte contiennent des attributs masculins et féminins (« dans une robe blanche » - « dans une vieille casquette... elle a enlevé le pistolet de ses épaules et a ajusté sa boucle de ceinture »), et son nom combine des composantes européennes et russes (Charlotte Ivanovna).
Établir que le métier de Charlotte s'avère aléatoire et inutile, la solitude parmi les autres atteint l'extrême (« J'ai vraiment envie de parler, mais il n'y a personne à qui parler... Je n'ai personne »). La liberté absolue par rapport aux conventions imposées à une personne par la société subordonne son comportement uniquement à ses propres impulsions internes.
En résumant vos observations, soyez d'accord avec l'opinion du chercheur. En créant l'effet de « mystère », l'auteur concentre l'attention du lecteur et du spectateur sur l'image de Charlotte et initie le désir du lecteur de comprendre l'essence de cette image, impliquant ainsi à la fois le lecteur et le spectateur dans le processus de « co-création ». .»
En réfléchissant au concept de l'essai, rappelez-vous dans quelles œuvres de V. P. Astafiev ont été créées de belles images féminines qui incarnent le principe maternel (« Dernier arc », « Poisson tsar », « Berger et bergère », « Chute d'étoiles », « Ode à le potager russe » et etc.).
Imaginez le type « grand-mère » et montrez sa signification idéologique et esthétique. Pour ce faire, analysez l'image de Katerina Petrovna (« Dernier arc », « Ode au jardin russe »). Montrer son lien avec la tradition folklorique, son indissociabilité du monde naturel et sa place dans le monde populaire (dans le village on l'appelait respectueusement « générale », elle est la « matriarche », « mère » du village). La grand-mère Katerina Petrovna a remplacé la mère de l'orphelin, lui a donné un abri, de la nourriture et son amour. Expliquez pourquoi l'écrivain la représente le plus souvent en train de tourner ou de prier (lien avec des forces païennes et chrétiennes supérieures dans leur interpénétration complexe).
Notons que ce type de « grand-mère » avec ses fonctions caractéristiques d'infirmière, de guérisseuse et de mentor se reflète dans d'autres héroïnes : dans Afimya Mozglyachikha, « la sorcière et mère de tous les habitants locaux, tant par leur âge que par leur caractère », dans l'épouse sans nom du capitaine Paramon Paramonovich, dont Akim adopte l'art de guérir avec des herbes (« Poisson tsar »), chez la grand-mère Sekletinya d'un village éloigné de vieux croyants (« Maudit et tué »).
Montrez ensuite quelle place importante occupe l'image de la mère dans l'œuvre de V.P. Astafiev. A noter que l'image de Lydia Ilyinichna (« Ode au potager russe ») est dotée d'une « désincarnation » particulière (le héros autobiographique ne se souvient pas de sa mère, elle n'apparaît que dans les rêves, les rêveries, les souvenirs, et cela donne lieu à un ton particulier, nostalgique et triste). Expliquez que les principales caractéristiques de cette image (travail acharné, soins aux enfants - les siens et ceux des autres, compassion) ont constitué la base d'un certain nombre d'autres héroïnes - « ouvrières paysannes » (ses sœurs et belles-filles de Potylitsyn famille, grand-mère Maria de Sisima, juste Parunya, sœur Akima Kasyanka). Montrez ce qui unit d'autre ces femmes (un sort difficile, plein de pertes et de privations). Décrivez le type féminin, qui allie sagesse maternelle et innocence, l'ouverture de « l'enfance » (Lida de l'histoire « Starfall », Lucy de « Le berger et la bergère »).
Montrer le sens de l'image de la mère espiègle, naïve et joyeuse d'Akim, qui « était et reste une adolescente d'esprit et de cœur » (« King Fish »). A noter qu'elle incarne l'élément même de la maternité : l'héroïne vit en harmonie. avec la nature, devrait l'appel et la loi éternelle de la continuation de la vie. Rappelons que l'auteur la compare, nourrissant un enfant, à un arbre qui donne de la sève et de la vie à une petite pousse.
En conclusion, nous sommes d’accord avec l’opinion du chercheur selon laquelle les héroïnes de V.P. Astafiev sont l’incarnation du sacrifice, de la compassion et des gardiennes de la vie sur terre.


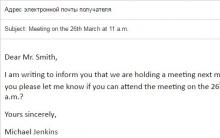








Onction - un sacrement qui guérit l'âme et le corps
Patriarche Nikon. Courte biographie. Patriarche de Moscou et de toute la Russie. Nikon Église Nikon
Qu’est-ce que le reporting consolidé ?
Contrôle légal des comptes - motifs de réalisation d'un contrôle
Que peut-on cuisiner avec du poulet ?