Niveaux empiriques et théoriques, critères pour les distinguer (ici - la structure du savoir scientifique ou du savoir).
Les méthodes de la connaissance scientifique comprennent celles qui sont utilisées dans la recherche empirique et théorique.
Pour comprendre la place et le rôle des différentes méthodes dans la recherche scientifique, il faut considérer la structure de la connaissance scientifique, qui se compose de deux niveaux - empirique et théorique. L'empirique est l'accumulation de faits et d'informations sur les objets étudiés, le théorique est la synthèse des connaissances acquises sous forme d'hypothèses, de théories, d'idées. Selon les niveaux de connaissances, les méthodes sont divisées en deux groupes :
Méthodes de recherche empirique - observation, expérimentation, comparaison.
Méthodes de connaissance théorique - analyse et synthèse, induction et déduction, idéalisation, axiomatique, etc.
La recherche empirique et théorique est étroitement liée - la première est basée sur la collecte de matériel empirique qui s'accumule au cours d'observations et d'expériences, et la seconde est effectuée afin de confirmer ou de tester toute hypothèse.
Les études empiriques et théoriques diffèrent par la profondeur de pénétration dans l'essence du sujet. Si les premiers sont associés à l'étude du côté externe du sujet, alors les seconds - à l'étude de ses propriétés internes et de ses connexions. Nous pouvons dire que si l'essence du premier ordre est comprise au niveau empirique, alors au niveau théorique - l'essence du deuxième, du troisième, etc. ordre.
Le but principal de la connaissance empirique est d'obtenir des faits.
La distinction entre ces deux niveaux de connaissances scientifiques ne s'est pas faite immédiatement. Cette division apparaît plus clairement dans le positivisme, qui reconnaît le statut de science, associé uniquement à ce savoir empiriquement vérifié. On peut noter qu'avant même le positivisme, la philosophie empirique de F. Bacon est apparue (l'idée principale : la connaissance commence par l'expérience, dans les expériences expérimentales un chercheur scientifique obtient la connaissance, puis la connaissance est généralisée, et la connaissance généralisée est obtenue).
La division des niveaux empirique et théorique peut être faite en fonction des particularités de la cognition humaine : le niveau sensoriel et rationnel (cependant, le niveau empirique ne peut pas être associé au sensuel, et le théorique - au rationnel, car ce sont des concepts différents ). Les principales méthodes de connaissance empirique sont l'observation et l'expérimentation. Il existe de nombreuses méthodes de connaissance théorique, telles que : l'abstraction, l'idéalisation, la formalisation, etc. Il existe des méthodes de connaissances empiriques et théoriques, telles que : l'analyse, la synthèse, l'induction, la déduction.
Le principal type de connaissance obtenu au niveau empirique de la recherche scientifique est le fait et le droit expérimental. La théorie est principalement liée à la connaissance du niveau théorique. Au niveau empirique, la connaissance scientifique traite des propriétés individuelles d'un objet, données dans l'expérience. La généralisation inductive des données recueillies est présentée sous la forme de modèles établis expérimentalement. Le niveau théorique des connaissances scientifiques se distingue par l'accent mis sur la découverte des caractéristiques générales régulières d'un objet, identifiées à l'aide de procédures rationnelles. Au niveau théorique, des lois théoriques sont formulées.
Dans la connaissance scientifique, un fait est compris soit comme une connaissance fiable, soit comme une connaissance exprimée dans le langage de description de données empiriques. La science ne traite jamais de faits « purs ». Les informations recueillies par les méthodes de recherche empiriques nécessitent une interprétation, qui est toujours basée sur certaines prémisses théoriques. Tout fait n'a de sens que dans le cadre d'une certaine théorie. Ainsi, la distinction entre niveau empirique et niveau théorique n'est pas absolue. La connaissance scientifique comprend nécessairement à la fois un niveau empirique et un niveau théorique de recherche. Au niveau empirique, la connexion des connaissances scientifiques avec la réalité et avec l'activité pratique d'une personne est fournie. Le niveau théorique est l'élaboration d'un modèle conceptuel de l'objet de la connaissance.
Sortir. Différence entre le niveau empirique et théorique :
1) un rapport différent du sensible et du rationnel (au niveau empirique, l'élément du sensuel l'emporte sur le rationnel, au niveau théorique, vice versa) ;
2) différentes méthodes de recherche ;
3) la principale forme de connaissance scientifique obtenue (au niveau empirique - un fait scientifique ; au niveau théorique - la théorie).
Niveaux empiriques et théoriques des connaissances scientifiques, critères de leur différence
Il existe deux niveaux de connaissances scientifiques - empirique et théorique. (On pourrait dire aussi - recherche empirique et théorique.)
Le niveau empirique des connaissances scientifiques comprend l'observation, l'expérimentation, le regroupement, la classification et la description des résultats d'observation et d'expérimentation, la modélisation.
Le niveau théorique des connaissances scientifiques comprend l'avancement, la construction et le développement d'hypothèses et de théories scientifiques ; formulation de lois; dérivation des conséquences logiques des lois; comparaison de diverses hypothèses et théories entre elles, modélisation théorique, ainsi que procédures d'explication, de prédiction et de généralisation.
Corrélation des niveaux empiriques et théoriques des connaissances scientifiques avec les connaissances sensorielles et rationnelles
L'affirmation selon laquelle le rôle et la signification de la cognition empirique sont déterminés par sa connexion avec le stade sensoriel de la cognition est devenue presque triviale. Cependant, la connaissance empirique n'est pas seulement sensorielle. Si nous corrigeons simplement les lectures de l'appareil et obtenons la déclaration "la flèche est sur la division d'échelle 744", alors ce ne sera pas encore une connaissance scientifique. Une telle affirmation ne devient une connaissance (fait) scientifique que lorsque nous la corrélons avec les concepts correspondants, par exemple, avec la pression, la force ou la masse (et les unités de mesure correspondantes : mm de mercure, kg de masse).
De même, on ne peut pas dire du niveau théorique du savoir scientifique que le savoir qu'il délivre est « pure rationalité ». En proposant une hypothèse, en développant une théorie, en formulant des lois et en comparant des théories entre elles, on utilise des représentations visuelles ("modèles"), qui appartiennent au stade sensoriel de la cognition.
En général, on peut dire qu'aux niveaux inférieurs de la recherche empirique, les formes de cognition sensorielle prévalent, et aux niveaux supérieurs de la recherche théorique, les formes de cognition rationnelle prévalent.
Différences entre les niveaux empiriques et théoriques des connaissances scientifiques
1. Les niveaux considérés varient selon la matière. Un chercheur aux deux niveaux peut étudier le même objet, mais la « vision » de cet objet et sa représentation dans la connaissance de l'un de ces niveaux et de l'autre ne seront pas les mêmes.
La recherche empirique vise essentiellement à étudier les phénomènes et les relations (empiriques) entre eux. Ici, les connexions essentielles, plus profondes, ne sont pas encore distinguées dans leur forme pure : elles se présentent dans les connexions entre les phénomènes enregistrés dans l'acte empirique de la cognition.
Au niveau théorique, il existe une sélection de relations essentielles qui déterminent les principales caractéristiques et tendances du développement du sujet. Nous imaginons l'essence de l'objet étudié comme l'interaction d'un certain ensemble de lois découvertes et formulées par nous. Le but de la théorie est que, après avoir d'abord démembré cet ensemble de lois et les avoir étudiées séparément, recréer ensuite leur interaction par synthèse et révéler ainsi l'essence (supposée) du sujet à l'étude.
2. Les niveaux empiriques et théoriques de la connaissance scientifique diffèrent par les moyens de connaissance. La recherche empirique est basée sur l'interaction directe du chercheur avec l'objet à l'étude. La recherche théorique, d'une manière générale, n'implique pas une interaction aussi directe du chercheur avec l'objet : ici elle peut être étudiée d'une manière ou d'une autre indirectement, et si c'est une expérience, c'est une « expérience de pensée », c'est-à-dire modélisation idéale.
Les niveaux de connaissances scientifiques diffèrent également par les moyens conceptuels et le langage. Le contenu des termes empiriques est un type particulier d'abstraction - les "objets empiriques". Ce ne sont pas des objets de la réalité étudiée (ou « donnée ») : les objets réels apparaissent comme idéaux, dotés d'un ensemble fixe et limité de propriétés (attributs). Chaque caractéristique qui est présentée dans le contenu du terme désignant un objet empirique est également présente dans le contenu du terme désignant un objet réel, mais pas l'inverse. Les phrases du langage de la description empirique — on peut les appeler des énoncés empiriques — se prêtent à une vérification concrète et directe dans le sens suivant. Une déclaration comme "l'aiguille du dynamomètre s'est installée autour d'une division d'échelle de 100" est vraie si la lecture de l'appareil nommé est vraiment comme ça. Quant aux énoncés théoriques, c'est-à-dire aux phrases que nous utilisons dans les calculs théoriques, en règle générale, ils ne sont pas directement vérifiés de la manière décrite ci-dessus. Ils sont comparés aux résultats d'observations et d'expériences non pas isolément, mais conjointement - dans le cadre d'une certaine théorie. Dans le langage de la recherche théorique, on utilise des termes dont le contenu est constitué par les caractéristiques des «objets idéaux théoriques». Par exemple : « point matériel », « corps absolument solide », « gaz idéal », « charge ponctuelle » (en physique), « population idéalisée » (en biologie), « produit idéal » (en théorie économique, dans la formule « le produit est de l'argent - produit"). Ces objets théoriques idéalisés sont dotés non seulement de propriétés que l'on retrouve dans la réalité, dans l'expérience, mais aussi de propriétés qu'aucun objet réel n'a.
3. Les niveaux empiriques et théoriques des connaissances scientifiques diffèrent par la nature des méthodes utilisées. Les méthodes de la cognition empirique visent la caractéristique objective de l'objet étudié, aussi dégagée que possible des strates subjectives. Et dans l'étude théorique de la fantaisie et de l'imagination du sujet, de ses capacités particulières et du «profil» de ses connaissances personnelles, la liberté est donnée, bien que tout à fait concrète, c'est-à-dire limitée.
La science moderne est organisée disciplinairement. Il se compose de divers domaines de connaissances, interagissant les uns avec les autres et ayant en même temps une relative indépendance. Si nous considérons la science dans son ensemble, elle appartient alors au type de systèmes complexes en développement qui, dans leur développement, génèrent de plus en plus de nouveaux sous-systèmes relativement autonomes et de nouvelles connexions intégratives qui contrôlent leur interaction. Dans la structure de la connaissance scientifique, tout d'abord, deux niveaux de connaissance - empirique et théorique... Ils correspondent à deux types d'activités cognitives interdépendantes mais en même temps spécifiques : la recherche empirique et la recherche théorique.
De plus, les niveaux de connaissances scientifiques indiqués ne sont pas identiques aux formes de connaissances sensorielles et rationnelles en général. la connaissance empirique ne peut jamais être réduite à la pure sensibilité. Même la couche primaire de connaissances empiriques - les données d'observation - est toujours fixée dans un langage spécifique : de plus, c'est un langage qui utilise non seulement des concepts de tous les jours, mais aussi des termes scientifiques spécifiques. Mais les connaissances empiriques ne se limitent pas aux données d'observation. Elle présuppose également la formation à partir de données d'observation d'un type particulier de connaissance - un fait scientifique. Un fait scientifique résulte d'un traitement rationnel très complexe des données d'observation : leur compréhension, leur compréhension, leur interprétation. En ce sens, tous les faits scientifiques représentent l'interaction du sensible et du rationnel. Les formes de cognition rationnelle (concepts, jugements, inférences) dominent dans le processus d'assimilation théorique de la réalité. Mais lors de la construction d'une théorie, on utilise aussi des représentations de modèles visuels, qui sont des formes de cognition sensorielle, car les représentations, comme la perception, sont liées à des formes de contemplation vivante.
La distinction entre niveaux empiriques et théoriques doit être effectuée en tenant compte des spécificités de l'activité cognitive à chacun de ces niveaux. Selon l'académicien I.T. Frolov, les principaux critères par lesquels ces niveaux diffèrent sont les suivants : 1) la nature du sujet de recherche, 2) le type d'outils de recherche utilisés, et 3) les caractéristiques de la méthode.
Différences par sujet consistent dans le fait que la recherche empirique et théorique peuvent connaître la même réalité objective, mais sa vision, sa représentation dans la connaissance seront données de différentes manières. La recherche empirique est essentiellement centrée sur l'étude des phénomènes et des relations entre eux. Au niveau des connaissances théoriques, les maillons essentiels sont distingués dans leur forme pure. L'essence d'un objet est l'interaction d'un certain nombre de lois qui régissent l'objet. La tâche de la théorie est précisément de recréer toutes ces relations entre les lois et de révéler ainsi l'essence de l'objet.
Différences dans le type de moyens utilisés la recherche consiste dans le fait que la recherche empirique est basée sur l'interaction pratique directe du chercheur avec l'objet à l'étude. Elle passe par l'observation et l'expérimentation. Par conséquent, les moyens de la recherche empirique doivent inclure des instruments, des installations instrumentales et d'autres moyens d'observation et d'expérimentation réelles. Dans la recherche théorique, il n'y a pas d'interaction pratique directe avec les objets. A ce niveau, un objet ne peut être étudié qu'indirectement, dans une expérience de pensée, mais pas dans une vraie.
Selon leurs caractéristiques, les types empiriques et théoriques de la cognition à différer méthodes de recherche... Comme déjà mentionné, les principales méthodes de recherche empirique sont l'expérimentation réelle et l'observation réelle. Un rôle important est également joué par les méthodes de description empirique, centrées sur la caractéristique objective des phénomènes étudiés, qui est au maximum débarrassée des couches subjectives. Comme pour la recherche théorique, des méthodes particulières sont utilisées ici : l'idéalisation (méthode de construction d'un objet idéalisé) ; une expérience de pensée avec des objets idéalisés, qui, pour ainsi dire, remplace une expérience réelle avec des objets réels ; méthodes de construction de la théorie (montée de l'abstrait aux méthodes concrètes, axiomatiques et hypothético-déductives) ; méthodes de recherche logique et historique, etc. Ainsi, les niveaux de connaissances empiriques et théoriques diffèrent dans le sujet, les moyens et les méthodes de recherche. Cependant, la sélection et la considération indépendante de chacun d'eux est une abstraction. En réalité, ces deux couches de connaissances interagissent toujours. L'affectation des catégories « empirique » et « théorique » comme moyen d'analyse méthodologique permet de savoir comment fonctionne et se développe la connaissance scientifique.
Le niveau empirique des connaissances scientifiques se caractérise par deux méthodes principales : l'observation et l'expérimentation.
L'observation est la méthode originale de la cognition empirique. L'observation est une étude intentionnelle, délibérée et organisée de l'objet à l'étude, dans laquelle l'observateur n'interfère pas avec cet objet. Il repose principalement sur des capacités sensorielles humaines telles que la sensation, la perception, la représentation. Au cours de l'observation, nous acquérons des connaissances sur les aspects extérieurs, les propriétés, les signes de l'objet étudié, qui doivent être fixés d'une certaine manière au moyen du langage (naturel et (ou) artificiel), des schémas, des diagrammes, des nombres, etc. Les composants structurels de l'observation comprennent : un observateur, un objet d'observation, les conditions et les moyens d'observation (y compris les appareils, les instruments de mesure). Cependant, l'observation peut avoir lieu sans instruments. L'observation est essentielle à la cognition, mais elle a ses inconvénients. Premièrement, les capacités cognitives de nos sens, même renforcées par des appareils, sont encore limitées. En observant, on ne peut pas changer l'objet étudié, intervenir activement dans son existence et dans les conditions du processus de cognition. (Notez entre parenthèses que l'activité d'un chercheur est parfois soit inutile - de peur de déformer la réalité, soit tout simplement impossible - en raison de l'inaccessibilité de l'objet par exemple, ou pour des raisons morales). Deuxièmement, en observant, nous n'avons d'idées que sur le phénomène, uniquement sur les propriétés de l'objet, mais pas sur son essence.
L'observation scientifique est, par essence, contemplation, mais contemplation active. Pourquoi actif ? Parce que l'observateur non seulement fixe mécaniquement les faits, mais les recherche délibérément, en s'appuyant sur les diverses expériences, hypothèses, hypothèses, théories déjà existantes. L'observation scientifique est réalisée avec une certaine chaîne, dirigée vers certains objets, implique le choix de certaines méthodes et dispositifs, se caractérise par la systématicité, la fiabilité des résultats obtenus et le contrôle de l'exactitude.
D'autre part, la deuxième méthode principale de connaissance scientifique empirique se distingue par une nature activement transformatrice. Par rapport à l'expérimentation, l'observation est un mode de recherche passif. Une expérience est une méthode active et ciblée d'étude de phénomènes dans certaines conditions de leur déroulement, qui peut être systématiquement recréée, modifiée et contrôlée par le chercheur lui-même. C'est-à-dire que la particularité de l'expérience est que le chercheur interfère activement et systématiquement avec les conditions de la recherche scientifique, ce qui permet de reproduire artificiellement les phénomènes étudiés. L'expérience permet d'isoler le phénomène étudié des autres phénomènes, de l'étudier, pour ainsi dire, sous « forme pure », selon un objectif prédéterminé. Dans des conditions expérimentales, vous pouvez découvrir des propriétés qui ne peuvent pas être observées dans des conditions naturelles. L'expérience implique l'utilisation d'un arsenal encore plus important de dispositifs spéciaux, d'instruments d'installations, plutôt que d'observation.
Les expériences peuvent être classées en :
Ø les expériences sont directes et modélisées, les premières sont réalisées directement sur l'objet, et les secondes - sur le modèle, c'est-à-dire sur son objet "proxy", puis extrapolé à l'objet lui-même ;
Ø des expériences sur le terrain et en laboratoire, différant les unes des autres par l'emplacement ;
Ø des expériences de recherche, non liées à des versions déjà avancées, et des expériences de test, visant à vérifier, confirmer ou infirmer une hypothèse spécifique ;
Ø des expériences de mesure destinées à révéler les relations quantitatives exactes entre les objets qui nous intéressent, les côtés et les propriétés de chacun d'eux.
Une expérience de pensée est un type particulier d'expérience. Dans celui-ci, les conditions d'étude des phénomènes sont imaginaires, le scientifique opère avec des images sensorielles, des modèles théoriques, mais l'imagination du scientifique obéit aux lois de la science et de la logique. L'expérience de pensée renvoie plutôt au niveau théorique de la connaissance qu'au niveau empirique.
La conduite directe d'une expérimentation est précédée de sa planification (choix d'un objectif, d'un type d'expérimentation, réflexion sur ses résultats possibles, compréhension des facteurs qui affectent ce phénomène, détermination des grandeurs à mesurer). De plus, il est nécessaire de choisir les moyens techniques de conduite et de contrôle de l'expérience. Une attention particulière doit être portée à la qualité des instruments de mesure. L'utilisation de ces instruments de mesure particuliers doit être justifiée. Après l'expérience, les résultats sont analysés statistiquement et théoriquement.
La comparaison et la mesure peuvent également être référées aux méthodes du niveau empirique de la connaissance scientifique. La comparaison est une opération cognitive qui révèle la similitude ou la différence d'objets (ou les étapes de leur développement). La mesure est le processus consistant à déterminer le rapport d'une caractéristique quantitative d'un objet à une autre, homogène avec elle et prise comme unité de mesure.
Le résultat de la connaissance empirique (ou une forme de niveau de connaissance empirique) sont des faits scientifiques. La connaissance empirique est un ensemble de faits scientifiques qui forment la base de la connaissance théorique. Un fait scientifique est une réalité objective fixée d'une certaine manière - à l'aide du langage, des nombres, des nombres, des diagrammes, de la photographie, etc. Cependant, tout ce qui est obtenu à la suite d'observations et d'expériences ne peut pas être qualifié de fait scientifique. Un fait scientifique naît d'un certain traitement rationnel des données d'observation et d'expérimentation : leur compréhension, interprétation, recontrôle, traitement statistique, classement, sélection, etc. La fiabilité d'un fait scientifique se manifeste par le fait qu'il est reproductible et peut être obtenu grâce à de nouvelles expériences menées à des moments différents. Le fait reste valable quelles que soient les interprétations multiples. La fiabilité des faits dépend en grande partie de la manière, avec l'utilisation de quels moyens ils ont été obtenus. Les faits scientifiques (ainsi que les hypothèses empiriques et les lois empiriques qui révèlent la répétabilité stable et les relations entre les caractéristiques quantitatives des objets à l'étude) représentent uniquement des connaissances sur le déroulement des processus et des phénomènes, mais n'expliquent pas les causes et l'essence des phénomènes, processus sous-jacents aux faits scientifiques.
Dans la conférence précédente, nous avons donné une définition du sensationnalisme, et dans cette conférence, nous clarifierons le concept d'"empirisme". L'empirisme est un courant de la théorie de la connaissance qui reconnaît l'expérience sensorielle comme source de connaissance et estime que le contenu de la connaissance peut être présenté soit comme une description de cette expérience, soit réduit à celle-ci. L'empirisme réduit la connaissance rationnelle à des combinaisons de résultats d'expérience. F. Bacon (XVI-XVII siècles) est considéré comme le fondateur de l'empirisme. F. Bacon croyait que toutes les sciences antérieures (anciennes et médiévales) avaient un caractère contemplatif et négligeaient les besoins de la pratique, étant à la merci du dogme et de l'autorité. Et "la vérité est la fille du temps, pas de l'autorité". Et que dit l'heure (Nouvelle heure) ? Premièrement, que « la connaissance c'est le pouvoir » (également un aphorisme de F. Bacon) : la tâche commune de toutes les sciences est d'accroître le pouvoir de l'homme sur la nature et d'en tirer profit. Deuxièmement, cette nature est dominée par celui qui l'écoute. La nature est conquise par la soumission à elle. Qu'est-ce que cela signifie, selon F. Bacon ? Cette connaissance de la nature doit procéder d'elle-même et se fonder sur l'expérience, c'est-à-dire passer de l'étude des faits isolés de l'expérience aux dispositions générales. Mais F. Bacon n'était pas un empiriste typique, il était, pour ainsi dire, un empiriste intelligent, car le point de départ de sa méthodologie était l'union de l'expérience et de la raison. L'expérience autoguidée est un mouvement par le toucher. La vraie méthode consiste à traiter mentalement les matériaux à partir de l'expérience.
Les méthodes logiques générales de la connaissance scientifique sont utilisées à la fois aux niveaux empirique et théorique. Ces méthodes comprennent : l'abstraction, la généralisation, l'analyse et la synthèse, l'induction et la déduction, l'analogie, etc.
Nous avons parlé d'abstraction et de généralisation, d'induction et de déduction, d'analogie dans le cours du premier thème « Philosophie de la connaissance ».
L'analyse est une méthode de cognition (une méthode de pensée), qui consiste à diviser mentalement un objet en ses parties constitutives dans le but de les étudier de manière relativement indépendante. La synthèse implique la réunification mentale des éléments constitutifs de l'objet étudié. La synthèse permet de représenter l'objet de recherche dans la relation et l'interaction de ses éléments constitutifs.
Permettez-moi de vous rappeler que l'induction est une méthode de cognition basée sur des inférences du particulier (individuel) au général, lorsque le train de la pensée est dirigé de l'établissement des propriétés d'objets individuels à l'identification des propriétés générales inhérentes à toute une classe d'objets. ; de la connaissance du privé, la connaissance des faits, à la connaissance du général, la connaissance des lois. L'induction est basée sur des inférences inductives, qui ne donnent pas de connaissances fiables, elles ne font que, pour ainsi dire, « conduire » la pensée à la découverte de lois générales. La déduction est basée sur des inférences du général au particulier (singulier). Contrairement aux inférences inductives, les inférences déductives fournissent des connaissances fiables, à condition que ces connaissances soient contenues dans les prémisses initiales. Les méthodes de pensée inductive et déductive sont interconnectées. L'induction conduit la pensée humaine à des hypothèses sur les causes et les schémas généraux des phénomènes ; la déduction permet de tirer des conséquences empiriquement testables à partir d'hypothèses générales. F. Bacon, au lieu de la déduction répandue dans l'Antiquité au Moyen Âge, proposa l'induction, et R. Descartes était un adepte de la méthode de la déduction (avec toutefois des éléments d'induction), considérant toute la connaissance scientifique comme un seul système logique, où l'on position est dérivée d'une autre.
4. Le but du niveau théorique de la connaissance scientifique est de comprendre l'essence des objets étudiés, ou d'obtenir une vérité objective - des lois, des principes qui permettent de systématiser, expliquer, prédire des faits scientifiques établis au niveau empirique de la connaissance (ou ceux qui seront établis). Au moment de leur traitement théorique, les faits scientifiques sont déjà traités au niveau empirique : ils sont principalement généralisés, décrits, classés... Les connaissances théoriques reflètent des phénomènes, des processus, des choses, des événements du côté de leurs connexions et schémas internes communs, c'est à dire leur essence.
Les principales formes de connaissances théoriques sont le problème scientifique, l'hypothèse et la théorie. La nécessité d'expliquer de nouveaux fantasmes scientifiques obtenus au cours de la cognition crée une situation problématique. Le problème scientifique est la réalisation des contradictions qui sont apparues entre l'ancienne théorie et les nouveaux fantômes scientifiques, qui ont besoin d'être expliquées, et l'ancienne théorie ne peut plus le faire. (Par conséquent, il est souvent écrit que le problème est la connaissance de l'ignorance.) Dans le but d'une explication scientifique supposée de l'essence des faits scientifiques qui ont conduit à la formulation du problème, une hypothèse est avancée. Il s'agit de connaissances probabilistes sur les modèles possibles de n'importe quel objet. Une hypothèse doit être vérifiable empiriquement, ne doit pas contenir de contradictions logiques formelles, doit avoir une harmonie interne, une compatibilité avec les principes fondamentaux de cette science. L'un des critères d'évaluation d'une hypothèse est sa capacité à expliquer le maximum de faits scientifiques et de conséquences qui en découlent. Une hypothèse qui n'explique que les faits qui ont conduit à la formulation d'un problème scientifique n'est pas scientifiquement fondée. Une confirmation convaincante de l'hypothèse est la découverte dans l'expérience de nouveaux faits scientifiques qui confirment les conséquences prédites par l'hypothèse. C'est-à-dire que l'hypothèse doit également avoir un pouvoir prédictif, c'est-à-dire prédire l'émergence de nouveaux faits scientifiques non encore découverts par l'expérience. Une hypothèse ne doit pas inclure d'hypothèses inutiles. Une hypothèse, testée et confirmée de manière exhaustive, devient une théorie(dans d'autres cas, il est soit raffiné et modifié, soit rejeté). Une théorie est un système intégral, en développement, logiquement fondé, testé par la pratique, de connaissances ordonnées, généralisées et fiables sur l'essence d'un certain domaine de la réalité. La théorie est formée à la suite de la découverte de lois générales qui révèlent l'essence de la zone d'être étudiée. C'est la forme la plus élevée et la plus développée de réflexion de la réalité et d'organisation de la connaissance scientifique. L'hypothèse donne une explication au niveau du possible, la théorie au niveau du réel, du fiable. La théorie non seulement décrit et explique le développement et le fonctionnement de divers phénomènes, processus, choses, etc., mais prédit également des phénomènes, des processus encore inconnus et leur développement, devenant ainsi une source d'obtention de nouveaux faits scientifiques. La théorie organise le système des faits scientifiques, les inclut dans sa structure et déduit les faits nouveaux comme conséquences des lois et principes qui le forment.
La théorie sert de base aux activités pratiques des gens.
Il existe un groupe de méthodes qui sont d'une importance primordiale précisément pour le niveau théorique de la connaissance. Ce sont les méthodes axiomatiques, hypothético-déductives, d'idéalisation, la méthode d'ascension de l'abstrait au concret, la méthode de l'unité de l'analyse historique et logique, etc.
La méthode axiomatique est une manière de construire une théorie scientifique, dans laquelle elle est basée sur des dispositions initiales - des axiomes, ou postulats, à partir desquels toutes les autres dispositions d'une théorie donnée sont dérivées de manière logique (selon des règles strictement définies).
La méthode hypothétique-déductive est associée à la méthode axiomatique - une méthode de recherche théorique dont l'essence est de créer un système d'hypothèses déductivement interconnectées, à partir desquelles, en fin de compte, des déclarations sur des faits empiriques sont dérivées. Tout d'abord, une hypothèse (hypothèses) est créée, qui se déploie ensuite de manière déductive en un système d'hypothèses ; puis ce système est soumis à un test expérimental, au cours duquel il est affiné et concrétisé.
Une caractéristique de la méthode d'idéalisation est que le concept d'un objet idéal qui n'existe pas en réalité est introduit dans la recherche théorique (les concepts de "point", "point matériel", "ligne droite", "corps absolument noir", " gaz parfait", etc.) ... Dans le processus d'idéalisation, il y a une abstraction extrême de toutes les propriétés réelles de l'objet avec l'introduction simultanée de caractéristiques qui ne sont pas réalisées en réalité dans le contenu des concepts en formation (Alekseev PV, Panin AV Philosophy. - p. 310).
Avant d'aborder la méthode d'ascension de l'abstrait au concret, clarifions les notions d'« abstrait » et de « concret ». L'abstrait est une connaissance unilatérale, incomplète, significativement « pauvre » d'un objet. Le béton est une connaissance globale, complète et significative d'un objet. Le concret apparaît sous deux formes : 1) sous la forme du concret sensuellement, d'où part la recherche, conduisant ensuite à la formation d'abstractions (mentalement abstraites), et 2) sous la forme du concret mentalement, complétant la recherche sur la base de la synthèse d'abstractions préalablement identifiées (Alekseev P .V., Panin A.V. Philosophy. - S. 530). Le concret sensuellement est un objet de cognition qui apparaît devant le sujet dans sa complétude (intégrité) encore inconnue au tout début du processus de cognition. La cognition monte de la « contemplation vivante » d'un objet aux tentatives de construction d'abstractions théoriques et de celles-ci à la recherche d'abstractions véritablement scientifiques qui permettent de construire un concept scientifique d'un objet (c'est-à-dire mentalement concret), reproduisant toutes les connexions légales internes essentielles. d'un objet donné dans son ensemble. C'est-à-dire que cette méthode consiste en fait dans le mouvement de la pensée vers une perception toujours plus complète, compréhensive et holistique d'un objet, du moins significatif au plus significatif.
L'objet en développement dans son développement passe par un certain nombre d'étapes (étapes), un certain nombre de formes, c'est-à-dire a sa propre histoire. La connaissance d'un objet est impossible sans l'étude de son histoire. Historiquement, représenter un objet signifie imaginer mentalement tout le processus de sa formation, toute la variété des formes (étapes) de l'objet se remplaçant successivement. Cependant, toutes ces étapes historiques (formes, étapes) sont naturellement liées en interne. L'analyse logique permet d'identifier ces relations et conduit à la découverte de la loi qui détermine le développement de l'objet. Sans comprendre les schémas de développement d'un objet, son histoire ressemblera à un ensemble voire à un amas de formes, d'états, d'étapes séparés...
Toutes les méthodes de niveau théorique sont liées.
Comme de nombreux scientifiques le soulignent à juste titre, dans la créativité spirituelle, à côté des moments rationnels, il y a aussi des moments irrationnels (pas « ir- », mais « pas- »). L'intuition est l'un de ces moments. Le mot « intuition » vient du lat. "Je regarde attentivement." L'intuition est la capacité de comprendre la vérité sans une preuve préliminaire détaillée, comme si elle résultait d'une sorte d'intuition soudaine, sans une conscience claire des voies et moyens qui y conduisent.
Niveau de connaissance empirique
L'objet de recherche au niveau empirique est les propriétés, les connexions, les relations d'un objet qui sont accessibles à la perception sensorielle. Les objets empiriques de la science doivent être distingués des objets de la réalité, car les premiers sont certaines abstractions qui mettent en réalité en évidence un certain ensemble limité de propriétés, de connexions et de relations. Un objet réel a un nombre infini de caractéristiques, il est inépuisable dans ses propriétés, ses connexions, ses relations. C'est ce qui détermine l'orientation épistémologique de la recherche au niveau empirique - l'étude des phénomènes (phénomènes) et des connexions superficielles entre eux et la prédominance du corrélat sensoriel dans la recherche.
La tâche principale de la cognition au niveau empirique est d'obtenir des informations empiriques initiales sur l'objet à l'étude. Le plus souvent, des méthodes de cognition telles que l'observation et l'expérimentation sont utilisées pour cela.
Les connaissances qui se forment au cours du processus de recherche empirique - observation, mise en place et conduite d'expériences, collecte et description des phénomènes et faits observés, leur systématisation et généralisation empiriques - s'expriment sous la forme d'un fait scientifique et d'une généralisation empirique (loi).
La loi empirique est le résultat de la généralisation inductive des expériences et est une connaissance probabiliste vraie. L'augmentation du nombre d'expériences en elle-même ne rend pas la connaissance empirique fiable de la dépendance, puisque la généralisation empirique traite toujours de l'expérience incomplète.
La principale fonction cognitive que la cognition scientifique remplit au niveau empirique est la description des phénomènes.
La recherche scientifique ne se contentant pas de la description des phénomènes et de la généralisation empirique, s'efforçant de révéler les causes et les connexions essentielles entre les phénomènes, le chercheur passe au niveau théorique de la connaissance.
Moyens et méthodes de recherche empirique. Observation et expérimentation, types d'expérimentation
1. Observation- étude passive systématique et ciblée des sujets, basée principalement sur les données des organes des sens. Au cours de l'observation, nous acquérons des connaissances non seulement sur les aspects externes de l'objet de connaissance, mais aussi - en tant que but ultime - sur ses propriétés et relations essentielles.
L'observation peut être directe et médiatisée par divers dispositifs et autres dispositifs techniques. Au fur et à mesure que la science se développe, elle devient de plus en plus complexe et indirecte. L'observation capture et enregistre des faits, décrit l'objet de la recherche, fournit les informations empiriques nécessaires pour formuler de nouveaux problèmes et formuler des hypothèses.
Les principales exigences d'une description scientifique visent à la rendre aussi complète, précise et objective que possible. La description doit donner une image fiable et adéquate de l'objet lui-même, refléter avec précision les phénomènes étudiés. Il est important que les concepts utilisés pour la description aient toujours un sens clair et sans ambiguïté. Un point d'observation important est l'interprétation de ses résultats - décodage des lectures des instruments, etc.
2. Expérience Est une méthode cognitive dans laquelle les phénomènes sont étudiés dans des conditions contrôlées et contrôlées. Le sujet intervient activement dans le processus de recherche, agissant sur l'objet étudié à l'aide d'instruments et de dispositifs spéciaux, modifie délibérément et de manière fixe l'objet, révélant ses nouvelles propriétés. Grâce à cela, le chercheur parvient à isoler l'objet de l'influence de phénomènes secondaires qui obscurcissent son essence et à étudier le phénomène dans sa forme la plus pure ; changer systématiquement les conditions du processus; reproduire plusieurs fois le déroulement du processus dans des conditions strictement fixées et contrôlables.
Les principales caractéristiques de l'expérience : a) une attitude plus active (que lors de l'observation) vis-à-vis de l'objet de recherche, jusqu'à son changement et sa transformation ; b) la capacité de contrôler le comportement de l'objet et de vérifier les résultats ; c) la reproductibilité multiple de l'objet à l'étude à la demande du chercheur ; d) la possibilité de détecter de telles propriétés de phénomènes qui ne sont pas observés dans des conditions naturelles.
Les types (types) d'expériences sont très divers. Ainsi, selon leurs fonctions, ils distinguent recherche (recherche), vérification (contrôle), reproduction d'expériences... Par la nature des objets on distingue physique, chimique, biologique, social etc. il y a des expériences qualitatif et quantitatif... Une expérience de pensée est répandue dans la science moderne - un système de procédures mentales effectuées sur des objets idéalisés.
3. Comparaison- une opération cognitive qui révèle la similitude ou la différence d'objets (ou stades de développement d'un même objet), c'est-à-dire leur identité et leurs différences. Elle n'a de sens que dans l'agrégat d'objets homogènes qui forment une classe. La comparaison des objets dans la classe est effectuée selon les caractéristiques qui sont essentielles pour cette considération. En même temps, les objets comparés sur une base peuvent être incomparables sur une autre.
La comparaison est la base d'un dispositif aussi logique que l'analogie (voir ci-dessous) et sert de point de départ à la méthode historique comparative. Son essence est l'identification de la connaissance générale et spécifique des différentes étapes (périodes, phases) du développement d'un même phénomène ou de différents phénomènes coexistants.
4. La description- une opération cognitive, consistant à enregistrer les résultats d'une expérience (observation ou expérience) à l'aide de certains systèmes de notation adoptés en science.
5. Des mesures e - un ensemble d'actions effectuées à l'aide de certains moyens afin de trouver la valeur numérique de la grandeur mesurée dans les unités de mesure adoptées.
Il convient de souligner que les méthodes de recherche empirique ne sont jamais mises en œuvre « à l'aveugle », mais sont toujours « chargées théoriquement », guidées par certaines idées conceptuelles.
CARACTÉRISTIQUES DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES. NIVEAUX EMPIRIQUES ET THÉORIQUES DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES.
L'activité cognitive la plus importante d'une personne se manifeste dans les connaissances scientifiques, car c'est la science par rapport aux autres formes de conscience sociale qui vise avant tout l'assimilation cognitive de la réalité. Cela s'exprime dans les particularités de la connaissance scientifique.
Un trait caractéristique de la connaissance scientifique est sa rationalité- faire appel aux arguments de la raison et de la raison. La connaissance scientifique construit le monde en concepts. La pensée scientifique est avant tout une activité conceptuelle, alors qu'en art, par exemple, l'image artistique agit comme une forme de maîtrise du monde.
Une autre caractéristique est orientation vers l'identification de lois objectives de fonctionnement et de développement des objets étudiés. Il s'ensuit que la science s'efforce d'atteindre des objectifs objectifs et objectif connaissance de la réalité. Mais puisqu'il est connu que toute connaissance (y compris scientifique) est un alliage d'objectif et de subjectif, alors la spécificité de l'objectivité de la connaissance scientifique doit être relevée. Elle consiste en l'élimination maximale possible (retrait, expulsion) du subjectif de la connaissance.
La science vise à découvrir et à développer futures méthodes et formes de développement pratique du monde, pas seulement aujourd'hui. En cela, il diffère, par exemple, de la connaissance spontanée - empirique ordinaire. Des décennies peuvent s'écouler entre une découverte scientifique et son application dans la pratique, sous n'importe quelle forme, mais, en fin de compte, les réalisations théoriques créent la base des futurs développements techniques et d'ingénierie appliqués pour satisfaire les intérêts pratiques.
Savoir scientifique s'appuie sur des outils de recherche spécialisés qui agissent sur l'objet étudié et permettent d'identifier ses états possibles dans des conditions contrôlées par le sujet. Un équipement scientifique spécialisé permet à la science d'étudier expérimentalement de nouveaux types d'objets.
Les caractéristiques les plus importantes de la connaissance scientifique sont sa preuves, la validité et la cohérence.
La spécificité de la cohérence de la science - dans son organisation à deux niveaux : les niveaux empirique et théorique et l'ordre de leur interaction. C'est l'unicité du savoir et du savoir scientifique, puisqu'aucune autre forme de savoir n'a d'organisation à deux niveaux.
Parmi les traits caractéristiques de la science se trouve sa méthodologie spéciale. Parallèlement aux connaissances sur les objets, la science forme des connaissances sur les méthodes de l'activité scientifique. Cela conduit à la formation de la méthodologie en tant que branche spéciale de la recherche scientifique, conçue pour guider la recherche scientifique.
La science classique, apparue aux XVIe et XVIIe siècles, combinait théorie et expérimentation, mettant en évidence deux niveaux scientifiques : empirique et théorique. Elles correspondent à deux types d'activités scientifiques et cognitives à la fois interdépendantes et spécifiques : la recherche empirique et la recherche théorique.
Comme il a été dit, la connaissance scientifique est organisée à deux niveaux : empirique et théorique.
À niveau empirique comprennent des techniques et des méthodes, ainsi que des formes de connaissances scientifiques, directement liées à la pratique scientifique, avec les types d'activités liées à l'objet, grâce auxquelles l'accumulation, la fixation, le regroupement et la généralisation du matériel source pour la construction de connaissances théoriques médiatisées sont assuré. Cela inclut l'observation scientifique, les diverses formes d'expérimentation scientifique, les faits scientifiques et les manières de les regrouper : systématisation, analyse et généralisation.
À niveau théorique comprend tous les types et méthodes de connaissances scientifiques et méthodes d'organisation des connaissances qui se caractérisent par l'un ou l'autre degré de médiation et assurent la création, la construction et le développement d'une théorie scientifique en tant que connaissance logiquement organisée sur les lois objectives et d'autres connexions et relations essentielles dans le monde objectif. Cela inclut la théorie et ses éléments et composants tels que les abstractions scientifiques, les idéalisations, les modèles, les lois scientifiques, les idées et hypothèses scientifiques, les méthodes de fonctionnement avec les abstractions scientifiques (déduction, synthèse, abstraction, idéalisation, moyens logiques et mathématiques, etc.)
Il convient de souligner que bien que la différence entre les niveaux empirique et théorique soit due à des différences qualitatives objectives dans le contenu et les méthodes de l'activité scientifique, ainsi que dans la nature de la connaissance elle-même, cette différence est en même temps relative. Aucune forme d'activité empirique n'est possible sans sa compréhension théorique et, à l'inverse, toute théorie, aussi abstraite soit-elle, repose en définitive sur la pratique scientifique, sur des données empiriques.
L'observation et l'expérimentation sont parmi les principales formes de connaissance empirique. Observation il y a une perception délibérée et organisée des objets et des phénomènes du monde extérieur. L'observation scientifique se caractérise par la détermination, la planification et l'organisation.
Expérience diffère de l'observation par son caractère actif, son interférence dans le cours naturel des événements. Une expérience est un type d'activité entreprise dans un but de connaissance scientifique, qui consiste à influencer un objet scientifique (processus) au moyen de dispositifs spéciaux. Grâce à cela, il est possible :
- isoler l'objet étudié de l'influence de phénomènes secondaires, insignifiants ;
- reproduire à plusieurs reprises le déroulement du processus dans des conditions strictement fixées ;
- étudier systématiquement, combiner diverses conditions afin d'obtenir le résultat souhaité.
Une expérience est toujours un moyen de résoudre une certaine tâche ou un problème cognitif. Il existe une grande variété de types d'expériences : physique, biologique, directe, modèle, recherche, vérification, etc.
La nature des formes du niveau empirique détermine les méthodes de recherche. Ainsi, la mesure, en tant que l'un des types de méthodes de recherche quantitative, a pour objectif de refléter au mieux les relations quantitatives objectives dans les connaissances scientifiques, exprimées en nombre et en ampleur.
La systématisation des faits scientifiques est d'une grande importance. Fait scientifique - ce n'est pas n'importe quel événement, mais un événement qui est entré dans la sphère de la connaissance scientifique et a été enregistré par l'observation ou l'expérimentation. Organiser des faits signifie le processus de les regrouper en fonction de propriétés essentielles. L'induction est l'une des méthodes les plus importantes de généralisation et de systématisation des faits.
Induction défini comme une méthode d'acquisition de connaissances probabilistes. L'induction peut être intuitive - une simple supposition, trouver un terrain d'entente grâce à l'observation. L'induction peut servir de procédure pour établir le général en énumérant des cas isolés. Si le nombre de ces cas est limité, alors il est dit complet.
Raisonnement par analogie appartient aussi au nombre des inférences inductives, puisqu'elles sont inhérentes à la probabilité. Habituellement, l'analogie est comprise comme ce cas particulier de similitude entre des phénomènes, qui consiste dans la similitude ou l'identité des relations entre les éléments de systèmes différents. Pour augmenter le degré de probabilité des conclusions par analogie, il est nécessaire d'augmenter la variété et d'obtenir l'uniformité des propriétés comparées, afin de maximiser le nombre de caractéristiques comparées. Ainsi, par l'établissement d'une similitude entre les phénomènes, en substance, une transition est effectuée de l'induction à une autre méthode - la déduction.
Déduction diffère de l'induction en ce qu'elle est associée à des phrases résultant des lois et des règles de la logique, mais la vérité des prémisses est problématique, tandis que l'induction est basée sur de vraies prémisses,
Mais le passage aux suggestions - conclusions reste un problème. Par conséquent, dans la connaissance scientifique, pour étayer les dispositions, ces méthodes se complètent.
Le chemin de la transition des connaissances empiriques aux connaissances théoriques est très difficile. Il a le caractère d'un saut dialectique, dans lequel des moments divers et contradictoires s'entrecroisent, se complètent : pensée abstraite et sensualité, induction et déduction, analyse et synthèse, etc. Le point clé de cette transition est l'hypothèse, son avancement, sa formulation et son développement, sa justification et sa démonstration.
Le terme " hypothèse »Est utilisé dans deux sens : 1) au sens étroit - la désignation d'une hypothèse concernant un ordre régulier ou d'autres connexions et relations essentielles ; 2) au sens large - comme un système de phrases, dont certaines sont les prémisses initiales de nature probabiliste, tandis que d'autres représentent un développement déductif de ces prémisses. À la suite de tests complets et de la confirmation de toutes les diverses conséquences, l'hypothèse se transforme en théorie.
La théorie appelé un système de connaissances pour lequel la véritable évaluation est tout à fait précise et positive. La théorie est un système de connaissances objectivement vraies. La théorie diffère de l'hypothèse par sa fiabilité, des autres types de connaissances fiables (faits, statistiques, etc.) elle diffère par sa stricte organisation logique et son contenu, qui consiste à refléter l'essence des phénomènes. La théorie est la connaissance de l'essence. Un objet au niveau de la théorie apparaît dans sa connexion interne et son intégrité en tant que système dont la structure et le comportement sont soumis à certaines lois. Grâce à cela, la théorie explique la variété des faits disponibles et peut prédire de nouveaux événements, ce qui parle de ses fonctions les plus importantes : explicative et prédictive (fonction prospective). La théorie est composée de concepts et d'énoncés. Les concepts fixent les qualités et les relations des objets du domaine. Les déclarations reflètent l'ordre, le comportement et la structure du domaine. Une caractéristique de la théorie est que les concepts et les déclarations sont interconnectés dans un système logiquement harmonieux et cohérent. L'ensemble des relations logiques entre les termes et les phrases d'une théorie forme sa structure logique, qui est généralement déductive. Les théories peuvent être classées selon divers critères et fondements : selon le degré de connexion avec la réalité, selon le domaine de création, d'application, etc.
La pensée scientifique fonctionne avec de nombreuses méthodes. Il est possible de mettre en évidence, par exemple, l'analyse et la synthèse, l'abstraction et l'idéalisation, la modélisation. Une analyse - Il s'agit d'une méthode de pensée associée à la décomposition de l'objet étudié en ses éléments constitutifs, évolution des tendances dans le but de leur étude relativement indépendante. Synthèse- l'opération inverse, qui consiste à combiner les parties précédemment identifiées en un tout afin d'acquérir des connaissances générales sur les parties et les tendances précédemment identifiées. Abstraction il y a un processus d'isolement mental, d'isolement des caractéristiques individuelles d'intérêt, des propriétés et des relations dans le processus de recherche afin de les comprendre plus profondément.
En voie d'idéalisation il y a une abstraction extrême de toutes les propriétés réelles de l'objet. Un soi-disant objet idéal est formé, qui peut être exploité dans la cognition d'objets réels. Par exemple, des concepts tels que "point", "ligne droite", "corps absolument noir" et autres. Ainsi, le concept de point matériel ne correspond en réalité à aucun objet. Mais un mécanicien, opérant avec cet objet idéal, est capable d'expliquer théoriquement et de prédire le comportement d'objets matériels réels.
Littérature.
1. Alekseev P.V., Panin A.V. Philosophie. - M., 2000. Section. II, ch. XIII.
2. Philosophie / Éd. V.V. Mironov. - M., 2005. Rubrique. V, ch. 2.
Questions de test pour l'auto-examen.
1. Quelle est la tâche principale de l'épistémologie ?
2. Quelles formes d'agnosticisme peut-on distinguer ?
3. Quelle est la différence entre le sensationnalisme et le rationalisme ?
4. Qu'est-ce que « l'empirisme » ?
5. Quel est le rôle de la sensibilité et de la pensée dans l'activité cognitive individuelle ?
6. Qu'est-ce que la connaissance intuitive ?
7. Mettre en évidence les idées principales du concept d'activité de la cognition de Karl Marx.
8. Comment se déroule la connexion entre le sujet et l'objet dans le processus de cognition ?
9. Qu'est-ce qui détermine le contenu du savoir ?
10. Qu'est-ce que la « vérité » ? Quelles sont les principales approches en épistémologie de la définition de ce concept que vous nommerez ?
11. Quel est le critère de vérité ?
12. Expliquez quelle est la nature objective de la vérité ?
13. Pourquoi la vérité est-elle relative ?
14. La vérité absolue est-elle possible ?
15. Quelle est la particularité du savoir scientifique et du savoir scientifique ?
16. Quelles formes et méthodes de niveaux empiriques et théoriques de connaissances scientifiques peut-on distinguer ?




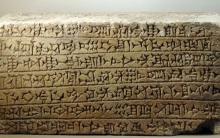
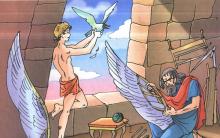
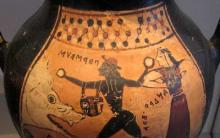




Yulia efremenkova - biographie, informations, vie personnelle Quel est le passé de Julia de la maison 2
Yulia Efremenkova: photo sur Instagram House 2 Le passé de Yulia
Mort étrange du réalisateur de "Boulettes de l'Oural" Mort de l'un des raviolis de l'Oural
Création de peintures modulaires: une classe de maître pour les débutants Comment faire une peinture modulaire à partir de papier peint
Les blagues du 1er avril en action