(latin Carolus Magnus ou Karolus Magnus, allemand Karl der Große, français Charlemagne, né le 2 avril 747 † 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle) - Roi des Francs à partir de 768 (dans la partie sud à partir de 771), Roi des Lombards à partir de 774, duc de Bavière à partir de 788, empereur d'Occident à partir de 800. Le fils aîné de Pépin le Bref et de Bertrada Laonskaya. Sous le nom de Charles, la dynastie des Pipinides reçut le nom carolingien. Charles a reçu le surnom de « Grand » de son vivant.
Lieu et année de naissance
Le biographe Karl Einhard rapporte qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir des informations sur la naissance et l'enfance de Karl, mais il note ailleurs qu'il est décédé à l'âge de 72 ans, c'est-à-dire qu'il aurait dû naître en 742. Dans l'épitaphe survivante d'Aix-la-Chapelle, il est dit que Karl est mort dans la 70e année de sa vie, c'est-à-dire qu'il est né en 744. L'une des premières chroniques médiévales sous l'an 747 dit : « Cette année est né le roi Charles. On y parle, sous l'an 751, de la naissance du frère cadet de Karl Karloman, et cette date n'est pas remise en cause.
Le lieu de naissance de Karl est totalement inconnu et contesté par de nombreuses villes : Paris, Ingelheim, Worms, Luttich, Carsberg en Bavière et bien d'autres villes le revendiquent, sans toutefois être étayées par des preuves suffisantes.
Le début du règne. Mort de Carloman
Le 28 juillet 754, Karl, avec son frère Carloman, a été oint au trône dans l'église de Saint-Denis par le pape Etienne II, et après la mort de Pépin, il est monté sur le trône avec son frère. En partageant son héritage paternel avec son frère, Charles reçut la possession du terrain sous la forme d'un vaste croissant, s'étendant de l'Aquitaine atlantique à la Thuringe, à travers la majeure partie de la Neustrie et de l'Austrasie, à travers la Frise et la Franconie, et couvrant les possessions du frère de Carloman sur tous les côtés. La résidence de Karl était Noyon. Les frères ne s'entendaient pas, malgré les efforts désespérés de leur mère, Bertrada, pour les rapprocher, malgré tout et tout. L'accord entre eux fut maintenu avec la plus grande difficulté, car de nombreux membres de l'entourage de Carloman tentèrent de brouiller les frères, et même de porter l'affaire à la guerre. Lorsqu'en 769, un des seigneurs du sud-ouest nommé Gunold (peut-être le fils de Weifar) souleva les Aquitains de l'ouest et les Basques gascons, Charles fut contraint d'aller seul réprimer la rébellion, car Carloman refusait de se joindre lui avec son armée... Mais, malgré cela, Karl a résolument poursuivi sa campagne planifiée et, avec sa persévérance et sa fermeté, a réalisé tout ce qu'il voulait. Il força Hunold à fuir en Gascogne. Sans l'y laisser seul, Charles traversa la Garonne et obtint le fugitif du duc Loup de Gascon.
Craignant une conspiration entre Carloman et le roi lombard Desiderius, Charles décide de prendre de l'avance sur les événements. Il se rapproche non seulement de son cousin, le duc de Bavière Tassilon, qui, tout en restant fidèle aux traditions de sa famille, devient le gendre du roi lombard, mais en 770, sur les conseils de la mère de Bertrada, il épousa la fille Desiderate de Desiderius, laissant sa femme légitime Gimiltruda (qui a déjà donné naissance à son fils Pepin). Le conflit aurait pu dégénérer gravement si Carloman n'était pas mort, et à point nommé, en décembre 771. Karl attira à ses côtés quelques-unes des figures les plus proches de Carloman et s'empara de l'héritage de son frère. Sa belle-fille Gerberg et son neveu Pépin, né en 770, se réfugièrent chez Desiderius.
La personnalité et l'apparence de Karl
Selon le biographe Karl Einhard, Karl était très grand (presque sept pieds de haut), solidement bâti, enclin à l'embonpoint. Son visage se distinguait par un long nez et de grands yeux vifs. Il avait de longs cheveux blonds. La voix de Karl était inhabituellement haute pour un homme aussi imposant. Au fil des ans, le roi a commencé à souffrir de boiterie. Les portraits de Karl n'ont pas survécu et de nombreux artistes l'ont représenté selon leur imagination, en utilisant seulement certaines des caractéristiques de cette description. Bien que beaucoup aient pris la description du physique héroïque de Karl comme une exagération épique, l'exhumation de la tombe de Karl a confirmé l'exactitude de la description : la longueur du squelette était de 192 cm.
Le roi était très simple et modéré dans ses habitudes. Les jours ordinaires, sa tenue vestimentaire ne différait pas beaucoup de celle d'un roturier. Il buvait peu de vin (au dîner, il ne buvait pas plus de trois tasses) et détestait l'ivresse. Son dîner en semaine ne se composait que de quatre plats, sans compter le rôti, que les chasseurs eux-mêmes servaient directement à la broche, et que Karl préférait à tout autre plat. En mangeant, il écoutait de la musique ou lisait. Il s'intéressait aux exploits des anciens, ainsi qu'à la composition de saint Augustin « Sur la Cité de Dieu ». Après le dîner d'été, il mangea quelques pommes et but une autre tasse ; puis, se déshabillant, il se reposa deux ou trois heures. La nuit, il dormait mal : il se réveillait quatre ou cinq fois et se levait même. Lors de l'habillage du matin, Karl recevait des amis, et aussi, s'il y avait une affaire urgente difficile à résoudre sans lui, il écoutait les justiciables et prononçait une sentence. En même temps, il donnait des ordres à ses serviteurs et ministres pour toute la journée. Il était éloquent et exprimait ses pensées avec une telle aisance qu'il pouvait passer pour un rhéteur. Ne se limitant pas à sa langue maternelle, Karl a beaucoup travaillé sur les langues étrangères et, soit dit en passant, maîtrisait tellement le latin qu'il pouvait s'y exprimer comme dans sa langue maternelle ; en grec, il comprenait plus qu'il ne parlait. Étudiant assidûment diverses sciences, il appréciait grandement les scientifiques, leur témoignant un grand respect. Il étudia lui-même la grammaire, la rhétorique, la dialectique et surtout l'astronomie, grâce auxquelles il put habilement calculer les jours fériés et observer le mouvement des astres. Il essaya aussi d'écrire, et pour cela il gardait constamment des planches à écrire sous son oreiller afin d'entraîner sa main à dessiner des lettres pendant son temps libre, mais son travail, commencé trop tard, eut peu de succès. Au cours de toutes les années, il a profondément vénéré l'Église et a observé de manière sacrée tous les rituels.
Le début de la guerre avec les Saxons
Peu de temps après la mort de son frère, Karl a commencé une guerre avec les Saxons. Ce fut la guerre la plus longue et la plus féroce de son règne. Avec des interruptions, des arrêts et des renouvellements, elle dura trente-trois ans, jusqu'en 804, et coûta aux Francs les plus grandes pertes, puisque les Saxons, comme tous les peuples d'Allemagne, étaient féroces et dévoués à leurs cultes. La frontière avec eux courait presque partout sur une plaine nue, et était donc indéfinie. Des meurtres, des vols et des incendies s'y déroulaient tous les jours. Irrités par cela, les Francs, finalement, à la Diète de Worms ont jugé nécessaire de déclencher une guerre contre leurs voisins. En 772, Charles envahit pour la première fois la Saxe, détruisit la forteresse d'Eresbourg et renversa le sanctuaire païen - l'idole d'Irminsul. Mais Karl comprit qu'il n'y aurait pas de pacification durable tant qu'il y aurait une Saxe indépendante en dehors du royaume, ou plutôt des Saxons indépendants, puisque ce peuple était divisé en Occidental (Westphalien), Central (Angraire), Oriental (Ostphalien) et Nord (Nordalbingen). ) Saxons.
Invasion de l'Italie
Ensuite, Karl a été distrait par les affaires italiennes. En 771, Charles divorça de sa femme, fille du roi lombard Desiderata, l'envoya chez son père et épousa la petite-fille du duc d'Alemanni Gottfried, Hildegard (Hildegard). En 772, Karl eut un fils d'Hildegarde, qui reçut également le nom de Karl. Desiderius n'a pas tardé à relever le défi. Dès les premiers jours de 772, il demande au pape Adrien Ier d'oindre le royaume de Pépin, fils de Carloman, et reprend l'offensive contre les États pontificaux, lancée par ses prédécesseurs. Papa s'est tourné vers Karl pour obtenir de l'aide. En septembre 773, une forte armée franque marche vers les Alpes. Les Lombards ferment et fortifient les cols. Karl opta pour une manœuvre de détour. Par des chemins secrets, un détachement franque intrépide se dirigea vers l'ennemi par l'arrière et, par son apparence même, provoqua la confusion générale dans l'armée lombarde et la fuite du fils du roi Desiderius, Adelhiz. Il y a une indication que le pape a réussi à semer la trahison, à la fois dans l'armée du roi des Lombards, et dans ses possessions, que c'était cette circonstance qui était la raison de la très faible résistance. Craignant l'encerclement, Desiderius quitta les cols et se retira dans sa capitale Pavie, espérant s'asseoir derrière ses murs épais, son fils avec la veuve et les enfants de Carloman se réfugia à Vérone. Les Francs ont poursuivi l'ennemi au combat, capturant de nombreuses villes de Lombardie en cours de route. Laissant une partie des forces à Pavie, Charles avec le reste de l'armée s'approcha de Vérone en février 774. Après un court siège, la ville se rendit, et Charles eut le plaisir de s'emparer des neveux, dont Desiderius lui faisait tant peur.
Karl - Roi des Lombards
En avril 774, les Francs s'approchent de Rome. Le pape Adrien Ier a donné à Charles une grande réception. Karl traita le grand prêtre avec le plus grand respect : avant d'approcher la main d'Hadrien, il baisa les marches de l'escalier de l'église Saint-Pierre. Il a promis d'ajouter de nouvelles donations à de nombreuses villes présentées au Pape par son père (cette promesse n'a pas été tenue plus tard). Début juin, incapable de résister aux épreuves du siège, Desiderius quitta Pavie et obéit au vainqueur. Charles prit possession de la capitale des Lombards et du palais royal. Ainsi, le royaume des Lombards tomba, leur dernier roi fut fait prisonnier dans l'État franc, où il fut contraint de prononcer des vœux monastiques, et son fils s'enfuit chez l'empereur byzantin. Ayant accepté le titre de roi lombard, Charles commença à introduire le système franc en Italie et unifia la France et l'Italie en un seul État.
En 776, Charles devait retourner en Italie pour pacifier le soulèvement. Les ducs de Frioul et de Spolète, soutenus par Adelchis, conspirèrent, espérant s'emparer de Rome avec l'aide de la flotte byzantine et restaurer le pouvoir des Lombards. Karl, après avoir été averti par le pape Adrien de la conspiration, traversa à nouveau les Alpes et déjoua le complot des conjurés. En conséquence, le duc de Friul Wrothhaut a été tué, les villes rebelles ont obéi et Adelheis a de nouveau été contraint de fuir.
Continuation de la guerre avec les Saxons
En 775, à la tête d'une grande armée, Karl s'enfonce plus que d'habitude dans le territoire des Saxons, atteint le pays des Ostphals et atteint la rivière Okker, prend des otages et laisse de fortes garnisons à Eresburg et Sigiburg. Le printemps suivant, sous l'assaut des Saxons, Eresbourg tomba. Après cela, Charles changea de tactique, décidant de créer une « ligne fortifiée » (marque), censée protéger les Francs des invasions des Saxons. En 776, après avoir de nouveau fortifié Eresburg et Sigiburg, il construisit une nouvelle forteresse de Karlsburg et laissa des prêtres dans la zone frontalière pour la conversion des Saxons païens au christianisme, ce qui au début se passa avec succès. En 777, les Saxons furent à nouveau vaincus, puis la majorité des Saxons Edeling (noblesse tribale) reconnurent Charles comme leur souverain, lors d'une réunion à Paderborn.
Bataille de Ronseval
En 777, Charles reçut le gouverneur musulman de Saragosse, venu lui demander de l'aide dans la lutte contre l'émir de Cordoue, Abd ar-Rahman. Charles accepta, mais en 778, se retrouvant en Espagne à la tête d'une immense armée, il échoua à Saragosse, où il fut trahi par les alliés d'hier. Au retour, à Ronseval, alors que l'armée se déplaçait en formation étendue, forcée par les gorges de la montagne, les Basques tendirent une embuscade au sommet des falaises et attaquèrent le détachement d'en haut, couvrant le convoi de chariots, tuant jusqu'au dernier homme. A côté du commandant du détachement Roland, tombèrent le sénéchal Eggihard et le comte de cour Anselme. Cette bataille, qui eut lieu le 15 août 778, s'appelle Ronseval. Einhard ne donne pas ce nom, cependant, souligne que seules l'arrière-garde du convoi des Francs et ceux qui marchaient en toute fin de détachement ont été vaincus. Dans la version originale des Annales du Royaume des Francs, compilées en 788-793, dans les événements relatifs à 778, il n'y a aucune mention de cette bataille du tout. Il est seulement dit qu'« après la remise des otages d'Ibn Al-Arabi, d'Abutariya et de nombreux Sarrasins, après la destruction de Pampelune, la conquête des Basques et de Navarri, Karl retourna sur le territoire de Frankia ». Il n'y a également aucune mention de cette bataille dans la version révisée des Annales, compilées peu de temps après la mort de Karl. Mais il y a un nouveau passage important : « De retour [Karl] a décidé de passer par les gorges des Pyrénées. Les Basques, dressant une embuscade tout en haut de cette gorge, jetèrent toute l'armée de [Charles] dans une grande confusion. Et bien que les Francs aient été supérieurs aux Basques, tant en armes qu'en courage, la supériorité a été vaincue en raison de l'inégalité du lieu et de l'incapacité des Francs à se battre. Dans cette bataille, une grande partie de l'entourage, que le roi mit à la tête de son armée, fut tué, le train de bagages fut pillé ; l'ennemi, grâce à la connaissance de la zone, s'est aussitôt dispersé dans différentes directions. » Einhard, cependant, dans son ouvrage (c'est la troisième description de la bataille de Ronseval) apporte deux changements principaux. Il remplace « toute l'armée » de la version réécrite des Annales du royaume franc par « ceux qui ont marché à la toute fin de la fête » et ne énumère que trois des nobles Francs tombés au combat (Eggihard, Anselme et Rouotland, c'est-à-dire Roland (préfet de la marque bretonne) le héros de la célèbre épopée française "Chanson de Roland".). La date exacte de la bataille - le 15 août - est connue grâce à l'épitaphe d'Eggihard, l'intendant de Karl - "elle eut lieu le dix-huitième jour des calendriers de septembre". Vingt ans plus tard, en décrivant les mêmes événements, un scribe inconnu des Annales insère un message dont il n'est pas fait mention dans les premiers textes. Apparemment, attirer l'attention sur cet événement était important pour lui. Très probablement, tous les détails ont été tirés par lui de textes ultérieurs. Il dit que toute l'armée franque est entrée dans la bataille et affirme que de nombreux dirigeants francs ont été tués. Ce fut une vraie catastrophe. La défaite a plongé dans la panique les chrétiens gothiques d'Espagne, parmi lesquels l'invasion franque a suscité de grands espoirs, et beaucoup d'entre eux se sont réfugiés de la domination islamique dans l'État franc.
Vidukind devient le leader de la résistance saxonne
A son retour, Charles connaîtra d'autres ennuis : les Saxons-Westphales, réunis autour de Vidukind, qui en 777 ne se présentent pas à Paderborn, mais fuient vers le roi danois Siegfried (Sigifried), oublient leurs serments et leur appel ostentatoire et déclenchent la guerre. de nouveau. En 778, ayant franchi la frontière du Rhin, ils remontèrent la rive droite de ce fleuve jusqu'à Coblence, brûlant et pillant tout sur leur passage, puis, chargés d'un riche butin, revinrent presque sans obstacles. Une seule fois, le détachement franque rattrapa les Saxons à Leisa et infligea des dommages mineurs à leur arrière-garde. En 779, Charles envahit la Saxe et traversa presque tout le pays, ne rencontrant aucune résistance nulle part. Encore une fois, comme auparavant, de nombreux Saxons sont venus dans son camp, qui ont donné des otages et un serment d'allégeance. Cependant, le roi ne croyait plus à leur tranquillité.
La campagne suivante en 780 a été préparée par Charles avec plus de soin. Avec son armée et ses prêtres, Karl réussit à avancer jusqu'à l'Elbe - la frontière entre les Saxons et les Slaves. À cette époque, Charles avait déjà un plan stratégique, qui se résumait, en général, à la conquête de toute la Saxe par la christianisation. Dans cette entreprise, Charles a été grandement aidé par l'anglo-saxon Villegad, docteur en théologie, qui a commencé à implanter activement une nouvelle foi. Charles divisa toute la Saxe en districts administratifs, à la tête desquels il mit des comtes. L'année 782 fut de nouveau consacrée aux affaires saxonnes. Pour pacifier les Slaves sorabes qui ont attaqué les régions frontalières de la Saxe et de la Thuringe, Charles a envoyé une armée, qui comprenait les Saxons fidèles à Charles. Mais juste à ce moment-là, Vidukind revint du Danemark. Le pays tout entier s'est immédiatement révolté, annulant toutes les réalisations de Charles. Beaucoup de Francs et de Saxons, qui ont adopté la nouvelle foi, ont été tués, des églises chrétiennes ont été détruites. Karl a de nouveau échoué parce qu'il n'a pas tenu compte de l'engagement des Saxons envers leur propre foi. Une armée envoyée contre les Sorabes fut prise en embuscade près de la Weser, près du mont Zuntal, et fut presque entièrement tuée par les rebelles. Dans le même temps, le mécontentement vis-à-vis des innovations de Charles en Frise augmentait.
Mesures cruelles de Karl contre les Saxons. Baptême de Vidukinda
Charles rassembla une nouvelle armée, se présenta à Verdun, convoqua les anciens saxons et les força à livrer 4500 instigateurs de la révolte. Tous ont été décapités en une journée. Vidukind a réussi à s'échapper. Dans le même temps, le soi-disant « Premier capitulaire saxon » a été promulgué, qui ordonnait de punir de mort tout écart par rapport à la loyauté envers le roi et toute violation de l'ordre public, et recommandait également des mesures pour éradiquer toute manifestation de paganisme. La bataille de Detmold en 783 fut indécise ; Karl a dû battre en retraite, mais a ensuite remporté une victoire à Gaza, près d'Osnabrück. Pendant les 784 et 785 années suivantes, Charles a à peine quitté la Saxe. Au cours de cette guerre opiniâtre, il battit les Saxons dans des batailles ouvertes et des raids punitifs, prit des centaines d'otages qu'il emporta du pays, détruisit les villages et les fermes des rebelles. L'hiver 784-785, contrairement aux hivers précédents, temps de repos pour Karl ; a également été passé par lui en Saxe, à Eresbourg, où il a déménagé avec sa famille. À l'été 785, les Francs franchissent la Weser. Saigné à mort par de nombreuses défaites, Vidukind demande grâce et entame des négociations avec Karl à Berngau. A l'automne, les chefs des Saxons Vidukind et Abbion se présentent enfin à la cour de Charles à Attigny, en Champagne, se font baptiser (d'ailleurs, Karl est le parrain de Vidukind), prêtent allégeance et reçoivent de ses mains de riches présents. Ce fut un tournant dans la guerre de Saxe. Dans les annales de 785, il a été enregistré que le roi des Francs « soumettait toute la Saxe ». Après cela, la résistance des vaincus a commencé à s'affaiblir progressivement.
Action militaire en Bretagne
L'autorité du roi était presque inébranlable en Neustrie et en Austrasie, mais Charles devait encore concilier le sud de la Gaule, et son extrême ouest. Charles envahit à plusieurs reprises la Bretagne, le pays de la tribu celtique des Bretons (Bretons), leur imposant un tribut. Aux abords de la Bretagne à la fin des années 70, une marque frontière britannique est apparue, comprenant les villes de Rennes, Tours, Angers et Vannes. En 799, Guy, un représentant de l'influente famille austrasienne des Lambertides, le souverain de cette province, profitant de la discorde entre les chefs bretons, effectua une expédition décisive dans la péninsule. En 800, les chefs des Bretons prêtent serment d'allégeance à Charles à Tours. Cependant, ce pays ne s'est pas soumis à la fin, préservant ses propres coutumes et coutumes religieuses. Quelques années plus tard, le besoin se fait sentir d'une nouvelle société, elle se tient en 811 et montre toute la fragilité du pouvoir des Francs dans un pays qui n'a jamais renoncé à son indépendance politique et religieuse.
Action militaire en Aquitaine
En Aquitaine, à partir de 779, Charles commence à établir des vassaux royaux et y envoie systématiquement des comtes parmi les Francs. Et en 781, il éleva l'Aquitaine au rang de royaume, et plaça sur son trône son nouveau fils de la reine Hildegarde, qui naquit il y a 3 ans et reçut le nom mérovingien de Louis (Ludwig ou Clovis). L'Aquitaine allait devenir un vaste point d'appui dans la lutte contre les basques ibériques et contre les musulmans d'Espagne. Dans le même but, il créa le comté de Toulouse et de Septimanie et le mit à sa tête en 790-804. son cousin le duc Guillaume. Dans les années 90, le nouveau roi Louis a entrepris des campagnes de courte durée au-delà des Pyrénées, à la suite desquelles une frontière fortifiée de la Marque espagnole est apparue, constituée d'une zone frontalière fortifiée avec les villes de Gérone, Urchel et Vic.
Quant à Charles, malgré la création du royaume d'Aquitaine, il refusa toute intervention dans cette région, même dans les cas où des villes et des régions entières (Urjel, Hérone, Cerdan) déclaraient vouloir se placer sous son patronage, ou lorsqu'en 793 M. L'émir de Cordoue attaque Narbonne et met le duc Guillaume dans une position difficile. Les Francs ne reprennent l'initiative qu'à la toute fin du siècle (à partir de 799 le pouvoir des Francs s'étend aux Baléares), et ils n'obtiennent leur premier succès qu'en 801, lorsque le roi d'Aquitaine Louis s'empare de la ville arabe de Barcelone, et en fit d'abord le centre du comté, puis toute la zone fortifiée espagnole (marque espagnole), qui étendit bientôt ses frontières (dans les années 804-810) à Tarragone et aux plateaux montagneux au nord de l'Èbre. En 806, Pampelune est soumise.
Le pape sanctifie la nomination des fils de Charles comme rois
En 781, les mêmes jours où Louis devint roi d'Aquitaine, Charles établit pour Carloman, quatre ans, son autre fils, né de Hildegarde, "le royaume d'Italie", et au printemps 781 à Rome, le Pape, à la demande de Charles, consacra cette nomination, en même temps que la dédicace de Louis. A cette occasion, l'enfant reçut le nom royal de Pépin, ce qui excluait de fait de l'héritage de son demi-frère le fils d'Himiltruda, qui porte déjà ce nom.
Un nouveau soulèvement dans le nord
Cependant, en 793, un soulèvement éclata à nouveau dans le nord, qui couvrait non seulement la Saxe, mais aussi d'autres territoires dans lesquels vivaient les Frisons, les Avars et les Slaves. De 794 à 799 il y eut encore une guerre, qui était déjà de nature destructrice, accompagnée d'otages et de prisonniers de guerre massifs, avec leur réinstallation ultérieure comme serfs dans les régions internes de l'État. La résistance des Saxons se poursuit avec une grande amertume (surtout avec obstination à Wihmodia et Nordalbingia). Voulant remporter la victoire sur eux, Karl a fait une alliance avec les Slaves-acclamations, ennemis des Saxons, et de nouveau avec sa famille a passé l'hiver 798-799 en Saxe dans la Weser, où il a installé un camp, et en fait construit une nouvelle ville avec des maisons et des palais, en appelant ce lieu Gerstel (c'est-à-dire "Army Station"). Au printemps, quittant Herstel, il s'approche de Minden et dévaste toute la zone entre la Weser et l'Elbe, tandis que ses alliés sont encouragés à combattre avec succès en Nordalbingia, ce qui permet de décider de l'issue de la lutte en faveur de Karl. En 799, il y eut une autre campagne de Charles avec ses fils en Saxe, dans laquelle le roi lui-même ne montra aucune activité.
Charles soumet les duchés lombards en Italie
Après la campagne de Charles en Italie, le pays représentait, à l'exception des régions franque et ecclésiastique, deux autres régions lombardes : les duchés de Spolète et de Bénévent. Le premier, cependant, se soumit bientôt aux Carolingiens, mais Bénévent, protégé par les montagnes des Abruzzes du nord, put continuer à conserver son indépendance. La guerre avec Bénévent est présentée par Einhard d'une manière extrêmement simplifiée, et il essaie de tout réduire à la peur d'Arechis pour Karl. En réalité, la guerre fut longue : les Benevente se révoltèrent sans cesse, et les Francs durent à nouveau faire des campagnes punitives dans leur pays. Le duc de Bénévent Arechis était marié à la fille du roi Desiderius et se considérait donc comme le seul représentant héréditaire des droits des Lombards. D'autant plus que du temps où le prince Adelchis, fils de Desiderius, se trouva le bienvenu à Constantinople et y reçut le rang de patricien, les relations de Bénévent avec l'empire et la formation d'un parti byzantin y étaient très naturelles. Charles, qui connaissait les plans de son rival du pape Hadrien, a décidé de soumettre les restes du royaume de Desiderius. Fin 786, Charles s'opposa au duc de Bénévent Arechis. Au début de 787, Charles était déjà à Rome. Arechis, qui n'a pas reçu le soutien opportun des alliés, a envoyé son fils aîné Rumold à Karl en otage avec de riches cadeaux afin d'arrêter l'attaque de Karl sur son territoire. Karl, ayant pris un otage, franchit néanmoins la frontière et arriva à Capoue. Arechis, se retirant à Salerne, a envoyé Charles comme otages son deuxième fils Grimoald et douze nobles Lombards, promettant une obéissance complète. Charles, ayant donné son accord, relâcha le fils aîné du duc à Bénévent, envoyant avec lui ses délégués prêter serment à Arechis et à son peuple, moyennant le paiement d'un tribut annuel. Cependant, dès que Charles a quitté l'Italie, Arechis a rompu son serment et a conclu une alliance avec Byzance pour mener de nouvelles hostilités contre Charles. Dans le même temps, Adalgiz, le fils de Desiderius, se rend avec son armée à Trévise et à Ravenne pour soumettre le nord du pays. Toutes les réalisations militaires de Charles ont été compromises. Mais le 26 août 787, Arechis mourut subitement, et son fils Rumold mourut un mois avant cela, ce qui entraîna l'échec de l'accord byzantin-Bénévent, d'autant plus que le deuxième fils d'Arechis, Grimoald, était toujours retenu en otage par Charles.
Adalgiz, le fils de Desiderius, après la mort de ses partisans, a tenté de poursuivre les actions commencées contre Charles, prenant contact avec Ataberga, la veuve d'Arechis, et lançant une attaque contre les possessions papales. En réponse, Karl, malgré les appels à l'aide du pape, à savoir retourner en Italie et continuer à tenir Grimoald en otage, fit le contraire. Il n'est pas allé en Italie et a libéré Grimoald. Par la suite, cette action a aidé Charles, car lorsque la guerre avec Byzance a commencé, Grimoald a soutenu l'armée franque, ce qui a conduit Charles à la victoire, à la suite de laquelle il a pris possession de l'Istrie.
Soumission de la Bavière
Après s'être dénoué les mains en Saxe et en Italie, Charles se tourna contre le duc de Bavière de Tassilon, ancien allié des Lombards. En réalité, il n'y a pas eu de guerre bavaroise. Charles, depuis qu'il était au courant du pape pour la conspiration du Tassilon, a soumis la Bavière par le biais de négociations diplomatiques (soutenues par certaines actions militaires), au cours desquelles une situation désespérée s'est produite pour Tassilon, le forçant à se soumettre. En 787, Charles encercla la Bavière de trois côtés avec des troupes et exigea que Tassilon renouvelle les obligations vassales qui lui avaient été confiées une fois par Pépin. Tassilon a été contraint de comparaître devant le roi franc et de lui prêter un second serment d'allégeance. Le duché fut solennellement transféré à Charles, qui le céda au profit de Tassilon, mais toute l'aristocratie bavaroise prêta serment d'allégeance au roi. Mais Tassilon, que sa femme Luitberg, la fille de Desiderius, incite constamment à la trahison, conclut une alliance avec les Avars de Pannonie, ce qui menace de bouleverser l'équilibre qui se développe à l'ouest.
Un an plus tard, en 788, à la Diète générale d'Ingelheim, Tassilon est contraint d'avouer avoir tissé des intrigues avec sa femme et condamné à mort, que Charles remplace par l'emprisonnement dans un monastère de Jumièges. Le même sort était réservé à sa femme et à ses enfants. Quant au duché, Charles l'engloba dans le royaume, le divisa en plusieurs comtés, les subordonnant à l'autorité d'un seul préfet, nommant à ce poste son cousin Herold. Dans le même temps, Karl annexa les régions slaves du sud de Carantanie (Horutanie) et de Krajna à son territoire. Mais avant d'entreprendre une pleine occupation, le roi franc expulsa une grande partie de la noblesse bavaroise. Apparemment, Charles eut des difficultés dans le processus d'assujettissement complet du pays, car six ans plus tard (en juin 794), lors de la Diète générale à Francfort, Tassilon fut brièvement libéré du monastère et emmené en ville pour une seconde renonciation à ses prétentions au pouvoir.
Campagne contre les Slaves
En 789, Karl fit une expédition pour défendre les pom-pom girls du Mecklembourg contre la tribu slave de Lutichi (Wiltsy). Les Francs construisirent deux ponts sur l'Elbe, traversèrent le fleuve et, avec le soutien des alliés (Saxons, Frisons, Udrits et Serbes de Lusace), portèrent un coup terrible aux Lyutichi. Bien que, selon les chroniques, ils se soient battus avec acharnement, ils n'ont pas pu résister aux énormes forces des alliés. Karl a conduit les Wilts à la rivière Pena, détruisant tout sur son passage. Leur capitale capitula et le prince Dragovit se soumet et donna des otages.
Guerre avec les Avars
Commença alors une guerre difficile contre les Avars, qui dura de 791 à 803. Selon Eingard, c'était le plus important et le plus féroce après le Saxon et demandait de très grosses dépenses aux francs. Les Avars étaient en alliance avec Tassilon. En lui promettant d'envahir les Francs en 788, ils remplissent leur obligation (ignorant le renversement du Tassilon) en déclenchant une guerre contre Charles. À l'été 791, l'armée de Charles envahit le pays avar de trois manières différentes et atteignit les bois de Vienne, où se trouvaient leurs principales fortifications. Ayant quitté leur camp, les Avars s'enfuirent à l'intérieur des terres, les Francs les poursuivirent jusqu'au confluent de la rivière Rab dans le Danube. La poursuite de la poursuite a cessé en raison de la mort massive de chevaux. L'armée revint à Ratisbonne chargée d'un grand butin.
Une nouvelle révolte des Saxons
En 792, le fils de Karl par sa première épouse Himiltrude Pepin, surnommée le Bossu, en apprenant qu'il a été retiré de l'héritage, a soulevé une rébellion. Il a réussi à attirer plusieurs comtés avec lui, mais a été vaincu. Karl a passé toute l'année à Ratisbonne, mais d'une nouvelle campagne contre les Avars, il a été distrait par la révolte saxonne. Sa portée dépassa même les événements de 785. Les Saxons ont été rejoints par les Frisons et les Slaves. Des temples ont été détruits partout et des garnisons franques ont été tuées. À l'été 794, Karl et son fils Karl le Jeune, à la tête de deux armées, envahissent la Saxe. Se voyant encerclés, les masses des Saxons se précipitèrent sur Eresbourg, prêtèrent serment d'allégeance, donnèrent des otages et revinrent au christianisme. A l'automne 795, le roi, avec une armée puissante, dévastait à nouveau la Saxe et atteignit le bas Elbe. Apprenant que les Saxons avaient tué son allié, le prince fut encouragé, il soumet le pays à une dévastation secondaire, prit jusqu'à 7000 otages et retourna à l'Etat franc. Dès son départ, les Saxons se révoltèrent en Nordalbingia, un pays au nord de l'Elbe. Karl a dû se retourner contre eux.
Continuation de la guerre avec les Avars
La guerre avec les Avars se poursuivit avec plus ou moins de succès. Le roi franc avait besoin de mobiliser toutes ses forces et de conclure une alliance avec les Slaves du sud (comme auparavant dans la guerre avec les Saxons) pour résister aux nomades. Les Annales du Royaume des Francs (entrée 796) décrivent ainsi l'un des événements les plus importants de cette guerre : les Francs, menés par le jeune fils de Karl Pépin, en alliance avec le prince horutan Voynomir, reprirent la guerre contre les Avars, s'empara de la "capitale" de l'Anneau Khagans, qui était en fait un gigantesque camp retranché, situé au confluent du Danube et de la Tisza, et s'y empara d'un riche butin, emporté vers l'Etat franc par un train de quinze énormes charrettes. Après cette campagne, selon Eingard, pas un seul habitant de Pannonie n'a survécu, et l'endroit où se trouvait la résidence du Khagan n'a même pas conservé de traces d'activité humaine. Le terrible peuple d'Avars, qui pendant plusieurs siècles a terrifié toute l'Europe de l'Est, a cessé d'exister. La bande de terre qui s'étendait de l'Aisne au Wienerwald fut progressivement conquise par les Francs et transformée en pays oriental (Ost-mark, l'ancêtre de l'Autriche).
Continuation de la guerre avec les Saxons
Pendant ce temps, Karl et ses fils, Karl le Jeune et Louis, se sont battus en Saxe. L'armée passa au peigne fin tout le pays jusqu'en Nordalbingia, puis revint à Aix-la-Chapelle avec des otages et un gros butin. À la fin de l'été et au début de l'automne, Karl organisa une grande expédition en Saxe par terre et par eau ; dévastant tout sur son passage, il s'est approché de Nordalbingia. De tous les côtés du pays, les Saxons et les Frisons accourent vers lui, lui donnant un grand nombre d'otages. Au cours de l'expédition, Charles réinstalla les Francs en Saxe et emmena de nombreux Saxons avec lui en France. Il passa tout l'hiver ici à s'occuper des affaires saxonnes. Au printemps 798, il dévasta complètement le territoire entre la Weser et l'Elbe. Dans le même temps, les Francs alliés ont été encouragés à vaincre les Nordalbings à Sventana, tuant jusqu'à 4 000 Saxons. Après cela, Karl a pu retourner en France, conduisant à un millier et demi de prisonniers. À l'été 799, le roi, avec ses fils, partit pour la dernière campagne contre les Saxons. Lui-même est resté à Paderborn. Pendant ce temps, Karl le Jeune acheva la pacification de la Nordalbingie. Comme à son habitude, Charles rentra en France, emmenant avec lui de nombreux Saxons avec leurs femmes et leurs enfants pour s'installer à l'intérieur de l'État. Mais Charlemagne peut commencer à préparer l'avenir en publiant en 797 un nouveau « capitulaire saxon », qui annule le régime de terreur instauré par le capitulaire en 785, et introduit l'égalité progressive des Saxons et des Francs devant la loi. À Minden, Osnabrück, Verdun, Brême, Paderborn, Münster et Hildesheim, des sièges épiscopaux saxons ont été établis, appartenant en partie au diocèse de Cologne, en partie au diocèse de Mayence.
Charlemagne - Empereur d'Occident
À l'automne 800, Charles se rendit à Rome, où les nobles romains conspirèrent contre le pape Léon III, l'arrêtant lors d'une procession solennelle. Menaçant de cécité, ils ont exigé que Leo renonce à sa dignité, mais le pape a réussi à s'échapper de la ville et à se rendre à Paderborn, où se trouvait Karl à cette époque. Sur les conseils d'Alcuin, Karl promit son soutien à son père. Charles a passé près de six mois à Rome, réglant les querelles entre le pape et la noblesse locale. Le 25 décembre, il a écouté la messe festive dans la cathédrale Saint-Pierre. Soudain, le pape s'approcha de son hôte et lui plaça la couronne impériale sur la tête. Tous les Francs et les Romains qui étaient dans la cathédrale s'exclamèrent à l'unisson : « Vive et victorieux Karl August, grand empereur romain couronné par Dieu et pacificateur. Bien que tout cela n'ait pas été une surprise pour Karl, selon Eingard, il a d'abord feint d'être mécontent de l'acte "non autorisé" du pape. Charles a même soutenu que s'il avait su à l'avance les intentions de Léon III, il ne serait pas allé à l'église ce jour-là, quel que soit Noël. Il l'a fait, apparemment, pour calmer la cour de Constantinople. La haine des empereurs romains, qui survint immédiatement, Karl, cependant, la supporta avec une grande patience. Finalement, les empereurs byzantins durent reconnaître le nouveau titre de souverain des Francs. Dans cette situation, une alliance matrimoniale se dessina entre la reine byzantine Irina et Charles, afin d'unir ainsi l'Orient et l'Occident. Les ambassadeurs occidentaux devaient arriver à Constantinople à l'automne 802 pour discuter de cette question, mais le même automne, le 21 octobre, un coup d'État de palais a eu lieu dans la capitale byzantine, privant Irina du pouvoir. Le trône était occupé par Nicéphore Ier, qui refusa de reconnaître Charles comme empereur. En réponse, Karl, après une guerre assez longue (806-810), s'empara de Venise et de la Dalmatie, qui étaient nominalement incluses dans Byzance, mais furent affaiblies en raison de conflits internes et, grâce à une alliance avec le calife de Bagdad al-Amin, força Nicéphore, qui menait une guerre en Bulgarie, se rend au 810 pour des négociations de paix. 12 ans après le début du conflit, l'empereur byzantin Michel Ier, successeur de Nicéphore mort en Bulgarie, reconnut formellement le nouveau titre d'empereur, comptant sur le soutien de l'Occident dans la lutte contre la Bulgarie, qui battit l'armée byzantine. en 811. Pour la reconnaissance de son titre impérial, Charles céda Venise et la Dalmatie à Michel Ier. Cependant, la légalité de la reconnaissance de ce titre a été contestée par les Byzantins aux XIIe et XIIIe siècles.
Cependant, Charles lui-même attacha une importance considérable à son nouveau titre, exigea un nouveau serment après le couronnement (802) et souligna sa position d'administrateur nommé par Dieu pour le bien-être du peuple et de l'église. Le titre complet de Charles était : Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus pacificus imperator Romanum imperium gubernans qui et per misericordiam dei rex Francorum atque Langobardorum et les Lombards ").
Fin de la guerre avec les Saxons et premiers affrontements avec les Danois
En 804, l'épuisante guerre des Saxons prit fin. Karl est arrivé à Gollenstedt et a réinstallé 10 000 familles saxonnes de Nordalbingia vers les régions intérieures de l'État. La Nordalbingia déserte a été livrée aux acclamations. Au tournant des VIII-IX siècles. Pour la première fois, les Francs rencontrèrent directement les Danois (Danes). En 804, le nouveau roi du Danemark méridional (Jutland) - Godfred, qui prit la place de Siegfried, décédé vers 800, rassembla une armée et une flotte à Sliestorp (comme Hedeby était appelé dans les sources latins), à la frontière avec la Saxe, dans l'intention d'attaquer les Francs. Les opposants négociaient, dont le résultat est inconnu, mais probablement direct, l'affrontement a été évité. Godfred fut plus actif en 808. Il attaqua la terre des encouragés, qui s'étaient alliés avec Charlemagne, et la ravagea si bien que les encouragés furent contraints de lui demander la paix et de lui promettre un tribut. Au cours de la campagne, Godfred anéantit l'un des centres les plus importants du commerce de la Baltique occidentale, Rörik (Mecklembourg ou Vieux Lübeck à l'embouchure de la rivière Trave), et en fit sortir artisans et marchands à Hedeby, dont la position se renforça grâce à cette. Immédiatement après la campagne, selon les Annales du royaume des Francs, il construisit des fortifications à la frontière avec les Saxons le long de la rive nord du fleuve. Eider : un rempart "de l'océan occidental à la baie orientale menant à la mer Baltique", avec une porte pour permettre le passage des cavaliers et des charrettes. De leur côté, les Francs de Nordalbingia, encore pris aux pom-pom girls, construisirent plusieurs forteresses ; ainsi la marque de frontière danoise a été lancée.
La lutte pour les routes et les centres commerciaux et pour l'influence sur le commerce mer du Nord-Baltique explique également l'action célèbre suivante de Godfred : en 810 avec une grande flotte il a navigué le long de la côte de la Frise, remportant des victoires, et est revenu, après avoir reçu une rançon de 100 livres d'argent. Inquiet, Charlemagne rassembla une flotte pour une campagne au Danemark, mais le besoin d'une campagne disparut soudainement : la même année, Godfred fut tué par son guerrier, et le pouvoir tomba entre les mains de son neveu Hemming. Loin d'être aussi belliqueux, Hemming accepta des négociations de paix et conclut en 811 un traité confirmant l'inviolabilité de la frontière sud du Danemark, le long du fleuve. Eider.
raids vikings
Dans les dernières années du règne de Charles, un nouveau danger plane sur le royaume : les raids des Vikings. Dès la fin de 799, leurs voiliers font leur apparition au large de la Vendée et débarquent des bandes de braqueurs. Et en 810, le danger approchait la distance de plusieurs jours de traversées à cheval depuis Aix-la-Chapelle, juste au moment où Charles était occupé en Nordalbingia à fortifier la marque danoise, dans la lutte contre les Danois agités. Pour repousser les raids normands, Charles ordonna la construction de navires sur les fleuves qui traversaient la Gaule et le nord de l'Allemagne. Dans tous les ports et estuaires des rivières navigables, sur son ordre, des quais de navires ont été aménagés et des patrouilleurs ont été postés afin d'empêcher l'invasion de l'ennemi.
Politique intérieure
Charlemagne et les papes Gélase I et Grégoire I. Miniature du livre de prières du roi Charles II le Chauve.
Avec ses guerres heureuses, Charles repoussa au loin les frontières de l'État franc. Tout aussi inlassablement, pénétrant dans toutes les petites choses, il se souciait d'améliorer la structure de l'État, du développement matériel et spirituel de son État. Il augmenta considérablement sa puissance militaire en rationalisant la collecte des milices, et renforça les frontières par l'organisation militaire des marques gouvernées par les margraves. Il détruisit le pouvoir des ducs du peuple, ce qui lui parut dangereux pour le roi. Les districts individuels étaient dirigés par des comtes, qui concentraient entre leurs mains les fonctions administratives, financières, militaires et en partie judiciaires. Deux fois par an - à la fin du printemps ou au début de l'été et en automne - des seimas d'État se réunissaient autour de l'empereur lui-même ; tous les peuples libres pouvaient assister au printemps, et seuls les « conseillers » les plus importants du souverain, c'est-à-dire les gens du cercle de la cour, de la haute administration et du haut clergé, étaient invités à l'automne. Lors de la réunion d'automne, diverses questions de la vie de l'État ont été discutées et des décisions ont été prises à leur sujet, qui ont reçu la forme de ce qu'on appelle des capitulaires. A la réunion de printemps, les capitulaires se présentèrent à l'approbation de l'assemblée ; ici, le souverain recevait des informations de ceux qui s'étaient réunis sur l'état de l'administration, la situation et les besoins d'une localité particulière.
Karl se souciait beaucoup de l'agriculture et de la gestion des domaines du palais ; de lui restaient des décisions détaillées et détaillées concernant cette administration (Capitulare de villis). Sur ordre de Charles, les marais ont été asséchés, les forêts ont été abattues, des monastères et des villes ont été construits, ainsi que de magnifiques palais et églises (par exemple, à Aix-la-Chapelle, Ingelheim). L'aménagement du canal entre Rednitz et Altmühl, conçu en 793, qui aurait relié le Rhin et le Danube, la mer du Nord et la mer Noire, est resté inachevé.
Tout en contribuant énergiquement à la propagation du christianisme, en patronnant le clergé et en établissant les dîmes pour lui, étant dans les meilleures relations avec le pape, Charles conservait cependant les pleins pouvoirs dans l'administration de l'église : il nommait les évêques et les abbés, convoquait des conciles spirituels, décrétait des décisions au Seimas concernant les affaires ecclésiastiques. Karl lui-même était diligent dans les sciences ; chargé de rédiger une grammaire de la langue nationale, dans laquelle il établit les noms francs des mois et des vents ; ordonné de recueillir des chansons folkloriques. Il s'entoure de scientifiques (Alcuin, Paul le Diacre, Eingard, Raban Mavr, Théodulf) et, utilisant leurs conseils et leur aide, cherche à éduquer le clergé et le peuple. Il s'occupa notamment de l'organisation des écoles dans les églises et les monastères ; à sa cour, il établit une sorte d'académie pour l'éducation de ses enfants, ainsi que des courtisans et de leurs fils.
En 794, sur le site de la station thermale des Celtes et des Romains à Aix-la-Chapelle, Charles commença la construction d'un immense complexe palatial, achevé en 798. Devenue d'abord la résidence d'hiver de Charles, Aix-la-Chapelle devint progressivement une résidence permanente, et de 807 - la capitale permanente de l'empire. Karl a renforcé le denier, qui a commencé à peser 1,7 gramme. La renommée de Karl s'étendit bien au-delà de son domaine ; des ambassades de pays étrangers sont souvent apparues à sa cour, comme l'ambassade de Harun al-Rashid en 798.
En février 806, Charles lègue le partage de l'empire entre ses trois fils. L'Aquitaine et la Bourgogne devaient être retirées à Louis, l'Italie et l'Allemagne au sud du Danube à Pépin, et la Neustrie, l'Austrasie et l'Allemagne au nord du Danube à Charles le Jeune. Cependant, en 810 Pepin est mort et en 811 - Karl Young. Peu de temps avant sa mort, en 813, Charles convoqua Louis, roi d'Aquitaine, son seul fils survivant d'Hildegarde, et, ayant convoqué une assemblée solennelle des nobles Francs de tout le royaume, le 11 septembre, le nomma, d'un commun accord, comme son co-dirigeant et héritier, puis lui mit la couronne sur la tête et ordonna désormais de l'appeler empereur et Auguste. Peu de temps après, foudroyé d'une forte fièvre, il se coucha. Début janvier, la pleurésie se joignit à la fièvre, et le 28 janvier 814, l'empereur mourut. Il a été enterré dans l'église du palais d'Aix-la-Chapelle construite par lui. Sur l'insistance de Frédéric Ier Barberousse, l'antipape Pascal III, qui fut installé par lui, canonisa Charlemagne.
Épouses et enfants
Depuis 768 - Himiltrude (ou Gimiltrude; Himiltrude), fille de Devum I (Devum I), comte de Bourgogne. Divorce.
Pépin le Bossu (Pépin le Bossu ; 769/770 - 811). En 792, il participe à un complot contre son père, mais sans succès. Il a été emprisonné par son père dans un monastère.
Rothais, (784 -?)
à partir de 770 - Desiderata (Désirée, 747 - 776), fille de Desiderius (Didier), roi des Lombards. Divorce en 771
à partir de 771 - Hildegard Winzgau (ou Hildegard; Hidegarde de Vintzgau, 758 - 30 avril 783), fille de Gerold I (Gérold I), comte de Winzgau.
Charles le Jeune (Charles, 772 - 4 décembre 811), duc d'Ingelm.
Adélaïde (Adélaïde, 773 - 774). Elle est morte en bas âge.
Rotrude (Rothrude, 775 - 6 juin 810). Elle avait un lien avec le comte Rorgon (Rorikon) I (? - 839/840).
Pépin (Pépin, 777 - 8 juin 810), roi d'Italie (781-810).
Lothaire (Lotaire, 778 - 779). Jumeau avec Louis, mort enfant.
Louis Ier le Pieux (Louis Ier le Pieux, août 778 - 20 juin 840), empereur romain germanique (813-840), roi de tous les Francs (814-840), roi d'Aquitaine (781-813), roi d'Alemannia (833-840) ).
Berthe (Berthe, 779 - 823). Elle épousa le comte Engelbert (750-814).
Gisela (Gisèle, 781 - 808). Elle n'était pas mariée.
Hildegarde (Hildegarde, 782 - 783). Elle est morte en bas âge.
d'octobre 783 - Fastrade (Fastrade, 765 - 10 octobre 794), fille du comte franc oriental Radolf.
Tétrade (Tétrade, 785 - 853), Abbesse Argentiel.
Hiltrude (787 -?), Abbesse de Farmautier.
de 794 - Liutgard (Liutgadre, 776 - 4 juin 800).
Emma (Emme, ? - 837).
Rothilde (? - 852).
de 808 - Gerswinda Saxon (Gerswinde de Saxe, 782 - 834).
Adaltrude.
Outre six épouses, trois amants de Charlemagne et plusieurs enfants bâtards sont connus.
Maltegarde.
Rotilda (Rudhild) (790 - 852), Abbesse de Farmautier.
Régina (Régine).
Drogon (17 juin 801 - 8 décembre 855), évêque de Metz.
Hugues (802 - 14 juin 844), abbé de Saint Quentin.
Adalind (Adalinde).
Théodoric (807 - 818).
Il n'y a pas d'illusions - il n'y a pas de déceptions.
proverbe japonais
La déception en tant que trait de personnalité - la tendance à s'inquiéter des attentes, des espoirs, des rêves non satisfaits et de l'effondrement de la foi en quelqu'un ou en quelque chose.
La déception est le goût amer des idéalisations fondues. La vie d'un imbécile est une collection de déceptions. Il semblerait qu'il y ait un nombre incalculable de visages et de couleurs au carnaval de la vie, mais l'algorithme de la désillusion dans la vie est banalement simple. Une personne se fixe le mauvais objectif principal ou idéalise fortement quelque chose. Sacrifiant et négligeant beaucoup, il ne va pas à son but ou ne brûle pas, désire passionnément posséder l'objet d'idéalisation, espère pour lui, attend de lui quelque chose de bon et de brillant, croit en lui. Dans le premier cas, on observe une perte insensée de temps, d'énergie et de force mentale pour avancer vers quelque chose qui n'équivaut pas à son bonheur. Dans le second, ce dont les lois de l'univers sont extrêmement détestées, c'est une violation de l'état d'équilibre. Tous les écarts, excès et distorsions excitent les forces d'équilibrage, et ils punissent une personne pour des idéalisations assises dans son esprit.
La déception est les délices d'un esprit fantasmé et idéalisé. La simplicité ne déçoit pas. Si une personne attache une importance excessive à la nourriture, au sexe, à l'argent, aux biens matériels, les forces d'équilibre tendent à la ramener à un état d'équilibre. Amitié idéalisée - trahison d'amis, sexe idéalisé - vivre impuissant, voiture idéalisée, appartement, argent - pas de problème, l'avoir, mais seulement sans santé et seul. La déception s'empare de la personne. Dans sa jeunesse, la personne déraisonnable suit une chaîne de déceptions. Il a rempli les bosses, guéri le traumatisme mental et est allé chercher le même râteau. Igor Guberman notait avec justesse : « Pour les joies des sentiments amoureux, une fois payés d'une douleur aiguë, nous avons tellement peur des nouveaux loisirs que nous portons un préservatif dans nos âmes ». À l'âge adulte, lorsqu'il n'est pas possible de changer la situation, la déception devient un trait de personnalité manifeste.
Ne pas atteindre votre objectif est lourd de déceptions sévères. Non, pour se fixer un objectif spirituel - cultiver la gentillesse et l'attention envers lui-même et envers les enfants, un homme considère le but principal de la vie, par exemple, construire et aménager une maison. Il travaille de longues années, comme un galérien, et finit enfin de construire la maison. Puis il habite pour l'équiper, puis le meubler en mobilier. Lors de la construction d'une maison, il cherchait à prouver à lui-même et à ceux qui l'entouraient son importance et sa signification. Le but d'un autre vient de l'extérieur - sous l'influence de stéréotypes, de fausses croyances, de croyances et de l'influence des autres. Il y a une maison, mais il n'y avait aucun sentiment de bonheur et ne le sera pas. Les gens font des projets grandioses, rêvent, forment des idéalisations dans leur esprit, puis, ayant atteint l'objectif «désiré», ils comprennent qu'ils ont reçu un faux, un substitut de ce dont ils rêvaient. Ils commencent à se rendre compte que l'effort déployé ne valait pas le temps et l'énergie dépensés. Ayant abandonné la vie sur cette maison qui demande sans cesse réparations et soucis, une personne en fin de vie connaîtra une déception. Vieux, faible, inutile à personne, il vivra sa vie dans cette maison, si les enfants, qui ne ressentent pas de bons sentiments pour lui, ne l'envoient pas encore plus tôt dans une maison de retraite. Le bonheur est spirituel, vous ne le trouverez pas dans les sous-sols d'une maison matérielle.
Une personne obtient la plus grande profondeur de déception de ce à quoi elle est trop attachée. Une jeune famille me présente leur fils de cinq ans et ma mère dit : « Dès que notre fils est né, notre vie était finie. Maintenant, nous ne vivons que pour lui." L'enfant entend cela, et la pensée s'incruste dans son esprit comme une écharde : « Je suis le principal de la famille. Ma vie est la plus grande valeur." En grandissant, il s'affirme dans l'opinion qu'il est le Centre de l'Univers, que le soleil ne se lèverait pas le matin, quand je n'étais pas là. Un égoïste éponge grandit, pas habitué à penser et à se soucier de quelqu'un. Il arrive un moment où il crée sa famille. La mère, qui lui a consacré sa vie, estime que puisqu'elle a vécu pour son fils, il serait juste qu'il vive pour elle, ou au moins prenne soin d'elle. Mais le fils n'a même pas la moindre idée de pensées aussi absurdes. Dans le meilleur des cas, il vous félicitera pour votre anniversaire et le 8 mars. Maman est terriblement déçue et déprimée. La déception devient désormais la marque de sa personnalité. Il y a des millions de ces femmes mécontentes de plus de quarante ans.
Souvent, ils comprennent la raison de leur déception face à la vie, mais rien ne peut être réparé. La vie est écrite en blanc, les années sont révolues, la vieille tête mais sur les jeunes épaules. Quelle était la raison de la déception ? Eh bien, il s'avère que l'enfant n'a pas besoin d'être aimé? C'est nécessaire, comme c'est nécessaire. Mais dans le contexte de l'éducation des enfants, l'objectif principal doit être fixé non pas comme des objectifs matériels, mais spirituels. Le bonheur est spirituel. Trouver le spirituel dans la matière, c'est comme avoir de la terre dans l'espoir d'avoir du fer pour le corps. L'objectif matériel de l'enfant est la santé, l'éducation, le bien-être matériel et un bon conjoint. Une femme, selon sa nature, est encline à vivre pour les enfants, à s'occuper d'eux. Mais l'éducation ne consiste pas seulement à se nourrir, à boire et à s'endormir. L'éducation est le développement des mérites chez un enfant, c'est-à-dire des qualités positives d'une personne; c'est l'art de donner autant de goût spirituel au bonheur que possible. Le fils doit comprendre le goût du bonheur du sourire reconnaissant d'un être cher pour les soins qui lui sont témoignés.
Au lieu de prétendre qu'il est le nombril de la Terre, vous devez enseigner au garçon la responsabilité et le soin des autres. Par exemple, une mère dit à un enfant de cinq ans : « J'oublie toujours de me laver les mains après une promenade. Peux-tu me rappeler quand nous rentrerons à la maison que nous devons laver nos stylos ?" Pour un enfant, c'est un jeu et, en même temps, un facteur de responsabilité et d'attention - deux avantages incontestables d'une personnalité. En inculquant progressivement à son fils le respect de ses intérêts, de ses préoccupations et de ses soucis, la mère libérera dans la vie non pas un égoïste invétéré et égoïste, mais un homme responsable, sûr de lui et attentionné qui ne quittera jamais sa mère.
Quelques heures avant sa mort, le journaliste a rencontré l'oligarque V. Berezovsky. Devant lui était assis un homme profondément malheureux et déçu qui n'avait jamais été béni avec des milliards de dollars. Voici des extraits de l'entretien : - La Russie vous manque ?- Retourner en Russie... Je ne veux rien de plus que retourner en Russie. Lorsqu'une affaire pénale a même été ouverte, j'ai voulu retourner en Russie. Ils ont même commencé une affaire criminelle ! Seulement sur les conseils d'Elena Bonner est resté. La principale chose que j'ai sous-estimée, c'est que la Russie m'est si chère que je ne peux pas être un émigré. J'ai changé beaucoup de mes évaluations. Y compris lui-même. Quant à ce qu'est la Russie et ce qu'est l'Occident. J'ai imaginé de manière absolument idéaliste la possibilité de construire une Russie démocratique. Et il imaginait de façon idéaliste ce qu'est la démocratie au centre de l'Europe. Il a sous-estimé l'inertie de la Russie et largement surestimé l'Occident. Et cela s'est fait progressivement. J'ai changé mon idée du chemin de la Russie... Je n'aurais pas dû quitter la Russie... - Si vous restiez en Russie, vous seriez en prison maintenant. Veux-tu çà?- Maintenant, en repensant à la façon dont j'ai vécu ces années à Londres... Berezovsky regarda lentement devant lui, puis pressa sa main contre sa poitrine - elle tremblait. Il se tourna vers moi et me regarda dans les yeux pendant un long moment. Enfin dit: "Je n'ai pas de réponse à cette question maintenant... Khodorkovski... s'est sauvé." Puis Berezovsky a regardé ses pieds, puis m'a rapidement jeté un coup d'œil et a commencé à parler rapidement, comme s'il cherchait des excuses.: « Cela ne veut pas dire que je me suis perdu. Mais je suis passé par beaucoup plus de réévaluations, de déceptions. Khodorkovski est encore plus petit. J'ai... perdu mon sens. " - La vie?- Sens de la vie. Je ne veux pas faire de politique maintenant. - Et que faire?- Je ne sais pas quoi faire. J'ai 67 ans. Et je ne sais pas quoi faire ensuite."
Petr Kovalev 2013
Karl Moor est un héros typique de Stürmer, un "génie orageux", un solitaire qui a décidé de se rebeller contre toute la société. Avec colère, il stigmatise son âge honteux : « Bon sang, cet âge frêle de castrats, capable seulement de ronger les exploits d'autrefois. Karl Moor a été diffamé avec de fausses lettres par son propre frère Franz. Poussé au désespoir, Karl devient le chef des braqueurs et entame une lutte contre l'ordre haï, essayant seul de rétablir la justice. Son idéal est la Grèce républicaine et Rome, héros de Plutarque pleins de valeur civique.
Cependant, la nature de Karl Moor est pleine de contrastes, de contradictions internes. L'émotionnel l'emporte en lui sur le rationnel : la malédiction de son père le pousse à manifester ouvertement. Avec l'effondrement de l'harmonie familiale, l'harmonie du monde entier s'effondre pour lui, il est prêt à retourner sa haine contre toute la race humaine : "Oh, je voudrais empoisonner l'océan pour que les gens boivent la mort à toutes les sources !" Schiller montre comment le conflit de Karl avec lui-même et avec le reste des voleurs augmente progressivement. Karl ne vole pas, il se venge. Mais peu à peu le héros se rend compte avec horreur que des innocents deviennent involontairement victimes de sa vengeance (ne serait-ce qu'aux mains de ses charges) : « Mais l'infanticide ? Meurtre de femmes ? Tuer les malades ? Oh, comme ces atrocités m'oppressent ! " Devenu la cause involontaire de la mort de son père, en tuant désespérément sa bien-aimée Amalia von Edelreich, Karl décide en finale de se rendre volontairement aux autorités. Le héros ne renonce pas à l'idée même de justice, mais à la voie qu'il a choisie. Schiller démystifie la rébellion individualiste, montre sa futilité.
Composition
Le grand Goethe a dit qu'avec la mort de Schiller, il avait perdu la moitié de lui-même. Ces deux écrivains des Lumières sont toujours proches - même après la mort : leurs monuments se dressent devant le théâtre de Weimar, et ils sont enterrés non loin l'un de l'autre. Goethe et Schiller ont relancé la ballade et se sont affrontés dans ce genre. Les ballades de Schiller sont pleines de mystère, de danger, d'inévitabilité du destin et parfois de cruauté. Le moment charnière de l'intrigue est l'épreuve du héros, l'épreuve de son courage chevaleresque. Chez Schiller, comme chez Goethe, un motif transversal est le thème de la liberté humaine, l'idée d'égalité des droits pour tous les peuples du monde, l'affirmation du droit à l'indépendance de l'État et des lois équitables. Dans les drames de Schiller Marie Stuart (1880), La Vierge d'Orléans (1801), Guillaume Tell (1804), l'idée d'égalité et de liberté est centrale.
Schiller a félicité la Grande Révolution française, y voyant une libération de la violence, mais la brutalité des actions révolutionnaires l'a éloigné de la république « libre », il développe son propre programme d'amélioration humaine, où il prêche l'idée de paix et l'harmonie au lieu de bouleversements révolutionnaires. Les écrivains sont souvent appelés les bergers spirituels de l'humanité. C'est ce message qui a attiré mon attention lorsque je pensais au contenu de la ballade "Glove". On avait l'impression que l'auteur avait une conversation avec vous, comme s'il se proposait d'"essayer" les événements d'une histoire littéraire pour le lecteur. La ballade est basée sur une légende historique sur des événements qui auraient eu lieu au XIVe siècle en France, sous le règne du roi François. Mais l'histoire de la prescription ancienne est intéressante et pertinente pour nous, contemporains. Quand vous lisez une ballade, vous avez l'impression d'être vous-même spectateur de la pièce, vous êtes mentalement transporté dans ces temps lointains, vous prenez une chaise dans l'arène de la ménagerie royale et observez les événements, les gens...
Partout pour entendre une conversation tranquille, les dames s'éventent avec des éventails, de dignes chevaliers se tiennent à leurs côtés, prêts à exécuter n'importe quel ordre de leur dame de cœur. Voici la beauté Kunigund - fière, inaccessible. Un Delorgue agité est à côté d'elle. Du premier point de vue, il est clair qu'il est amoureux de Kunigund. Et si vous regardez de plus près, nous verrons qu'elle traite le jeune homme avec mépris. Et, malheureusement, l'amour est toujours aveugle...
Déjà la pièce commence. Le geste impérieux du roi - et un lion entre dans l'arène, encore un geste - un tigre apparaît, puis deux léopards. Le roi s'amuse en attendant un dénouement sanglant. Les courtisans attendent la mort avec impatience. Je me sens mal à l'aise... Les bêtes sont des bêtes, elles vivent selon des lois brutales, mais les gens qui aiment la mort... Effrayant ! Et dans l'arène, pendant ce temps, un combat entre les léopards commence. Le public prend vie. Mais le formidable rugissement du roi des bêtes - le lion - et les animaux se calment. Le spectacle semblait terminé. Le public est déçu. Et soudain un gant tombe de la main de la belle Kunigund, tombant directement dans une cage avec des animaux redoutables. Tous les yeux sont rivés sur la dame. À un moment donné, il m'a semblé que si je voyais le menton de la dame se relever fièrement, elle se sentait comme une reine.
Le jeu continue. Comme le roi au début du spectacle, Kunigund fait maintenant un geste autoritaire, envoyant DeLorgue lever son gant. Neal regarde l'action avec tension, horreur. Je veux vraiment que le roi l'arrête, comme le roi des bêtes l'a fait - d'un seul geste ! Non! Il regarde juste. Pendant ce temps, Delorge entre dans la cage, lève son gant. Il se rend à Kunigund, tout le monde le félicite avec enthousiasme, le loue, la fière beauté promet aussi son amour au chevalier. Et il lui jette le gant au visage, dit : "Non merci." La salle se fige, et Delorge quitte la dame. Fin du spectacle.
Je veux rattraper un jeune homme courageux qui a réussi à défendre sa dignité humaine, qui a prouvé son courage. Il a conquis le monde du mal, de la cruauté et a pu en comprendre la véritable essence, sans laquelle hier encore, il ne pouvait imaginer la vie. Une personne commence par une action. Kunigund a fait son acte. Le numéro de Delorgue est délicieux. Le roi n'a pas fait l'acte. Que ferais-je si tu me faisais ça ?
L'une des périodes les plus brillantes de l'histoire des Lumières allemandes est appelée "Storm and Onslaught". Les paroles, le drame et la prose des années 70 du XVIIIe siècle sont marqués par une tension émotionnelle élevée et des motifs rebelles. Le porteur de cette rébellion est le plus souvent le héros solitaire qui déclare la guerre à la société. Le chef d'orchestre de cette direction était le jeune Goethe, créateur de l'image de Prométhée, fier et rebelle, qui défia Zeus lui-même.
Schiller rejoint le mouvement Storm and Onslaught au début des années 1980. Dans l'esprit des idées et de la manière artistique de ce mouvement, le jeune écrivain crée son célèbre drame "Les Voleurs". Le personnage principal de l'œuvre exprime la pensée de Schiller sur les Lumières. « Mettez-moi à la tête d'une armée de camarades comme moi, et l'Allemagne deviendra une république, devant laquelle Rome et Sparte ressembleront à des couvents ! » - proclame Karl Moor. C'est un noble bien né, néanmoins, il néglige également l'élite noble et ceux qui rampent devant elle. Ce n'est pas le domaine familial, ni les privilèges du comte qui lient Karl à la maison parentale, mais l'amour pour son père âgé et pour Amalia, les élèves de leur maison.
L'image de Karl est assez complexe, contrairement à son frère Franz. Franz est décrit par Schiller comme cruel, insidieux, prêt à commettre un crime pour son propre compte. En portant la calomnie à Karl devant son père, il lui a ainsi bloqué le chemin du retour. Puis Karl accepte l'offre des voleurs de devenir leur chef. Le gang de Moore est assez intéressant. Beaucoup de gens connaissent le latin, les jurons français et l'histoire ancienne et récente. Ces hommes sont des étudiants qui n'ont pas terminé leurs études. Karl Moor expulse les méchants de sa société.
Le gang de Karl ne vole pas pour s'enrichir, mais pour se venger. « Mon métier, c'est la punition », dit-il. Karl Moor donne toujours sa part d'argent aux orphelins et aide de jeunes hommes talentueux à s'instruire. Mais si vous avez besoin d'être cruel envers les riches, ou d'enseigner à un idiot qui pousse la justice dans sa direction, Karl n'a aucun regret. Le résultat de cette émeute était prévisible. Karl Moor, en homme intelligent, a également reconnu sa futilité. De plus, la lutte pour la justice qu'il mena s'accompagna de cruauté et de nouveaux crimes. Karl Moor quitte le gang, réalisant la futilité de ses activités. Il admet que tout ce plan n'était qu'excentricité juvénile et idées chimériques. Schiller, comme son héros Karl Moor, refuse également de se rebeller. Et avec cette Composition, il exprime son espoir de trouver des moyens pacifiques d'améliorer l'humanité, l'éducation, l'illumination. Les pensées de Schiller sont toujours d'actualité aujourd'hui, car tout le monde veut améliorer sa vie. C'était, c'est et ce sera à tout moment.
LA VIE DE CARL LE GRAND
(traduit du lat.M.S. Petrova)
Op. dans l'ouvrage : Historiens de l'époque carolingienne, M. ROSSPEN, 1999, p. 7-34.
PROLOGUE DE WALAFRID [STRAB]
On sait que la vie et les actes du plus glorieux empereur Karl décrits [ci-dessous] ont été décrits par Einhard, le plus vénéré de tous ceux qui étaient proches de la cour de l'époque, non seulement en raison de son érudition, mais aussi en raison de son qualités personnelles. La preuve qu'il a présenté la pure vérité est sa participation personnelle à presque tous les événements.
Il est né en Francie orientale, dans le domaine appelé Moingenui. Enfant, il reçut les premiers débuts de l'éducation au monastère de Fulda, sous le patronage du saint martyr Boniface. De là, grâce à ses capacités et à son intelligence exceptionnelles, qui étaient déjà grandes en lui (et plus tard il les a montrées dans toute sa force), plutôt qu'à cause de la noblesse, qu'il n'avait pas moins, Einhard, selon le plus haut ordre, était envoyé par l'abbé Fulda du monastère Waugolf dans le palais de Charles, car Charles lui-même, parmi tous les rois en quête de sagesse, recherchait avec diligence et encourageait les scientifiques à s'engager avec enthousiasme dans la philosophie.
Ainsi, sous la direction de Dieu, Charles, à l'aide d'un éclairage nouveau et jusque-là presque inconnu de ces non-Romains, rendit l'obscurité et, pour ainsi dire, aveugle à toute science, l'étendue du royaume qui lui fut confié par Dieu en un brillant et voyant. Maintenant, au contraire, en raison de l'extinction des sciences, la lumière de la sagesse, de moins en moins vénérée, est de moins en moins rencontrée par la majorité. L'honnêteté, a atteint une telle grandeur et gloire qu'il n'y avait aucun autre de tous les serviteurs de leur majesté royale, à qui le roi le plus sage et le plus puissant de son temps confiera bien des secrets de sa vie privée.
Et vraiment selon le mérite, non seulement au temps de Charles lui-même, mais (ce qui est encore plus surprenant) aussi sous le règne de l'empereur Louis [le Pieux], lorsque l'état des Francs frémit de multiples secousses différentes, fragmentées en de nombreux parties, c'est qu'Einhard, miraculeux, inspiré d'en haut, dans la façon dont il a conservé sa position et, avec la protection de Dieu, s'est sauvé d'abandonner prématurément son titre élevé, qui pour beaucoup était la cause de l'envie et de l'effondrement, et a fait ne pas le commercer dans des dangers mortels.
Nous disons tout cela pour que personne ne doute de ses paroles, et sachant qu'Einhard donne à celui qui l'a élevé, la dette d'amour et au lecteur curieux - la vraie vérité.
Moi, [Valafrid] Strub, j'ai ajouté à ce petit essai les titres et les divisions en chapitres qui me semblent appropriés afin de faciliter l'accès aux événements individuels dont le lecteur a besoin.
LA VIE DE CARL LE GRAND
J'ai décidé de décrire la vie, les actions quotidiennes et, en partie, certaines des actions remarquables de mon seigneur et tuteur, le roi Charles le plus excellent et le plus glorieux à juste titre, afin de décrire, aussi brièvement que possible, ces [événements] qui me sont connus. En composant [cette] œuvre, je [me suis efforcé] de ne pas irriter les gens avec un long exposé d'événements modernes, si seulement on peut éviter de mécontenter la composition moderne de ceux qui agacent les vieilles notes historiques compilées par les plus savants. et des hommes habiles.
Et pourtant je n'ai aucun doute qu'il y a beaucoup de gens dévoués aux loisirs et à la science qui ne croient pas que l'état actuel des choses soit si méprisable et que tout ce qui se passe maintenant est apparemment indigne de tout souvenir et devrait être gardé silencieux et oublié. Au contraire, eux, saisis d'un amour de la longévité, veulent plutôt glorifier les hauts faits d'autrui dans divers ouvrages que de ne rien écrire et de laisser la nouvelle de leur nom disparaître de la mémoire de la postérité. Cependant, je n'ai pas jugé nécessaire de m'abstenir d'écrire un tel essai, car je savais que personne ne pouvait décrire de manière plus fiable les événements auxquels j'étais moi-même présent et que je connais avec certitude pour les avoir vus de mes propres yeux. Et s'ils seront décrits par quelqu'un d'autre ou non, je ne peux pas le savoir.
J'ai décidé d'écrire [ces événements] afin de les transmettre à la postérité, [même s'ils] se mélangent à d'autres écrits [similaires], afin de ne pas permettre les actions brillantes et la vie glorieuse du plus excellent et du plus grand souverain de son époque, ainsi que [ses] actes que les gens de notre temps peuvent difficilement répéter.
Il y avait une autre raison, qui, à mon avis, n'était pas dépourvue de raison, qui seule aurait suffi pour me forcer à écrire, à savoir, les frais de mon éducation, et après que j'ai commencé à tourner à sa cour, l'amitié constante de l'empereur et de ses enfants. Avec cette amitié, il m'a tellement lié à lui-même, faisant de moi un débiteur à la fois dans sa vie et dans la mort, que je pourrais paraître à juste titre et pourrait être appelé ingrat si, m'oubliant, je ne mentionnais pas les faveurs qui m'ont été faites, ainsi comme les actions glorieuses et belles de l'homme, qui était mon bienfaiteur, gardant le silence et ne parlant pas de sa vie, comme s'il n'avait jamais vécu, laissant tout cela sans description ni éloge approprié. Pour les décrire et les présenter, il faut non pas mon talent misérable et modeste, mais presque aucun, mais une éloquence égale à celle de Tulliev.
Voici donc un livre contenant les souvenirs du mari le plus glorieux et le plus grand, dans lequel, à l'exception de ses actes, il n'y a rien d'étonnant, sauf que moi, n'étant pas romain, ignorant le dialecte romain, j'ai imaginé que je peux écrire quelque chose de digne ou d'approprié en latin, et aussi [que] je pourrais tomber dans une telle impudeur que j'ai décidé d'ignorer les paroles de Cicéron du premier livre Conversations tuskulanes, où il parle d'écrivains latins. On y lit ces mots : Quand maman, incapable de gagner la faveur du lecteur, ou de se connecter, ou d'exprimer ses pensées, se met à écrire, lui, ne connaissant pas la mesure, abuse à la fois de [son] loisir et de l'écriture. .
Bien sûr, ce dicton d'un orateur hors pair aurait pu me dissuader d'écrire, si moi, ayant tout réfléchi à l'avance, n'avais pas jugé nécessaire d'éprouver plutôt la condamnation des gens et, ayant écrit tout cela, mettre en danger [la condamnation] de mes modestes capacités, que, m'étant épargné, je n'abandonne pas les souvenirs d'un mari aussi exceptionnel.
(1) On pense que le clan mérovingien, dont les rois francs sont généralement issus, a existé jusqu'au règne de Hild erik, qui, par ordre du pape Etienne, a été déposé, tonsuré et envoyé dans un monastère. Il peut sembler que le clan [mérovingien] ait pris fin sous le règne de Hild erik, mais pendant longtemps il n'y eut aucune vitalité dans le clan, et rien de remarquable, à part un titre royal vide. Le fait est qu'aussi bien la richesse que le pouvoir du roi étaient entre les mains des gouverneurs du palais, qu'on appelait les maisons du major ; tout le pouvoir suprême leur appartenait.
Le roi n'avait rien d'autre à faire que, content du nom royal, s'asseoir sur le trône avec les cheveux longs, la barbe flottante et, prenant l'apparence d'un régnant, écouter les ambassadeurs venant de partout ; quand les ambassadeurs allaient partir, donnez-leur les réponses qu'on lui a conseillé ou même ordonné de donner, comme de son plein gré. En effet, à part le nom royal inutile et le contenu qui lui était donné par faveur de la vie, apparemment par l'intendant du palais, le roi n'avait rien de sa propriété, à l'exception d'un seul domaine et d'un revenu minime ; il y avait une maison et de là il [reçut] pour lui-même quelques serviteurs qui pourvoient aux nécessités et font preuve d'obéissance. Partout où le roi allait, il montait en cabriolet, tiré par des bœufs attelés, conduits par un berger selon la coutume rurale. Il avait donc l'habitude de venir au palais, aux réunions publiques de son peuple, où de nombreuses personnes affluaient chaque année pour le bien de l'État, et il est également rentré chez lui. Et la direction du royaume et tout ce qui devait être réalisé ou arrangé à la maison ou à l'extérieur était assuré par le maire.
(2) Pépin [le Bref] père du roi Charlemagne [le Grand] exerçait déjà ces fonctions comme héréditaires au moment de la démission de Childéric. Pour son père Karl [Martell], qui chassa les tyrans qui s'étaient emparés de toute la Francie, [et] réprima les Sarrasins qui attaquèrent la Gaule après deux grandes batailles (l'une en Aquitaine, près de la ville de Pictavie, l'autre près de Narbonne, au bord de la Birra), remportent cette victoire incontestable qui les oblige à se replier sur l'Espagne. Carl remplit brillamment le même devoir de mairie que lui a laissé le père Pépin.
Les gens avaient l'habitude de montrer l'honneur [de nomination à la mairie] non pas à tout le monde, mais seulement à ceux qui différaient des autres à la fois par la gloire de la famille et le pouvoir de la grandeur. Ainsi Pépin, le père du roi Charles, tenu pendant de nombreuses années en son pouvoir [règle héréditaire], lui a été laissé par son grand-père [Pepin] et son père [Karl Martell] et, avec son plein consentement, a partagé avec son frère Carloman.
Son frère Carloman n'est pas connu pour quelle raison, mais, à ce qu'il paraît, enflammé d'amour pour la vie monastique, il laissa la lourde gestion du royaume éphémère ; Il se retira lui-même à Rome, où, ayant changé d'apparence, il devint moine et avec ses frères qui l'accompagnaient, construisit un monastère sur le mont Sorakt, près de l'église du bienheureux Sylvestre, dans lequel pendant plusieurs années il jouissait de la paix désirée.
Mais quand de Frankia beaucoup des [personnes] les plus nobles sont venus accomplir leurs vœux solennels à Rome, [alors] ils n'ont pas voulu le contourner, une fois leur maître. En interférant avec ses fréquentes visites, ils ont chassé la paix tant désirée [et l'ont forcé] à changer de lieu. Comme il a vu que ce genre d'entassement était un obstacle à ses plans, il a quitté la montagne et s'est retiré dans la province de Sam-nius, au monastère de Saint-Benoît, situé dans le château de Cassino, et là il a terminé le reste de sa vie temporaire de service religieux.
(3) Pépin [Le Bref], par la volonté du Pape, fut nommé roi par l'intendant du palais, puisque pendant quinze ans ou plus il régna seul sur la Francie. Il est mort dans la tribu Pa-Risian d'hydropisie, après la fin de la guerre d'Aquitaine de neuf ans, qui a été menée contre le duc de Waifari, qui l'avait commencée, laissant les enfants de Karl et Carloman, à qui, par volonté divine, le royaume en a hérité. Les Francs, selon leur coutume, ayant convoqué une convention générale, les établirent tous deux comme rois, prescrivant une telle condition que le royaume serait également divisé par eux ; de sorte que Karl accepterait pour gouverner le rôle que son père Pépin possédait, et Carloman - celui qui était dirigé par son oncle Carloman. Les deux parties ont accepté ces exigences et chacune a reçu une partie du royaume divisé conformément à la proposition. Cet accord a été maintenu, quoique avec beaucoup de difficulté, car de nombreux partisans de Carloman ont comploté pour rompre l'alliance. C'est arrivé au point que certains avaient même l'intention de réunir les frères dans la guerre.
Mais l'issue des événements montra qu'à cet égard il y avait plus de suspicion que de danger réel, car après la mort de Carloman [décembre 771], sa femme avec ses fils et avec le premier de sa noblesse s'enfuit en Italie ; on ne sait pas pour quelles raisons, ayant rejeté [l'hospitalité] du frère de son mari, elle est allée avec ses enfants sous le patronage du roi lombard Desiderius.
Ainsi, Carloman, après un règne commun de deux ans du royaume, mourut de maladie, et Charles, ayant enterré son frère, d'un commun accord, fut élu roi de Francia.
(4) En supposant qu'il ne sert à rien d'écrire sur la naissance, ainsi que sur l'enfance et l'adolescence de [Karl] (puisque rien n'est dit dans les annales, et qu'il n'y avait plus personne en vie qui puisse dire qu'il avait connaissance de [ces événements ] , j'ai décidé, en omettant l'inconnu, de continuer à présenter et montrer les actes, la morale et d'autres aspects de sa vie, cependant, de manière à parler d'abord de ses réalisations à la fois à la maison et à l'extérieur ; puis sur son caractère et ses occupations, puis sur la gestion du royaume et sa mort, sans rien manquer de digne et nécessaire à la connaissance.
(5) De toutes les guerres qu'il a menées, la première dans laquelle il s'est embarquée fut celle d'Aquitaine, commencée par son père, mais non terminée. Il semblait que [Karl] pourrait mettre fin à cette guerre rapidement, même du vivant de son frère [Carloman], puisqu'il lui a demandé de l'aide. Et bien que son frère, promettant de l'aider, l'ait trompé, [Karl] a mené très résolument la campagne entreprise [en Aquitaine]. Et pas avant qu'il ne voulut arrêter ce qu'il avait commencé et laisser le fardeau une fois sur lui, qu'il achèverait, grâce à l'endurance et à la constance, avec une excellente fin ce qu'il avait l'intention de faire. Après tout, et Gunold, qui, après la mort de Vayfariy, a tenté d'occuper l'Aquitaine et de reprendre la guerre déjà presque terminée, il l'a contraint de quitter l'Aquitaine et de se rendre au Pays Basque. Cependant, ne tolérant pas qu'il y prit position, [Karl], traversant la Garonne, transporta avec des ambassadeurs à Lupa, duc du Pays basque, pour trahir l'apostat ; si Loop n'exécute pas [l'ordre] rapidement, [Karl] lui-même prendra ce qui est requis par la guerre. Mais Lup, suivant le bon sens, non seulement ramena Hunold, mais même lui-même avec les provinces qu'il dirigeait, lui confia le pouvoir de Charles.
(6) Après avoir mis les choses en ordre en Aquitaine et mis fin à cette guerre (alors que son co-dirigeant [Carloman] avait déjà réussi à abandonner les affaires humaines), Charles, tenant compte des demandes et supplications de l'évêque de la ville de Rome Hadrien, lança une guerre contre les Lombards. Cette guerre a même été déclenchée plus tôt avec de grandes difficultés (à l'humble demande du pape Etienne) par le père de Charles [Pepin], pour une partie de la noblesse de Francia, avec laquelle [Pepin] avait l'habitude de consulter, à tel point s'est opposé à sa volonté qu'ils ont proclamé publiquement qu'ils quittent le roi et rentrent chez eux. Cependant, à cette époque, la guerre contre le roi [des Lombards] Aistulf a commencé et s'est très vite terminée. Il peut sembler que Charles et le père de [son Pepin] avaient une raison similaire ou, pour mieux dire, la même pour commencer la guerre, mais on sait que la [deuxième] guerre a demandé des efforts différents et s'est terminée par une fin [différente] . Après tout, Pépin, après plusieurs jours du siège de Titinus, a forcé le roi Aistulf à livrer les otages et à rendre les villes et les forteresses prises aux Romains, et afin de ne pas répéter ce qui a été dit, de sceller la foi avec un serment . Charles, ayant commencé la guerre, ne l'a pas terminée avant d'avoir accepté la reddition du roi Desiderius, fatigué du long siège, et son fils Adalgiz, sur qui il semblait que tous les espoirs étaient tournés, l'a forcé à quitter non seulement le royaume, mais même l'Italie. Il rendit tout ce qui avait été pris aux Romains, supprima Ruodgaz, le souverain du duché de Frioul, qui avait fomenté un coup d'État, subjugua toute l'Italie à son pouvoir et plaça son fils Pépin à la tête de l'Italie conquise en tant que roi.
Combien il était difficile pour Charles, qui est entré en Italie, de traverser les Alpes et quels grands efforts des Francs ont été pour surmonter des endroits infranchissables, des chaînes de montagnes et des rochers s'élevant vers le ciel, ainsi que des falaises difficiles d'accès, je décrirais ici, s'il n'avait pas été conçu par moi dans cet ouvrage pour perpétuer en mémoire le mode de vie de Charles plutôt que les événements de ces guerres.
Ainsi, la fin de cette guerre fut la conquête de l'Italie : le roi Desiderius fut exilé dans un exil éternel, son fils Adalgiz fut chassé d'Italie et les biens pris par les rois lombards furent rendus au souverain de l'Église romaine, Adrien.
(7) Après la fin de cette guerre, la guerre des Saxons reprit, qui semblait terminée. Aucune des guerres déclenchées par le peuple des Francs n'a été si longue, terrible et exigeant autant d'efforts, pour les Saxons, qui, comme presque tous les peuples vivant en Allemagne, sont de nature guerrière, voués au culte des démons et sont des opposants. de notre religion, ne la considérait pas comme mauvaise ou violée, ni transcendait à la fois les lois divines et humaines. Il y avait d'autres raisons pour lesquelles il ne se passait pas un jour sans troubler la paix, puisque nos frontières et les [frontières] des Saxons étaient presque partout contiguës dans la plaine, à l'exception de quelques endroits où de grandes forêts et des falaises coincées de la montagnes séparées par une frontière fiable du champ et les deux autres. Sinon, les meurtres, les braquages et les incendies n'y auraient pas encore ralenti. Les Francs étaient tellement en colère que, pour ne plus subir d'inconvénients, ils décidèrent qu'il valait la peine de déclencher une guerre ouverte contre eux. La guerre fut déclenchée et combattue pendant trente-trois ans avec un grand courage des deux côtés, mais avec plus de dommages aux Saxons qu'aux Francs. Cela aurait pu se terminer plus rapidement, sans la trahison des Saxons. Il est difficile de dire combien de fois les vaincus et suppliants du roi [les Saxons] se rendirent, promirent qu'ils suivraient les ordres, donnèrent des otages envoyés par eux sans délai, acceptèrent les ambassadeurs qui leur étaient envoyés. Et à plusieurs reprises, ils étaient si soumis et affaiblis qu'ils ont même promis de se tourner vers la religion chrétienne et d'abandonner la coutume d'adorer les démons. Mais combien de fois ils ont promis de le faire, le même nombre de fois qu'ils ont rompu [leurs promesses]. Il est impossible de bien comprendre vers lequel des deux ils étaient le plus enclins. Après le déclenchement de la guerre, il ne s'écoula guère un an avant qu'un tel changement ne leur arrive. Mais la force d'esprit du roi et sa constance éternelle, tant dans des circonstances défavorables que favorables, ne pouvaient être vaincus par l'inconstance des Saxons et n'étaient pas épuisés par les entreprises entreprises. Karl n'a pas permis à ceux qui ont fait quelque chose comme ça d'échapper à la punition. [Charles] lui-même a vengé la trahison et leur a imposé un châtiment bien mérité, soit en se tenant lui-même à la tête de l'armée, soit en envoyant ses comtes, jusqu'à ce que tous ceux qui résistaient soient écrasés et subordonnés à son pouvoir. Il réinstalla dix mille personnes avec femmes et enfants de ceux qui vivaient des deux côtés de la rivière Albin, et, les répartissant de différentes manières, les plaça ça et là dans diverses régions de Gaule et d'Allemagne. On croyait que la guerre, qui durait depuis tant d'années, se terminait à la condition posée par le roi et acceptée [par les Saxons] : les Saxons, rejetant le culte des démons et abandonnant les rites paternels, acceptent les sacrements de la foi et la religion chrétiennes et, unies aux Francs, constituent avec eux un seul peuple.
(8) Au cours de cette guerre, bien qu'elle ait duré très longtemps, Karl lui-même n'a affronté l'ennemi au combat que deux fois : une fois à une montagne appelée Osneggi, dans un lieu nommé d'après Teotmelli, et la deuxième fois près de la Rivière Haza ; et cela [arriva] le même mois, avec une différence de plusieurs jours. Dans ces deux batailles, les ennemis étaient tellement écrasés et finalement vaincus qu'ils n'osaient plus ni défier le roi ni lui opposer leur offensive, à moins qu'ils ne fussent dans un endroit défendu. Dans cette guerre, bon nombre des plus hauts rangs de la [noblesse] franque et de la noblesse saxonne ont été tués. Et quoique la guerre se termina dans la trente-troisième année, au cours de celle-ci, dans diverses parties du pays, tant d'autres guerres des plus sérieuses s'élevèrent contre les Francs, que le roi mena habilement, que, compte tenu d'eux, il est difficile décider ce qui devrait être le plus surprenant chez Charles - les difficultés ou sa chance. Après tout, il a commencé la guerre saxonne deux ans plus tôt que celle d'Italie et n'a pas cessé de la mener, et aucune des guerres qui ont eu lieu ailleurs n'a été arrêtée ou suspendue à aucun moment en raison de difficultés. Car Charles, le plus grand de tous les rois qui régnaient alors sur les nations, qui surpassait tout en prudence et grandeur d'âme, ne reculait jamais devant les difficultés et ne craignait pas les dangers de ces [guerres] qu'il entreprit ou menait. Au contraire, il savait accepter et mener chaque entreprise conformément à sa nature, ne pas baisser les bras dans une situation difficile et ne pas succomber à la fausse flatterie du bonheur dans une situation favorable.
(9) Ainsi, au cours d'une guerre longue et presque continue avec les Saxons, il, ayant placé des garnisons dans des endroits appropriés le long de la frontière, ne se rendit en Espagne [que] après avoir fait les meilleurs préparatifs de guerre. Ayant vaincu les gorges des Pyrénées, il obtint la reddition de toutes les villes et châteaux dont il s'approchait, et revint avec une armée entière et indemne. Cependant, sur le chemin du retour, sur la crête ibérique elle-même, il lui fallut encore peu de temps pour expérimenter la trahison des Basques. Tandis que l'armée étendue [Karl] se déplaçait en une longue chaîne, ils déterminèrent d'une manière ou d'une autre la nature du lieu et des gorges, les Basques, dressant une embuscade au sommet de la montagne - pour l'endroit approprié pour dresser une embuscade est dans des forêts denses, dont il y a beaucoup - attaquant d'en haut, ils ont jeté dans la vallée en dessous l'arrière-garde du convoi et ceux qui marchaient à la toute fin du détachement et protégeaient ceux de devant par l'arrière. Ayant commencé une bataille, les Basques ont tué jusqu'au dernier et pillé le train de bagages, puis, sous la protection de la nuit déjà à venir, cachant le plus essentiel [des volés], dispersés à la hâte dans différentes directions. Dans ce cas, les Basques ont été aidés par la facilité d'armement et la nature du terrain dans lequel se déroulait l'affaire ; au contraire, l'armement lourd et la rudesse du site rendaient [les Francs] tous inégaux aux Basques. Dans cette bataille, avec bien d'autres, moururent l'intendant Eggihard, l'administrateur du palais Anselme et Ruodland, le préfet de la marque bretonne. Et jusqu'à présent, il était impossible de venger ce qu'il avait fait, parce qu'ayant fait cela, l'ennemi était si dispersé qu'il n'y avait même pas une rumeur sur l'endroit et parmi quelles tribus ils pouvaient être trouvés.
(10) Charles a également conquis les Bretons, qui vivaient à l'Ouest, dans une des périphéries de la Gaule, sur l'océan, et n'ont pas obéi à ses ordres. Leur ayant envoyé une armée, il les obligea à livrer les otages et promit qu'ils feraient ce qu'il leur ordonnait de faire. Après cela, Charles avec son armée a de nouveau envahi l'Italie et, en passant par Rome, a attaqué Capoue, la ville de Campanie. Après avoir installé un camp là-bas, il commença à menacer les Beneventes de guerre s'ils ne se rendaient pas - Aragis, leur duc, prévint la guerre en envoyant ses fils Rumold et Grimold rencontrer le roi avec de grands cadeaux. Il invita Charles à prendre ses fils en otages, et il promit lui-même qu'avec son peuple, il exécuterait [n'importe quel] ordre, sauf qu'il serait obligé de se présenter devant le regard du roi.
Le roi accorda alors plus d'attention au bienfait du peuple qu'à l'inflexibilité [du duc]. Il accepta les otages qui lui étaient offerts et accepta comme une grande faveur de ne pas forcer Aragis à comparaître devant lui. Charles laissa le fils cadet du duc en otage, mais rendit l'aîné à son père et, envoyant des ambassadeurs dans toutes les directions pour qu'ils prennent à Aragis et au peuple de son serment d'allégeance, il se rendit à Rome. Après y avoir passé plusieurs jours à vénérer des lieux saints, il revint en Gaule.
(11) Le déclenchement soudain de la guerre de Bavière a pris fin rapidement. Elle était causée à la fois par l'arrogance et l'insouciance du duc de Tassilon, qui, cédant à la persuasion de sa femme (fille du roi Desiderius, qui voulait venger l'exil de son père avec l'aide de son mari), entra en une alliance avec les Huns, qui étaient voisins des Bavarois de l'est, et essayaient non seulement de ne pas exécuter les ordres du roi mais aussi de provoquer Charles à la guerre. Le roi, dont l'orgueil était blessé, ne pouvait pas supporter l'obstination de Tassilon, c'est pourquoi, ayant convoqué des soldats de partout, Charles, se rendit avec une grande armée à la rivière Lech avec l'intention d'attaquer la Bavière. Ce fleuve séparait les Bavars des Alamans. Avant d'envahir la province de Charles, ayant établi son camp sur les bords du fleuve, il décide de s'informer auprès des ambassadeurs des intentions du duc. Mais lui, croyant que la persévérance ne profiterait ni à lui ni à son peuple, par une prière se présenta personnellement devant le roi, fournissant les otages requis, dont son fils Théodon. De plus, il a juré de continuer à ne succomber à l'incitation de personne à se révolter contre le pouvoir royal. Ainsi, la guerre, qui paraissait longue, fut terminée au plus vite. Cependant, plus tard, Tassilon fut appelé auprès du roi sans autorisation de revenir ; l'administration de la province, qu'il possédait, était confiée non au prochain duc, mais à [plusieurs] comtes.
(12) Une fois ces troubles réglés, [une autre] guerre a commencé avec les Slaves, que nous appelons généralement les Viltsy, mais en fait (c'est-à-dire dans leur propre dialecte), ils s'appellent Velatab. Dans cette guerre, parmi d'autres alliés, les Saxons servaient le roi, qui suivait les bannières du roi selon l'ordre, mais leur obéissance était feinte et loin de la loyauté. La raison de la guerre était que les Wiltans, qui étaient autrefois des alliés des Francs, étaient harcelés par des raids fréquents et ne pouvaient pas être contenus par les ordres [du roi].
Une certaine baie s'étend de l'océan occidental à l'est, dont la longueur est inconnue, et la largeur ne dépasse pas cent mille marches, bien qu'en de nombreux endroits elle soit plus étroite. De nombreux peuples vivent autour d'elle : les Danois, ainsi que les Sveons, que nous appelons Normands, possèdent la côte nord et toutes ses îles. Sur la côte est vivent des Slaves, des Estoniens et divers autres peuples, parmi lesquels se trouvent les principaux velatabats, avec lesquels Karl était à cette époque en guerre. Avec une seule campagne, qu'il a lui-même menée, Charles a tellement vaincu et apprivoisé [le velataba] que plus tard ils ont cru qu'ils ne devaient plus refuser d'obéir aux ordres [du roi].
(13) La guerre avec les Slaves a été suivie par la plus grande guerre, à l'exception des Saxons, de tout ce que Karl a combattu, à savoir [la guerre] a commencé contre les Avars ou les Huns. Karl mena cette guerre plus brutalement que les autres, et avec les plus longs préparatifs. Charles lui-même, cependant, n'a mené qu'une seule campagne en Pannonie (car ce peuple vivait alors dans cette province), et a ordonné que le reste des campagnes soit mené par son fils Pépin, les préfets des provinces, ainsi que des comtes et même des ambassadeurs. . Ce n'est que la huitième année que cette guerre était enfin terminée, malgré le fait qu'elle ait été menée de manière très décisive. Combien de batailles ont été livrées, combien de sang a été versé - la preuve que la Pannonie est devenue complètement inhabitée et que l'endroit où résidait le kagan est maintenant si désert qu'il n'y a aucune trace de personnes vivant ici. Tous les nobles Huns ont péri dans cette guerre, toute leur gloire a été écourtée. Tout l'argent et les trésors accumulés depuis longtemps ont été saisis [par des francs]. Dans la mémoire humaine, il n'y a pas une seule guerre qui ait éclaté contre les Francs, dans laquelle les Francs seraient devenus si riches et auraient augmenté leur richesse. Car jusqu'alors les Francs étaient considérés comme presque pauvres, mais maintenant ils ont trouvé tellement d'or et d'argent dans le palais des Huns, ont pris tellement de butin de guerre précieux dans les batailles qu'on peut légitimement considérer que les Francs ont justement pillé les Huns ce que les Huns avaient précédemment injustement arraché à d'autres nations. Seuls deux des nobles Francs sont morts alors : Heirik, duc de Frioul, a été tué dans une embuscade à Libourge par les habitants de la ville balnéaire de Tarsatika, et Gerold, préfet de Bavière en Pannonie, alors qu'il construisait une armée avant la bataille avec les Huns. On ne sait pas qui l'a tué ainsi que ses deux serviteurs alors qu'il avançait, encourageant chaque guerrier. Pour le reste, cette guerre fut sans effusion de sang pour les Francs et eut la fin la plus favorable, bien qu'elle s'éternisa assez longtemps. Après cette guerre, la [campagne] saxonne a pris fin correspondant à sa durée. Les guerres de Bohême et de Linonie qui s'ensuivirent ne durent pas longtemps. Chacun d'eux se termina rapidement, [étant mené] sous la direction de Karl le Jeune.
(14) La dernière guerre a été déclenchée contre les Normands, appelés Danois. Ils se livrent d'abord à la piraterie, puis avec l'aide d'une importante flotte ils ravagent les côtes de la Gaule et de l'Allemagne. Le roi normand Godfried était si plein d'arrogance vide qu'il comptait posséder toute l'Allemagne. La Frise, comme la Saxe, il ne considérait rien d'autre que ses provinces. Il a déjà subjugué ses voisins pour les applaudir, en faisant d'eux ses affluents. Il se vantait d'entrer bientôt à Aix-la-Chapelle avec une grande armée, là où se trouvait la cour du roi. La vérité de ses paroles, bien que vide, n'a été contestée [par personne]. Au contraire, on croyait qu'il ferait quelque chose de similaire. Il n'a été arrêté que par une mort subite. Tué par son propre garde du corps, il a mis fin à sa vie et à la guerre qu'il a déclenchée.
(15) Ce sont les guerres que le roi le plus puissant dans diverses parties de la terre a menées avec beaucoup de sagesse et de chance pendant 47 ans (après tout, il a régné pendant tant d'années). Dans ces guerres, il agrandit si complètement le royaume déjà vaste et puissant des Francs, reçu du père de Pépin, qu'il y ajouta presque le double de terres. En effet, avant le pouvoir du roi des Francs n'était soumis qu'à cette partie de la Gaule qui s'étend entre le Rhin, Léger et l'océan [Atlantique] jusqu'à la mer des Baléares ; la partie de l'Allemagne habitée par des Francs, appelée Francs de l'Est, qui se situe entre la Saxe et [les fleuves] Danubius, Rhin et Sala, qui sépare les Turins et les Sabobs ; en outre, le pouvoir du royaume des Francs s'étendait aux Alamans et aux Bavarois. Charles, dans les guerres susmentionnées, a soumis d'abord l'Aquitaine, la Vasconie et toute la crête des Pyrénées jusqu'à la rivière Iber, qui commence à la Navar et traverse les champs les plus fertiles d'Espagne, se jetant dans la mer des Baléares sous la murs de la ville de Dertos. Il a ensuite annexé toute l'Italie, s'étendant sur mille et [encore] plus de kilomètres d'Augusta Pretoria au sud de la Calabre, où les frontières des Grecs et des Bénévents sont connues pour converger. Puis il annexa la Saxe, qui est une grande partie de l'Allemagne et est censée être deux fois plus large que la partie habitée par les Francs, bien qu'elle puisse être de longueur égale ; par la suite, à la fois la Pannonie, la Dacie, située de l'autre côté de la Danubie, ainsi que l'Istrie, la Liburnie et la Dalmacie, à l'exception des villes côtières, qui, en raison de l'amitié et de l'alliance conclue, Charles ont permis à l'empereur de Constantinople de posséder . Enfin, il a tellement pacifié tous les peuples barbares et sauvages qu'ils habitent l'Allemagne entre les fleuves Rhin, Visula, ainsi que l'océan et la Danubie (ces peuples sont presque semblables dans la langue, mais très différents dans les coutumes et l'apparence) qu'il leur a fait affluents. Parmi ces derniers, les [peuples] les plus remarquables sont : les velataba, les sora-would, les cheer, les bohèmes ; avec eux, Karl a combattu dans la guerre, et le reste, dont le nombre est beaucoup plus grand, il a pris en soumission [sans combat].
(16) La gloire de son règne il augmenta aussi grâce à l'amitié qu'il noua avec certains rois et peuples. Alphonse, roi de Galice et des Asturies, il noua une alliance si étroite que lorsqu'il envoya des lettres ou des ambassadeurs à Charles, il ordonna de ne s'appeler que « appartenir au roi ». Il acquit une telle disposition des rois écossais, séduits par sa générosité, qu'ils ne l'appelaient autre que maître, et eux-mêmes - ses sujets et ses esclaves. Il a été conservé des lettres envoyées d'eux à Karl, dans lesquelles de tels sentiments pour lui sont exprimés. Avec le roi Aaron de Perse, qui, à l'exception de l'Inde, possédait presque tout l'est, Charles avait un tel accord d'amitié qu'il préférait sa faveur à l'amitié de tous les rois et dirigeants qui ne sont que dans tout le cercle terrestre. Il jugeait nécessaire de ne rendre honneurs et cadeaux généreux qu'à Karl seul. Et donc, lorsque les ambassadeurs de Charles, qu'il envoya avec des cadeaux au saint sépulcre et au lieu de la résurrection du Seigneur, notre Sauveur, vinrent auprès d'Aaron et lui parlèrent du désir de leur maître, Aaron non seulement leur permit de faire ce que ils ont demandé, mais ont même permis d'enregistrer ce lieu de notre salut sous l'autorité de Charles. Ajoutant les siens aux ambassadeurs de retour, il envoya à Karl de merveilleux cadeaux ainsi que des vêtements, des épices et d'autres richesses des terres orientales. Mais quelques années plus tôt, Aaron lui avait envoyé le seul éléphant qu'il avait, car Karl l'avait demandé. Et les empereurs de Constantinople Nicéphore, Michel et Léon, qui recherchaient volontairement amitié et alliance avec lui, lui envoyèrent de nombreux ambassadeurs. Cependant, lorsque Charles prit le titre d'empereur, ils craignirent qu'il ne veuille leur arracher le pouvoir impérial. Alors Karl fit une alliance très forte avec eux, afin que les partis n'aient aucune raison de s'indigner. Car le pouvoir des Francs a toujours fait peur aux Romains et aux Grecs. D'où le dicton grec existant : avoir un franc comme ami, mais pas comme voisin.
(17) Bien que Charles ait consacré tant d'efforts à l'expansion du royaume et à la conquête des peuples étrangers et ait été constamment occupé à de tels actes, il a commencé à divers endroits de nombreux travaux liés à la décoration et à l'amélioration du royaume, et certains ont même achevé. Parmi eux, en toute honnêteté, remarquables sont la basilique Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle, une structure d'un travail étonnant, et le pont de Mogontiak sur le Rhin, long de cinq cents pas, car telle est la largeur du fleuve dans ce [lieu] . Cependant, le pont a brûlé dans un incendie un an avant la mort de Karl. Ils n'ont pas réussi à le restaurer en raison de la mort imminente de Karl, qui prévoyait d'en construire un en pierre au lieu d'un pont en bois. Il commença à ériger des palais d'un travail remarquable : l'un près de la ville de Mogontiaka, près du domaine d'Ingilenheim, l'autre à Noviomag, sur la rivière Vaal qui coule le long de la partie sud de la péninsule. Mais il est particulièrement important que s'il découvrait des temples qui se sont effondrés de vieillesse, peu importe où ils se trouvaient dans son royaume, il ordonnait aux évêques et aux pasteurs, sous la juridiction desquels ils se trouvaient, de les restaurer, et il veillait lui-même à travers les messagers pour que ses ordres soient exécutés... Pendant la guerre contre les Normands, il équipa une flotte en construisant des navires pour cela sur les fleuves de Gaule et d'Allemagne, qui se jettent dans la mer du Nord. Et depuis que les Normands ont dévasté la côte de la Gaule et de l'Allemagne avec des raids constants, Charles dans tous les ports et aux estuaires des rivières qui semblaient accessibles aux navires [de l'ennemi], a posté des patrouilles, des avant-postes et a érigé de telles fortifications que l'ennemi ne pouvait débarquer nulle part . Il en fit de même au sud, le long des côtes de Narbonne et de Septimanie, et aussi le long de toute la côte d'Italie jusqu'à Rome, contre les Maures, récemment impliqués dans la piraterie. Grâce à cela, du vivant de Charles, ni l'Italie et la Gaule des Maures, ni l'Allemagne des Normands, ne furent gravement endommagées, et seule Centumella, une ville d'Étrurie, fut pillée par les Maures à la suite de trahison, et en Frise plusieurs îles adjacentes à la côte allemande ont été dévastées par les Normands.
(18) Comme vous le savez, de la même manière, Charles protégeait, agrandissait et, en même temps, décorait le royaume.
De là, je commence à présenter ses talents et la perfection immuable de son esprit dans toutes les circonstances favorables ou défavorables, et sur d'autres choses concernant sa vie privée et domestique. Après la mort de son père, Charles, ayant partagé le royaume avec son frère, a si patiemment enduré son inimitié et son envie qu'il a semblé à tout le monde un miracle qu'il ne puisse pas succomber à la colère. Puis, poussé par sa mère, il épousa la fille de Desiderius, roi des Lombards, qu'il quitta un an plus tard pour une raison inconnue et épousa Hildegarde, une femme très noble de la tribu souabe, dont il eut trois fils, à savoir , Charles, Pepin et Louis et le même nombre de filles - Rotru-do, Bert et Gisella. Il avait aussi trois autres filles, Théodorat, Hiltrud et Ruothild : deux de sa [troisième] épouse Fastrada, descendante des Francs de l'Est, c'est-à-dire de la tribu germanique, la troisième d'une concubine dont je ne me souviens pas du nom. Après la mort de Fastrada, il épousa Alamanca Liutgarda, de qui il n'y eut pas d'enfants, et après sa mort il eut trois concubines : Herswinda de Saxe, dont naquit une fille nommée Adaltruda, Regina, qui donna naissance à Drogon et Hugo, et Adalind, qui a donné naissance à Theodoric. La mère de Karl Bertrad a vécu près de lui jusqu'à la vieillesse en haute estime. Car Charles la traita avec le plus grand respect, de sorte qu'il n'y eut pas une seule querelle entre eux, sauf celle qui survint à propos de la dissolution du mariage avec la fille du roi Desiderius, qu'il épousa sur ses conseils. Bertrada est décédée après la mort d'Hildegarde, après avoir vu ses trois petits-enfants et le même nombre de petites-filles dans la maison. Charles l'a enterrée avec de grands honneurs dans la même basilique de Saint-Dionysius, dans laquelle [son] père a été enterré.
Karl avait une sœur unique, nommée Gisella, qui fut envoyée [au monastère] dès son plus jeune âge pour le service religieux, dont il se souciait beaucoup, ainsi que sa mère. Elle est décédée peu de temps avant la mort de [Karl] dans le même monastère où elle vivait.
(19) Il attachait également de l'importance à l'éducation de ses enfants, [souhaitant] que les fils et les filles apprennent d'abord les arts libres, ce qu'il fit lui-même. Puis, dès que leur âge le lui permit, il commença à enseigner à ses fils l'équitation selon la coutume des Francs, le maniement des armes et la chasse ; Il ordonna à ses filles d'apprendre à filer, de s'habituer au fuseau et au rouet, afin qu'elles ne restent pas les bras croisés, mais travaillent, apprenant toutes sortes de vertus [honestatem].
De tous les enfants, il eut deux fils et une fille pour survivre : il perdit Charles, le fils aîné, Pépin, qu'il fit roi en Italie, et Rotruda, l'aînée des filles, mariée à l'empereur grec Constantin. Son fils Pepin laisse derrière lui un fils, Bernard, ainsi que cinq filles Adelaide, Atulu, Hindrada, Bertrad et Theodorata. Charles montra clairement sa miséricorde envers eux, car après la mort de son fils Pépin [laissa] son petit-fils prendre la place de son père et éleva ses petites-filles avec ses filles.
En raison de son amour pour eux, il n'a pas enduré la mort de ses fils et de ses filles aussi régulièrement que cela correspondait à l'extraordinaire force d'âme de son esprit et a fondu en larmes. Et, ayant appris la mort du pape Hadrien, qui était son ami proche, il a pleuré comme s'il avait perdu un frère ou un fils bien-aimé.
Dans les relations amicales, Karl était équilibré, les admettait facilement et les maintenait forts, se souciant sacrément de ceux avec qui il avait noué une telle intimité.
Il se souciait tellement de l'éducation de ses fils et de ses filles que, étant resté à la maison, il ne dînait jamais sans eux et ne partait jamais sur la route sans eux. Les fils montaient [à côté] de lui, et les filles suivaient derrière, gardées par une arrière-garde de gardes désignés. Il aimait ses filles, car elles étaient très belles, et, imaginez, il ne voulait pas en donner une à son peuple ou à des étrangères pour épouses ; il a gardé tout le monde à la maison jusqu'à sa mort, disant qu'il ne pouvait pas se passer de leur proximité. À cause de cela, il, bien qu'heureux à tous autres égards, a subi les coups d'un sort malheureux. Cependant, il n'a pas prétendu qu'aucun soupçon ne s'était élevé à leur sujet, et les rumeurs n'avaient pas été répandues.
(20) Il avait un fils nommé Pépin, né d'une concubine, que je n'ai pas mentionné parmi ses autres enfants, beau de visage, mais défiguré par une bosse. Pendant que son père, qui s'embarquait dans une guerre contre les Huns, hivernait en Bavière, feignant d'être malade, il conspirait contre son père avec quelques nobles Francs, qui le séduisaient avec une fausse promesse de pouvoir royal. Après la révélation du complot et la condamnation des conspirateurs, Pepin fut tonsuré et Karl lui permit de se consacrer au monastère de Prüm à la vie religieuse qu'il souhaitait. En outre, il y avait d'autres conspirations sérieuses contre Charles en Allemagne. Les conspirateurs, dont certains ont été aveuglés et d'autres indemnes, ont été envoyés en exil. Parmi eux, seulement trois ont été tués. Afin de ne pas être capturés, ils se sont défendus, tirant leurs épées et ont même tué quelqu'un. Ils ont été privés de leur vie, car sinon ils ne pourraient pas être pacifiés. On pense cependant que la raison de ces complots était la cruauté de la reine Fastrada, car les complots ont été élaborés contre le roi dans les deux cas parce que celui-ci, ayant succombé à la cruauté de sa femme, semble s'être trop éloigné de sa gentillesse naturelle et sa douceur inhérente. Sinon, tout au long de sa vie, Karl a traité tout le monde, à la maison comme à l'extérieur, avec un tel amour et une telle bienveillance que personne ne pourrait jamais lui reprocher et remarquer la moindre injustice ou cruauté.
(21) Il aimait les étrangers et était très soucieux de savoir comment les recevoir. Ainsi, leur nombre, en toute justice, semblait pesant non seulement pour le palais, mais aussi pour le royaume. Cependant, grâce à la grandeur de son âme, il était lui-même le moins chargé de ce genre de fardeau, car même des inconvénients importants étaient payés en acquérant la renommée de sa générosité et de sa réputation.
(22) Il possédait un corps puissant et robuste, grand, qui, cependant, ne dépassait pas ce qui était supposé être, car on sait qu'il mesurait sept pieds de haut. Il avait une nuque ronde, de grands yeux vifs et énormes, un nez légèrement plus gros que la moyenne, de beaux cheveux et un visage joyeux et attrayant. Tout cela contribua grandement à l'imposant et à la représentativité de son apparence aussi bien lorsqu'il était assis que lorsqu'il était debout. Et bien que son cou semblait épais et court, et son estomac saillant, mais cela était caché par la proportionnalité du reste des membres. Sa démarche était ferme, son apparence était courageuse, mais sa voix, bien que sonore, ne correspondait pas tout à fait à son apparence.
Sa santé était excellente, sauf que pendant les [dernières] années de sa vie, il souffrait de fièvre récurrente, et à la fin il boitait toujours d'une jambe. Mais même alors, il agissait plutôt à sa manière que sur les conseils des médecins, qu'il détestait presque, car ils le pressaient d'abandonner les aliments frits, auxquels il était accro, et de s'habituer à la nourriture bouillie. Il pratiquait constamment l'équitation et la chasse, ce qui était naturel pour lui, le franc, puisqu'il n'y a pratiquement aucune nation sur terre qui puisse se comparer aux Francs dans cet art. Il aimait se baigner dans des sources chaudes naturelles et exercer son corps en nageant fréquemment. Il y était si habile que personne ne pouvait vraiment le dépasser. C'est pourquoi il a même érigé un palais à Aix-la-Chapelle et y a vécu constamment dans les dernières années de sa vie jusqu'à sa mort. Il invitait non seulement les fils à nager, mais aussi les nobles et les amis, et parfois même une suite, des gardes du corps et des gardes, donc parfois une centaine de personnes ou plus nageaient en même temps.
(23) Karl portait des vêtements traditionnels francs. Il s'habilla d'une chemise et d'un pantalon en lin, et par-dessus [enfila] une tunique garnie de soie, enveloppant ses tibias de tissu. Sur ses pieds se trouvaient des onuchi et des chaussures, et en hiver, il protégeait ses épaules et sa poitrine, les recouvrant de peaux de loutres ou de martres. Par-dessus, il jeta un manteau bleu-vert et toujours ceint d'une épée dont la poignée et la fronde étaient en or ou en "argent". Parfois, il prenait une épée ornée de pierres précieuses, mais cela ne se produisait que lors de célébrations spéciales ou restaient, il méprisait les vêtements, même les plus beaux, et n'acceptait jamais de les porter.
[Seulement] lors des festivités, il se produisait dans des vêtements tissés d'or, des chaussures ornées de pierres précieuses, un manteau fermé par une boucle en or et une couronne d'or et de pierres précieuses. Les autres jours, ses vêtements n'étaient pas très différents de ceux portés par les gens ordinaires.
(24) Il était modéré en mangeant et en buvant, surtout en buvant, car il détestait surtout l'ivresse chez quiconque, sans parler de lui-même et de ses proches. Cependant, il ne pouvait pas s'abstenir de nourriture pendant longtemps et se plaignait souvent que le jeûne était nocif pour son corps. Il se régalait très rarement, et seulement lors des grandes fêtes, mais en même temps avec un grand nombre de personnes. Le dîner quotidien ne comprenait généralement que quatre plats, sans compter le rôti, que les chasseurs servaient généralement à la broche, et que Karl aimait manger plus que tout autre aliment. Pendant le repas, il écoutait soit un lecteur, soit une sorte de spectacle. Ils lui lisaient [la même] sur l'histoire et les exploits des anciens. Il aimait aussi les livres de saint Augustin, en particulier ceux intitulés O Cité de Dieu. Il était si abstinent de boire du vin et d'autres boissons qu'il en buvait rarement plus de trois fois au dîner.
Un après-midi d'été, après le dîner, il a mangé des fruits et a bu [encore] une fois, [puis], enlevant tous ses vêtements et ses chaussures, il s'est retrouvé sans tout comme la nuit et s'est reposé pendant deux ou trois heures. La nuit, son sommeil a été interrompu quatre ou cinq fois afin qu'il se réveille non seulement, mais qu'il se lève aussi du lit.
Tout en s'habillant et en mettant des chaussures, il recevait non seulement des amis, mais même si le directeur du palais disait qu'un certain différend était survenu qui ne pouvait être terminé sans sa résolution, il ordonna immédiatement d'amener les contestataires et, comme s'il était assis dans le président d'un juge, l'ayant compris, a prononcé un verdict ... De plus, si ce jour-là il fallait faire quelque chose d'officiel ou assigner quelque chose à l'un des ministres, il le faisait en même temps.
(25) Il était verbeux et éloquent, et pouvait exprimer ce qu'il voulait de la manière la plus claire. Non content de sa seule langue maternelle, il a essayé d'apprendre des langues étrangères. Il apprit le latin de telle manière qu'il parlait généralement [ogage] dedans, comme dans sa langue maternelle, mais il comprenait le grec plus qu'il ne parlait. En même temps, il était si bavard qu'il semblait même bavard. Il poursuivait avec diligence les arts libéraux et respectait beaucoup ceux qui les enseignaient, leur accordant de grands honneurs. Il a appris la grammaire du diacre Pierre de Pise, qui était alors déjà vieux, dans d'autres sciences son mentor était Albinus, surnommé Alcuin, également diacre, un Saxon de Grande-Bretagne, le mari le plus érudit du monde. Sous sa direction, Karl consacre beaucoup de temps à l'étude de la rhétorique, de la dialectique et surtout de l'astronomie. Il étudia l'art du calcul et, avec la diligence d'un sage, dénicha avec curiosité les chemins des étoiles. Il essaya d'écrire, et pour cela il gardait des tableaux ou des tablettes sur le lit, à la tête du lit, de sorte que, dès que le temps libre tombait, il s'entraînait à dessiner des lettres, mais son travail , commencé trop tard et hors du temps, a eu peu de succès.
(26) Il vénérait sacrément et avec dévotion la religion chrétienne, dans laquelle il fut instruit dès l'enfance. C'est pourquoi il érigea à Aix-la-Chapelle une basilique d'une exceptionnelle beauté, la décorant d'or, d'argent, de lampes, ainsi que de grilles et de grilles en bronze massif. Comme les colonnes et le marbre de cet édifice ne pouvaient être obtenus nulle part ailleurs, il s'assura qu'il vienne de Rome et de Ravenne.
Il allait souvent et avec zèle à l'église aussi bien le matin que le soir, et même la nuit et aux matines, autant que sa santé le lui permettait et était très soucieux que tout ce qui s'y faisait était le plus digne. Il ne se lassait pas de rappeler aux ministres de ne pas laisser entrer quoi que ce soit d'inapproprié ou d'obscène. Il lui a fourni une telle abondance de vases sacrés d'or et d'argent et de vêtements pour le clergé que même les portiers, [les gens] de rang ecclésiastique inférieur, n'avaient pas besoin de servir dans leur propre costume pendant les cérémonies. Il a diligemment amélioré l'ordre de chanter des psaumes et de lire à l'église. Après tout, il était parfait dans les deux, même s'il ne lisait pas lui-même en public, mais ne chantait qu'avec les autres et d'une voix calme.
(27) Charles était actif dans le soutien des pauvres et dans la charité désintéressée que les Grecs appellent éléimosinam[aumône]. Il n'oublia pas de faire l'aumône non seulement chez lui et dans son royaume, mais même outre-mer en Syrie et en Egypte, ainsi qu'en Afrique, à Jérusalem, à Alexandrie et à Carthage. Lorsqu'il découvrit que quelque part des chrétiens vivaient dans la pauvreté, il leur envoyait généralement de l'argent, compatissant à leur besoin. C'est pourquoi il recherchait l'amitié des rois d'outre-mer, afin qu'un peu de consolation et de soulagement vienne pour les chrétiens vivant sous leur domination. A Rome, plus que dans d'autres lieux sacrés et vénérés, Charles s'occupa de l'église du bienheureux Apôtre Pierre, au trésor de laquelle il fit don de grosses sommes d'argent, tant en or qu'en argent et en bijoux. Il a envoyé d'innombrables cadeaux aux évêques. Pendant toute la période de son règne, pour Charles, il n'y avait rien de plus désirable que de rendre à Rome, par son travail et ses efforts, son ancienne grandeur et position. Il voulait que, grâce à lui, l'église Saint-Pierre soit non seulement saine et sauve, mais qu'avec son soutien surpasse toutes les autres églises en beauté et en richesse. Et bien qu'il ait tant apprécié Rome, au cours de ses quarante-sept années de règne, il n'y est allé que quatre fois - pour accomplir ses vœux et prier.
(28) Il y avait d'autres raisons à la dernière visite de Karl. Le fait est que les Romains, qui ont soumis le pape Léon à une grande violence, lui creusant les yeux et arrachant sa langue, l'ont forcé à prier le roi pour sa protection. C'est pourquoi, étant allé à Rome pour rétablir l'état de choses dans l'église, qui était en plein désarroi, il y resta tout l'hiver. C'est alors qu'il prit le nom de l'Empereur et d'Auguste, ce dont il ne voulait pas du tout au début et prétendit que s'il avait connu à l'avance le projet du Pape, il ne serait pas allé à l'église ce jour-là, malgré le fait que c'était l'une des principales vacances. Et avec une grande patience, il supporta l'envie des empereurs romains, qui s'indignaient d'avoir accepté ce titre. Karl a vaincu leur entêtement avec sa générosité, avec laquelle il les a sans aucun doute dépassés, leur envoyant des ambassades fréquentes et les appelant frères dans les lettres.
(29) En acceptant le titre impérial, Charles a attiré l'attention sur le fait qu'une grande partie des lois de son peuple était imparfaite - après tout, les Francs avaient deux lois, qui étaient très différentes dans de nombreux endroits. Il a décidé d'ajouter ce qui manquait, d'éliminer les écarts et de corriger ce qui était mal énoncé ou avec des erreurs. Il n'a accompli rien de tout cela, à l'exception du fait qu'il a ajouté plusieurs chapitres aux lois, mais ils n'ont pas été achevés non plus. Cependant, il a ordonné de décrire et de mettre par écrit les lois orales de tous les peuples sous son contrôle. Il a également [ordonné] d'écrire et de perpétuer les vieux chants barbares qui glorifiaient les actes et les guerres des anciens rois. Il a également jeté les bases de la grammaire de la langue maternelle.
[Karl] a également nommé les mois dans sa propre langue. Jusque-là, les Francs les appelaient en partie en latin, en partie dans un dialecte barbare. Il a établi ses propres noms pour les douze vents, bien qu'auparavant il n'y avait pas plus de quatre noms pour eux. En parlant de mois, il a appelé janvier Wintermanot, février - Gornung, mars - Lenzinmanot, avril - Ostarmanot, mai - Winnemanot, juin - Brahmanot , juillet - Heuimanot, août - Aranmanot, septembre - Vitumanot, octobre - Windumuma-not, novembre - Herbistmanot, décembre - Heylagmanot.
Pour les vents, Karl a mis les noms suivants: le vent d'est a commencé à s'appeler ostronivint, sud-est ostzundroni, sud-est - zundostroni, sud - zundroni, sud-sud-ouest - zundvestroni, sud-ouest - westzundroni, ouest - - westroni, nord-ouest - westnordroni, - nord-nord-ouest - nordvestroni, nord - nordroni, nord-est - nordostroni, nord-est - ostnordroni.
(30) À la fin de sa vie, accablé par la maladie et la vieillesse, Charles convoque Louis, roi d'Aquitaine, le seul survivant des fils d'Hildegarde. Ayant correctement rassemblé les plus nobles Francs de tout le royaume, Charles, d'un commun accord, fit de son fils le co-dirigeant de tout le royaume et héritier du titre impérial. Ayant mis la couronne sur sa tête, Charles ordonna d'appeler Louis Empereur et Auguste. Cette décision fut appuyée avec approbation par toutes les personnes présentes, car il semblait qu'elle était inspirée d'en haut pour le bien de l'État tout entier. Et cet acte a augmenté l'autorité de Charles [à la maison] et a instillé une grande peur chez les peuples étrangers.
Puis, ayant renvoyé son fils en Aquitaine, il, bien que faible de vieillesse, comme d'habitude, est allé chasser près du palais d'Aix-la-Chapelle et, après avoir passé le reste de l'automne à cette occupation, est revenu à Aix-la-Chapelle aux calendriers de novembre. En hivernant là-bas, il est tombé malade en janvier avec une forte fièvre. Aussitôt, comme d'habitude avec les fièvres, il se mit à jeûner, croyant qu'une telle abstinence de nourriture pouvait chasser la maladie, ou du moins la soulager. Mais la chaleur s'est accompagnée d'une douleur au côté, que les Grecs appellent « pleurésie », mais il a continué à s'abstenir de nourriture, renforçant son corps avec seulement une boisson rare. Le septième jour, après s'être mis au lit, ayant pris la sainte communion, il mourut. Cela s'est passé dans la soixante-douzième année de sa vie, qu'il a régnée pendant quarante-sept ans, le cinquième jour avant les Calendriers de février, à trois heures de l'après-midi.
(31) Son corps a été lavé et enlevé selon le rite établi. Avec la grande lamentation de tout le peuple, il a été introduit dans l'église et enterré. Au début, ils doutaient de l'endroit où il devait être enterré, car lui-même n'avait laissé aucun ordre à ce sujet de son vivant. Alors tout le monde s'accorda à dire que nulle part pour lui il ne trouverait un tombeau plus digne de la basilique même, que lui-même, par amour pour Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ et en l'honneur de la sainte Marie toujours vierge, la Mère de Dieu ce règlement à ses frais. Là, il a été enterré le jour même de sa mort. Une arche en or doré a été érigée au sommet de sa tombe avec son image et son inscription. L'épitaphe était la suivante :
Sous cette pierre repose le corps du grand
et le fidèle empereur Charles,
qui a notamment agrandi le royaume
francs et règles heureusement
quarante sept ans. Mort à soixante-dix ans,
en l'an du Seigneur DCCCXIIII,
Acte d'accusation VII, V Cal., fév.
(32) L'approche de sa fin était marquée par de nombreux signes, de sorte que non seulement les autres, mais lui-même les considéraient comme une menace. Au cours des trois dernières années de sa vie, il y a eu de fréquentes éclipses de soleil et de lune, et une tache noire a été observée sur le soleil pendant sept jours. La masse majestueuse du portique, qui a été construit entre la basilique et le palais, s'est effondrée de manière inattendue au sol le jour de l'Ascension du Seigneur. Et le pont sur le Rhin près de Mogontiak, que Charles érigea pendant dix ans avec une telle habileté et une telle difficulté qu'il lui sembla qu'il pouvait tenir pour toujours, accidentellement enflammé, brûlé dans un incendie en trois heures de sorte que (à l'exception de la partie sous-marine ) pas une puce de lui n'est pas laissé. Et Karl lui-même, lors de la dernière campagne de Saxe contre le roi danois Godfried, une fois sorti du camp avant le lever du soleil et déjà parti en voyage, vit soudain que de droite à gauche dans l'air pur dans une lueur brillante balayait une flamme qui tombait depuis le ciel. Alors que tout le monde était étonné de ce signe et de ce qu'il présageait, le cheval sur lequel Karl montait a soudainement baissé la tête et est tombé, le jetant au sol avec une telle force que la boucle de sa cape a éclaté et la fronde de l'épée s'est cassée. Il fut élevé par les serviteurs qui se trouvaient à proximité, se précipitant vers lui, qui lui enlevèrent ses bras et sa robe de dessus. Même la lance, qu'il tenait fermement dans sa main à ce moment-là, est tombée et a volé sur vingt pieds ou plus.
De plus, le palais d'Aix-la-Chapelle tremblait souvent et dans les chambres où Karl résidait, les plafonds craquaient constamment. Et la basilique, dans laquelle Charles a été enterré plus tard, a été frappée du ciel et la pomme d'or qui ornait le sommet du toit s'est fendue d'un coup de foudre et a été jetée sur la maison de l'évêque adjacente à la basilique. Dans la même basilique, le long du bord de la corniche située entre les arcades des étages supérieur et inférieur, qui longeait la partie intérieure du temple, une inscription était inscrite en ocre rouge disant qui était le créateur de ce temple ; sa première ligne contenait les mots :
PRINCIPES CARL
On remarqua que l'année même de la mort de l'empereur, quelques mois avant sa mort, les lettres du mot PRINCIPE tellement fanés qu'ils étaient presque invisibles. Cependant, Karl n'a pas prêté attention à tous les signes mentionnés, ou les a ignorés, comme si aucun d'eux ne le concernait en aucune façon.(33) Il a commencé à rédiger un testament, selon lequel une partie de l'héritage est allée aux filles et les enfants nés de concubines. Cependant, commençant trop tard, il n'a pas réussi à donner suite. Trois ans avant sa mort, Charles a partagé trésors, argent, vêtements et ustensiles en présence de ses amis et serviteurs. Les appelant comme témoins, il souhaita qu'après sa mort la division qu'il avait faite, avec leur approbation, demeure inchangée. Il a rédigé un court document décrivant sa volonté pour ce qu'il a partagé. Le contenu et le texte de ce document sont les suivants :
DANS LE NOM DU TOUT PUISSANT
SEIGNEUR DIEU PERE ET FILS
ET LE SAINT-ESPRIT
Description et section de ses propres trésors et de son argent, fabriqués par le plus glorieux et amoureux de Dieu, l'empereur Charles, l'empereur et Auguste, en l'an 811 de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la quarante-troisième année de son règne en Francia , dans la trente-sixième année de son règne en Italie, dans la onzième année de son empire, dans la quatrième année de l'Acte d'accusation. Le partage de la propriété qui se trouvait dans son entrepôt le jour désigné, Karl a décidé de le faire avec une pensée pieuse et sage et l'a réalisé avec l'aide de Dieu.
Ce faisant, il a surtout voulu faire en sorte que non seulement les dons de charité, dûment accomplis par les chrétiens sur leurs biens, soient effectués en son nom et de son argent, ordonnés et justifiables, mais que ses héritiers, en l'absence de tout l'obscurité, sauraient fermement ce qui leur reviendrait et pourraient, sans contestations et réclamations mutuelles, partager les parts qui leur étaient attribuées. Partant de ce plan et de cette intention, il a, comme il a été dit, d'abord divisé en trois parties tous les fonds et biens qui se trouvaient dans son coffre-fort en or, argent, bijoux et robes royales. Puis, laissant une partie intacte, il a divisé les deux autres en XX et une partie. Ces deux parties ont été divisées en XX et une part car, comme vous le savez, il y a vingt et une villes métropolitaines dans son royaume. Chacune de ces parties devait être transférée par ses héritiers et amis sous forme d'aumône à l'une des métropoles. L'archevêque, qui était alors à la tête de l'église donnée et acceptant la part allouée à son église, doit la partager avec ses évêques comme suit : une troisième partie doit rester son église, et les deux autres sont partagées entre les évêques . Chacun du nombre connu XX et l'une des actions métropolitaines existantes, qui ont été obtenus à partir des deux premières parties divisées, ont été soigneusement séparés des autres et placés dans sa propre boîte, avec l'inscription de la ville à laquelle il devait être remis plus de.
Les noms des métropoles auxquelles la miséricorde ou l'aumône indiquée doit être transférée sont les suivants : Rome, Ravenne, Medi-olan, Forum Julia, Gradus, Colonia, Mogontiak, Yuvaum (ou Salzbourg), Trainers, Senones, Vesontion, Lugdunum, Ratumagus, Remy, Arelas, Vienne, Darantazia, Ebrodunum, Burdigala, Turones, Biturigi.
La partie qu'il souhaitait garder intacte se divise ainsi. Après que les deux parties ainsi séparées aient été distribuées et scellées, cette troisième doit être en circulation journalière comme une chose connue pour n'être aliénée de la propriété de son propriétaire en vertu d'aucune promesse. Cela persiste tant qu'il est en bonne santé ou qu'il déclare avoir besoin de l'utiliser. Et après sa mort ou sa renonciation volontaire aux affaires du monde, cette partie devrait être divisée en quatre autres parties. Le premier quart doit être ajouté au XX et un ci-dessus. Le deuxième trimestre est attribué à ses fils et filles, ainsi qu'aux fils et filles de ses fils, et doit être équitablement et raisonnablement réparti entre eux. Un troisième quart, selon la tradition chrétienne, est consacré aux besoins des pauvres. Le quatrième trimestre, de la même manière, sous forme d'aumône, va à l'entretien des domestiques du palais, distribué à l'usage des domestiques et des servantes. A ce tiers de toute sa fortune, qui, comme les autres, se compose d'or et d'argent, il a voulu ajouter tous les vases et ustensiles en bronze, fer et autres métaux, ainsi que les armes, vêtements et autres, précieux et de peu de valeur faite pour divers besoins de biens, tels que rideaux, couvre-lits, tapisseries, tissus de laine, cuir, harnais et tout ce qui était à ce moment-là dans ses rangements et coffres, de sorte que de ce fait les parts de cette troisième partie augmenteraient et la distribution de l'aumône atteint un plus grand nombre de personnes.
En ce qui concerne la chapelle, c'est-à-dire les ustensiles de l'église [d'Aix-la-Chapelle], à la fois ce qu'il a lui-même donné et collecté, et ce qu'il a hérité de son père, il a ordonné que tout reste intact et ne soit divisé en aucune façon. Et s'il y a des vases, des livres ou d'autres biens dont on sait avec certitude qu'ils n'ont pas été placés dans cette chapelle, et si quelqu'un veut les avoir, alors il peut en faire don, l'ayant acquis à un prix justement fixé. Quant aux livres qu'il collectionnait en grand nombre dans sa bibliothèque, Charles décréta également que ceux qui voudraient les posséder devaient les racheter à un juste prix, et que l'argent versé serait distribué aux pauvres.
Entre autres trésors et biens, [Karl] avait trois tables en argent et une particulièrement grande et lourde en or. A leur égard, il a ordonné et statué comme suit. L'un d'eux, carré, à l'effigie de la ville de Constantinople, avec d'autres cadeaux destinés à cela, doit être transféré à Rome, la basilique du bienheureux apôtre Pierre. Une autre table ronde, décorée à l'image de la ville de Rome, doit être envoyée au diocèse (episcopio) de l'église de Ravenne. Le troisième tableau, surpassant les autres par la beauté d'exécution et le poids impressionnant, ayant une carte détaillée du monde entier finement dessinée sous la forme de trois cercles, il décida de donner pour une augmentation de ce tiers qui devrait être partagé entre ses héritiers et dirigé vers l'aumône. Il faut aussi donner la table d'or mentionnée par le 4. Charles fit et approuva cette description et cette distribution des [propriétés] devant les évêques, abbés et comtes qui pouvaient alors y assister. Leurs noms sont répertoriés.
Évêques : Hildibald, Rickulf, Arn, Wolfarius, Bernoin, Leidrad, John, Theodulf, Jesse, Heymo, Waltgaud.
Comptes : Vala, Meginher, Otulf, Stefan, Unruok, Burkhard, Meginhard, Gatton, Rigvin, Edon, Erkangari, Gerold, Beron, Hildegern, Rockulf.
Louis, fils de Charles et héritier par la volonté de Dieu, étudia ce document et après la mort de son père, il tenta de le remplir le plus rapidement et le plus soigneusement possible.
UN COMMENTAIRE
EINHARD. LA VIE DE CARL LE GRAND
Je voudrais commencer un bref tour d'horizon des œuvres contenues dans ce livre avec "La vie de Charlemagne" d'Einhard. Il ne s'agit pas seulement de couvrir une période chronologiquement antérieure. Ce petit volume occupe une place particulière parmi les autres œuvres de la littérature carolingienne. Même du vivant de l'auteur, il était destiné à devenir un classique et à devenir pendant de nombreux siècles l'objet d'une attention particulière, qui ne s'est pas encore tarie de nos jours. Il ne s'agit pas seulement de la personnalité du grand empereur, dont la vie et l'œuvre ont été décrites avec tant d'amour par Einhard, mais en particulier de l'œuvre elle-même.
Nous savons peu de choses sur l'enfance et l'adolescence d'Einhard. Il est né vers 770 à Meingau et se distinguait plus par des capacités étonnantes que par une famille noble. Ses parents sont mentionnés parmi les donateurs du monastère de Fulda. Là, à l'âge de 9 ans, le garçon a été envoyé pour recevoir une éducation. Peu après 791, l'abbé de Bau Golf envoya le jeune homme à la cour de Charles, qui recherchait des talents dans toutes les parties de son royaume. A la cour, Einhard acquiert rapidement les faveurs du roi et de son entourage. Un homme de petite taille, mais un grand esprit, nardlyus (diminutif d'Einhardulus), une fourmi travailleuse - ils lui ont décerné de telles épithètes. À l'académie de la Cour, Einhard s'appelait Veseleil. Comme le héros biblique, il excellait dans la sculpture sur pierre, le travail du bois et le travail des métaux. Ainsi, en 807, un certain Angisius, abbé de Saint-Germain-de-Fleu, se voit confier des travaux publics à Aix-la-Chapelle sous la houlette d'Einhard. L'abbé Fulda Rutger lui envoya le moine Bruno pour recevoir de lui une instruction dans divers arts.
La carrière politique d'Einhard remonte au règne de Louis le Pieux (814 - 840). Einhard devient le secrétaire personnel de l'empereur, puis le mentor de son fils aîné Lothaire. Puis il épousa Imma, sœur de Bernard, évêque de Worms. Dans les années troublées de la guerre civile naissante et de l'abolition progressive de l'ordre établi par Charlemagne, Einhard a essayé d'être un intermédiaire entre l'empereur et ses enfants. Cependant, il ne pouvait pas faire grand-chose. Avec l'âge, ma santé a commencé à se détériorer - de plus en plus souvent, j'étais tourmentée par des douleurs au côté et à l'estomac. En 830, Einhard se retira enfin de la cour et s'installa à Seligenstadt, l'un des nombreux monastères que Louis lui céda. Dans le silence des murs du monastère, il se consacre entièrement à l'activité littéraire.
Einhard mourut le 14 mars 840, la même année que l'empereur Louis.
Son héritage littéraire est petit : outre « La Vie de Charlemagne » (Vita Carol ! Magni), « Sur le transfert des reliques et des miracles de nos saints Marcellin et Pierre » (De translatione et miraculis sanctorum suorum Mar-celini et Petri ) et "Livre de vénération de la Croix" (Libelius de adoranda Cruce), ainsi qu'une série de 71 lettres écrites entre 814 et 840. La version, autrefois ancrée dans l'historiographie, selon laquelle Einhard était l'auteur d'une partie des Annales du royaume franc, une version révisée des Grandes Annales royales (Annales regni Francorum), a maintenant été complètement abandonnée. Charlemagne occupe une place particulière parmi les œuvres de l'époque carolingienne. En plus du fait que cet ouvrage est compact et écrit dans un excellent latin, il est de nature purement profane, ce qui devrait être reconnu comme un phénomène unique à cette époque. Les années entre 829 et 836 sont traditionnellement considérées comme le moment de sa naissance.
Sans aucun doute, Einhard connaissait très bien les anciens classiques. Les travaux de certains d'entre eux, en particulier "Sur la vie des Césars" (De vita Caesarum) de Suétone, qu'il a rencontré alors qu'il était encore à Fulda, ont eu une influence notable sur lui. De Suétone, il emprunte un schéma de regroupement des faits, ainsi qu'un certain nombre de tournants littéraires. Cependant, il serait exagéré de penser qu'Einhard imitait aveuglément les Biographies romaines.
La tâche principale de l'auteur doit être reconnue comme l'éloge sans partage de son héros. Voyant comment l'empire, dont il était témoin de la grandeur, s'effondrait, Einhard écrivit un panégyrique à son fondateur et créa une certaine image idéale du souverain et de l'homme, essayant de faire de lui un exemple pour imiter ses contemporains et ses descendants. "La vie de Karl" se décompose en plusieurs morceaux sémantiques : une section introductive (chap. 1-4), les guerres et la politique étrangère de Karl (chap. 5 - 16), la vie personnelle de l'empereur (chap. 17 - 29) . Puis l'auteur raconte les derniers jours de Charles, sa mort et son enterrement, complétant son œuvre par une déclaration de volonté (chap. 30-33).
Bien sûr, les chapitres sur la vie personnelle de l'empereur, ainsi que sur son apparence, ses occupations et ses passions, sont du plus grand intérêt pour le lecteur, car ils ont été écrits par un témoin oculaire qui connaissait les moindres détails de ce qui était décrit. La situation est plus compliquée avec la partie consacrée aux activités militaro-politiques de Karl. Einhard est venu à la cour alors qu'une partie importante des campagnes de l'empereur était déjà terminée. Il a tiré des informations à leur sujet de seconde main, principalement de sources officielles, principalement des Annales du royaume des Francs. En tant que secrétaire de l'empereur Louis, Einhard avait sans doute accès aux archives de l'État et connaissait la correspondance diplomatique de Charles. Un certain nombre de passages de l'auteur (par exemple, sur Hildegarde - chapitre 18, sur la mère de Pépin le Bossu - chapitre 20, sur la langue latine - chapitre 25) sont similaires à certains passages du "Livre des évêques de Metz" (Liber de Episcopis Mettensis) de Paul le Diacre.
Rassemblant des matériaux, Einhard a adapté les faits à son concept, dans certains cas en gardant le silence sur quelque chose, dans d'autres - d'une manière particulière en les disséquant. Dans un effort pour augmenter l'ampleur des actes de Karl, Einhard transforme tout affrontement des Francs avec leurs voisins en guerre. Ainsi, il a les guerres d'Aquitaine (ch. 5), de Bavière (ch. 11), de Bohême (ch. 13), de Linon (ch. 13), bien que pendant les deux premières d'entre elles il n'y ait eu aucune bataille, et le les deux autres se sont déroulés sous la forme d'escarmouches frontalières. Contrairement à la vérité, Einhard prétend que Karl n'a jamais attaqué en premier, mais a seulement puni les ennemis pour trahison (Ch. 8, I, 13), tout en gagnant invariablement. Einhard garde le silence sur les défaites de son héros. Il ne rapporte rien des catastrophes de Saxe en 775 et 782 (ch. 8), ainsi que de la mort de l'arrière-garde franque dans les gorges du Ronseval en 778 (ch. 9). De manière très partiale, l'auteur compare les mérites de Karl et de son père, Pipin Korotkiy, en exagérant le rôle du premier et en diminuant l'importance du second (ch. 5, b, 15). Cependant, une telle déviation de la vérité ne diminue en rien la valeur et l'unicité de cette œuvre littéraire. La vie de Charlemagne a été publiée et traduite dans de nombreuses langues du monde à plusieurs reprises. Cette traduction est une bonne continuation de cette tradition.
1 Praefatio Strabi // MGH. SS., T. II, S. 440
2 Idem
... 3 Idem.
4 Carmen Alcuini 242, 4-8 :
Une abeille, de petite taille, vous apporte un excellent miel.5 Carmina Théodulfi III, 1, vv. 155-6 : « Nardul, en mouvement perpétuel, se précipite ici et là, comme une fourmi travailleuse. »
Et comme la pupille, étant une petite partie de l'œil,
Contrôle complètement la vie du corps,
Donc Nardul lui-même dirige toute cette économie.
Sans arrêter de lire, dites : "Bonjour, petit Nardul."
6 Walafr. Strab., De Einharto Magno, vv. 1-3 : « Il ne faut pas moins de respect pour le grand père Bezaleil - le premier gestionnaire qualifié [et] qui maîtrisait tous les arts » ; voir aussi : Alcuini Epistolae ad regem, 85.
7 Mer: Ex. 31 :2-5 : Regardez, je nomme Bezalel... Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse, de la raison, de la connaissance et de tout art, [et] pour travailler de l'or, de l'argent et du cuivre... à tailler avec une pierre pour l'insertion et pour couper un arbre pour chaque entreprise ...
8 Gesta abbatum Fontanellensium // MGH. SS., T. I, S. 293.
9 Catalogus abbatum Fuldensium // MGH. SS., T. III, S. 162.
10 Pour plus de détails, voir : Philipp Jaffe. Einhardi vita Caroli. Dans : Bibliotheca Rerum germanicarum. Monumenta Carolina, 1867, T. IV.
11 Einhard. Vie de Charlemagne. Éd. et trad, par L. Halphen. Paris, 1947. P. 7 (Classiques de 1 "Histoire de France au Moyen Age)
REMARQUES
La traduction de la biographie de Charlemagne a été faite d'après la publication : Einhard. Vita Caroli // MGH in usum studentum. SRG édition séparée. Hannoverae et Lipsiae, 1911. La traduction anglaise de Lewis Thorpe Einhard et Notker le bègue a été utilisée pour la vérification. Deux vies de Charlemagne. Trad. avec une introduction de L. Thorp. Harmondsworth, 1972. Les crochets contiennent des mots qui sont absents du texte latin original, mais qui sont nécessaires pour se conformer aux normes stylistiques en traduction, ainsi que pour clarifier le sens.
1 L'abbaye bénédictine de Fulda a été fondée en 744 par décision de Boniface. Le premier abbé était Sturm. Waugolf, discuté ci-dessous, lui succéda à ce poste (779 - 802).
2 Cicéron, Conversations Tuskulan I, 3, 6.
3 Mérovingiens - la première dynastie des rois francs (V - Ser. VIII siècles). Le nom de genre vient du nom de Merovei (ou Meroveg) - une personnalité fictive. Selon la légende, Merovei était le fruit de l'union contre nature d'une femme avec un monstre marin. Ce conte appartient aux légendes étymologiques et est une tentative d'explication du nom « Merovei », qui signifie « né de la mer ».
4 Childéric III (743 - 755) - "roi paresseux" (voir aussi note 8), sous le règne duquel l'État était dirigé par Pépin et Carloman - les fils de Karl Martell, qui, afin de renforcer leur propre pouvoir, l'éleva au trône royal, précédemment retiré du monastère.
5 Etienne III (752 - 757), romain de naissance, fut le premier pape à se rendre au pays des Francs.
6 L'inexactitude d'Einhard. Childéric est destitué par décision du pape Zacharie (741 - 752), qui fait un choix entre le roi et le majord Pépin. - C'est au pape Zacharie que Pépin envoie des ambassadeurs qui lui posent une question : que pense-t-il des « rois qui n'ont aucun pouvoir en Frankia." Zacharie répondit : « Il vaut mieux appeler celui qui a le pouvoir que celui qui ne l'a pas », ordonnant à Pépin d'être proclamé roi. Ayant reçu le soutien du pape, Pépin est proclamé roi en novembre 751 lors de l'assemblée de tous les francs à Soissons. Étienne, qui succéda au pape Zacharie en 752, renforça encore la légalité de la dignité royale de Pépin et de ses fils en oignant le trône en 754.
7 Childéric fut envoyé au même monastère de Saint-Hérten, d'où il fut brièvement récupéré par Pépin et Carloman. En 755, Childéric meurt.
8 Il s'agit de l'ère des « rois paresseux », qui débute après le règne de Dagobert (629 - 639), puisque les rois de la dynastie mérovingienne ont perdu le pouvoir réel, ne conservant que leur titre. familles des Francs a été remplacée par une autre. Les mairies, disposant d'un pouvoir réel, régnaient sur le trône royal, arrangeaient leurs mariages, étaient chargées de percevoir les impôts et les biens royaux, et commandaient les troupes (voir aussi note 9).
9 Poste de mairie (maiordome - le directeur principal de la maison royale) a été installé par Dagobert comme le dernier roi de la famille mérovingienne qui avait un pouvoir réel. Le but d'un tel établissement était de renforcer l'autocratie du roi sur l'ensemble du pays et d'affaiblir le pouvoir des nobles familles franques. Cependant, cela a conduit au résultat inverse, puisque c'est à cette époque qu'une nouvelle famille puissante des majordomes Pipinides a émergé, qui a par la suite obtenu le titre de roi.
10 Les cheveux longs du roi sont un symbole de pouvoir, car seuls les héritiers de la maison royale étaient autorisés à lâcher les cheveux longs (comme le dieu suprême des Allemands, Odin (ou Wotan)). Par là, le clan mérovingien indiquait son origine divine. Alors que les guerriers de la tribu se coupaient les cheveux courts, les héritiers du trône portaient les cheveux longs dès l'enfance. Tous les Mérovingiens ont conservé (jusqu'à la disparition de la dynastie) ce signe de dignité royale. Sous le nom de « rois aux cheveux longs », les Mérovingiens sont entrés dans l'histoire.
11 Les rois pouvaient difficilement avoir une « barbe tombante » puisque tout le monde mourait en bas âge.
12 Apparemment, la rareté de la vie des rois paresseux est exagérée.
13 Ce cabriolet ou charrette (carpentum), comme les cheveux longs et la barbe des rois mérovingiens, était un symbole de leur grandeur royale.
14 Il s'agit du maire Pépin le Bref (741-768) - le fils de Karl Martell, qui ouvrit la période de la grande dynastie Caro-Ling (voir note 4).
15 Karl Martell (Hammer) n'était pas l'héritier légal de Pepin. Cependant, les deux descendants légitimes de la mairie sont décédés avant leur père. Au nom des petits-enfants de Pepin, sa veuve Plectruda a tenté de gouverner l'État. Avec l'aide de ses partisans, Karl força Plectruda à lui céder le pouvoir.
16 Après sa victoire à la bataille de Poitiers, Karl Martell est unanimement reconnu comme le souverain de toute la Gaule et un combattant pour le christianisme.
17 Nous parlons de Pepin Geristalsky.
18 Voici le pape Zacharie.
19 Paris.
20 Charles et Carloman sont oints roi par le pape Étienne II en 754 (voir aussi note 5).
21 Pépin le Bref partagea ses terres entre ses fils Karl et Karloman avant sa mort. Karl était mieux doté que son frère, puisqu'il possédait les terres périphériques baignées par la mer, c'est-à-dire régions du nord et de l'ouest du royaume. Ces terres « s'étendaient de l'Aquitaine atlantique à la Thuringe, en passant par la plus grande partie de la Neustrie et de l'Austrasie, de la Frise et de la Franconie. Carloman recevait des terres hétérogènes du centre et du sud-est (jusqu'à la frontière avec l'Italie et la Bavière), couvrant le territoire de Soissons à Marseille et de Toulouse à Bâle. Cependant, tous deux possédaient une partie de la Neustrie, de l'Austrasie et de l'Aquitaine, ce qui témoignait très probablement de la volonté du père de préserver l'unité du royaume. De plus, les parents aimaient moins Carloman que Carl. Peut-être Pepin en a-t-il tenu compte. non seulement l'âge des enfants (Carl avait environ 27 ans, Carloman n'en avait que 16), mais aussi des qualités personnelles, car Carl était un homme énergique, décisif et fort ; agit comme une personne irritable, querelleuse, étant une victime facile pour les flatteurs autour de lui.
22 Carloman a régné pendant trois ans (768 - 771).
23 Il est maintenant généralement admis que Charles est né le 2 avril 742 (voir aussi la note 123). Son père Pépin tenta de l'initier aux activités gouvernementales. À l'âge de onze ans, Karl a été envoyé pour rencontrer le pape Etienne II ; Dans sa jeunesse, il participa aux réunions de la cour et aux seimas généraux, et en 761-762, il accompagna son père dans les campagnes militaires.
24 Il s'agissait d'une rébellion déclenchée par Gunold, que Karl réprima sans l'aide de son frère.
25 Charles a pris une telle mesure en raison du danger d'une conspiration entre Carloman et le roi lombard Desiderius. À cet égard, Charles non seulement devint proche de son cousin, le duc de Bavière Tassilon, qui devint le gendre du roi lombard, mais il épousa lui-même la fille de Desiderius, laissant sa légitime épouse Khi-miltrude. Après la mort de son frère, Karl attira à ses côtés certains des proches alliés de Carloman et prit possession de son héritage.
26 Gascogne.
27 L'inexactitude d'Einhard. La Gascogne au cours des décennies suivantes a continué à rester indépendante de l'État franc.
28 Adrien I (772 - 795), pape issu d'une famille aristocratique influente ; poursuivit une politique cohérente d'alliance avec le roi des Francs. L'objectif d'Adrian était d'augmenter ses propres avoirs. Hadrien a demandé la protection de Charles pour la raison que Desiderius, ayant fourni un abri à la femme de Carloman et ses fils, a renouvelé son attaque sur les terres papales. Après que Charles n'a pas réussi à entrer en négociations avec Desiderius, il, décidant d'utiliser la force, s'est opposé aux Lombards.
29 Pavie.
30 En fait, Pépin envahit l'Italie à deux reprises : en 754 et 756.
31 Incapable de résister au siège commencé en février 774, Desiderius se soumet à Charles. Le roi lombard et son épouse furent emmenés en Francia, où ils furent obligés de prendre la tonsure et emprisonnés dans le monastère picard de Corby. Charles, après avoir pris possession du palais royal et de ses trésors, ajouta à son titre "Roi des Francs" suite "et des Lombards", ainsi que "Romain patricien". Cependant, le royaume lombard n'avait pas encore été liquidé par lui et inclus dans l'État franc. Aussi, l'appareil administratif des Lombards n'a pas été modifié. Ce n'est qu'après la répression de la rébellion du duc de Frioul en 776 (voir ci-dessous, note 34) que l'établissement des vassaux royaux commence sur le territoire des Lombards.
32 L'inexactitude d'Einhard. Adalgiz a fui Karl, et deux fois. La première fois, il s'enfuit à Constantinople (774) après la prise de Vérone (la deuxième ville la plus importante des Lombards après Pavie). La deuxième fois, c'était en 776 après un complot raté (voir note 34 ci-dessous).
33 La brève guerre avec Ruothgaz a eu lieu environ deux ans après la chute de Pavie, mais Einhard semble conclure que ces événements se sont succédé.
34 Les ducs de Frioul et de Spoletto, soutenus par Adalgiz, conspirent dans l'espoir de s'emparer de Rome avec l'aide de la flotte byzantine et de restaurer le pouvoir des Lombards. Karl, après avoir été averti par le pape Adrien de la conspiration, traversa à nouveau les Alpes et déjoua le plan des conspirateurs. En conséquence, le duc de Friul a été tué, les villes rebelles se sont soumises et Adalgiz a été contraint de fuir à nouveau (776).
35 Le 17 avril 781, dimanche de Pâques, le pape Adrien, à la demande de Charles, baptisa son fils de quatre ans, l'appelant Pi-pin et plaçant une couronne sur sa tête. Après cela, Charles a annoncé la décision de mettre son fils roi sur les Lombards.
36 La traversée fut en effet très difficile, car les Lombards bloquaient et fortifiaient les cols. Karl attaque les Lombards par derrière. Le roi Desiderius a été contraint de se retirer dans sa capitale, Pavie.
37 Apparemment, cette phrase est le résultat des souvenirs personnels d'Einhard, puisqu'il était en Italie, où il se rendit sur les ordres de Charles (806).
38 Essentiellement, cette guerre était une escarmouche annuelle qui exigeait des forces assez importantes de l'État franc.
39 Les Saxons étaient des païens qui adoraient les arbres des forêts, les bosquets et les sources.
40 Selon toute vraisemblance, l'esprit national de la lutte pour la liberté et leur propre foi se sont manifestés dans la résilience des Saxons. Les Saxons ont toujours rejeté le pouvoir qui leur était imposé par la force et envahi le territoire des envahisseurs eux-mêmes. Ainsi, même le père de Karl, Pepin, leur a porté un coup très tangible, puisqu'il a détruit la forteresse d'Eresburg, renversé le sanctuaire païen - l'idole Irminsul et a pris des otages. Cependant, un an plus tard, les Saxons, ayant violé la frontière, attaquèrent eux-mêmes les conquérants.
41 Elbe.
42 Charles a rencontré les Saxons pour la première fois en 772. Depuis lors, la guerre a continué avec de courtes pauses jusqu'en 804, car dès que Charles ou ses commandants ont quitté les terres de Saxe, les Saxons ont cessé d'obéir à la domination des Francs. En 775, Charles s'enfonça plus que d'habitude dans le territoire saxon, atteignit le pays des Ostphals et atteignit la rivière Okker, prit des otages et laissa de fortes garnisons à Eresburg et Sigiburg. Le printemps suivant, sous l'assaut des Saxons, Eresbourg tomba. Après cela, Charles changea de tactique, décidant de créer une « ligne fortifiée » (marque), censée protéger les Francs des invasions des Saxons. En 776, après avoir de nouveau fortifié Eresburg et Sigiburg, il construisit une nouvelle forteresse de Karlsburg et laissa des prêtres dans la zone frontalière pour la conversion des Saxons païens au christianisme, ce qui au début se passa avec succès. En 778, une rébellion éclate à nouveau sous la houlette du chef de la noblesse westphalienne, Vidukind. Sous sa direction, les Saxons ont franchi la frontière du Rhin et ont atteint Coblence, pillant toutes les terres en cours de route, et avec beaucoup de butin sont revenus presque sans obstacles. Une seule fois, un détachement franc rattrapa les Saxons à Leysa et infligea des dommages mineurs à leur arrière-garde. La campagne suivante en 780 a été préparée par Charles avec plus de soin. Avec son armée et ses prêtres, Karl réussit à avancer jusqu'à l'Elbe - la frontière entre les Saxons et les Slaves. À cette époque, Charles avait déjà un plan stratégique, qui se résumait à la conquête de toute la Saxe par la christianisation. Dans cette entreprise, Charles a été grandement aidé par l'anglo-saxon Villegad, docteur en théologie, qui a commencé à implanter activement une nouvelle foi. Le succès était également assuré par le fait qu'afin de pacifier les Slaves sorabes qui attaquaient les frontières de la Saxe et de la Thuringe, Charles envoya une armée, qui comprenait les Saxons fidèles à Charles. Cependant, Karl a de nouveau échoué parce qu'il n'a pas tenu compte de l'engagement des Saxons envers leur propre foi. Vidukind, arrivé du Danemark, et ses complices se sont révoltés, annulant toutes les réalisations de Karl. Les Saxons, qui ont adopté la nouvelle foi, ont été détruits, les églises chrétiennes ont été détruites. Dans le même temps, le mécontentement vis-à-vis des innovations de Charles en Frise augmentait. L'armée de Charles, envoyée pour apaiser les rebelles rebelles, près de la Weser, près du mont Zuntal, est défaite. En réponse, Karl rassembla une armée, se rendit à Verdun et força les anciens saxons à livrer les coupables. Vidukind a réussi à s'échapper, mais les 4 500 personnes nommées ont été amenées à Verdun le même jour et exécutées. Au cours des trois années suivantes (783 - 785), Karl mena des batailles ouvertes en Saxe, des raids punitifs, prit des centaines d'otages et détruisit des colonies. Hiver 784 - 785, contrairement aux hivers précédents, qui étaient un temps de repos pour Karl ; a également été passé par lui en Saxe, à Eresbourg, où il a déménagé avec sa famille. A Berngau, il entame avec Vidukind des négociations qu'il achève avec succès, puisque Vidukind, après avoir reçu les garanties et les otages promis, arrive à Attigny et se fait baptiser, Karl étant son parrain. Après cela, la victoire de Charles est devenue évidente et dans les annales de 785, il a été enregistré que le roi des Francs « soumettait toute la Saxe ». En outre, un capitulaire a été publié par Karl. Régions de Saxe (De partibus Saxoniae), selon lequel il était ordonné de punir de mort tout écart par rapport à la loyauté envers le roi et toute violation de l'ordre. Cependant, en 793, un soulèvement éclata à nouveau, qui couvrit non seulement la Saxe, mais aussi d'autres territoires dans lesquels vivaient les Frisons, les Avars et les Slaves. De 794 à 799 il y eut encore une guerre, qui était déjà de nature destructrice, accompagnée d'otages et de prisonniers de guerre massifs, avec leur réinstallation ultérieure comme serfs dans les régions internes de l'État. La résistance des Saxons se poursuit avec une grande amertume (surtout avec obstination à Wihmodia et Nordalbingia). Voulant remporter la victoire sur eux, Charles conclut une alliance avec les Slaves-acclamations, ennemis des Saxons, et passa à nouveau l'hiver 798-799 avec sa famille. en Saxe, à Weeser, où il établit un camp, et en fait construit une nouvelle ville avec des maisons et des palais, en nommant ce lieu Herstel (Heerstelle - camp militaire). Au printemps, quittant Herstel, il s'approche de Minden et dévaste toute la zone entre la Weser et l'Elbe, tandis que ses alliés sont encouragés à combattre avec succès en Nordalbingia, ce qui permet de décider de l'issue de la lutte en faveur de Karl (voir aussi remarque 56). En 799, il y eut une autre campagne de Charles en Saxe avec ses fils, dans laquelle le roi lui-même ne montra aucune activité.
43 En 797, Charles publia un décret abolissant la terreur antérieure et introduisit l'égalité des Saxons et du peuple franc.
44 Ce n'est pas vrai. Charles a personnellement dirigé la plupart des campagnes contre les Saxons (voir note 42 ci-dessus).
45 La raison de la guerre avec l'Espagne était pour Charles l'ambassade du souverain de Saragosse, qui en 777 se tourna vers les Francs pour l'aider dans la lutte contre l'émir omeyyade de Cordoue. En 778 Charles, à la tête d'une armée nombreuse, franchit les Pyrénées, mais au retour échoue à Saragosse, dans les gorges du Ronseval (voir note 46 ci-dessous).
46 Cette bataille, qui eut lieu le 15 août 778, s'appelle Ronseval. Einhard ne donne pas ce nom, mais souligne que seul arrière-garde du convoi [francs] et ceux qui marchaient à la toute fin du détachementétaient cassés. Dans la version originale Annales du royaume des Francs, compilé en 788 - 793, dans les événements relatifs à 778, il n'y a aucune mention de cette bataille du tout. Il est seulement dit qu'« après la remise des otages d'Ibn Al-Arabi, d'Abutariya et de nombreux Sarrasins, [après] la destruction de Pampelune, la conquête des Basques et des Navarrais, [Karl] est retourné sur le territoire de Frankia. " La version révisée Annales, rédigé peu après la mort de Charles, il n'est pas non plus fait mention de cette bataille. Mais il y a un nouveau passage important : « De retour [Karl] a décidé de passer par la gorge des Pyrénées. Les Basques, tendant une embuscade tout en haut de cette gorge, ont causé une grande confusion dans toute l'armée de [Karl]. Et bien que les Francs étaient plus nombreux que les Basques en armes et en courage, la supériorité a été vaincue en raison de l'inégalité de l'endroit et de l'impossibilité [pour les Francs de mener] la bataille. Dans cette bataille, beaucoup de l'entourage, qui le roi mis à la tête de [son armée], furent tués, le train fut pillé ; l'ennemi, grâce à la connaissance du terrain, se dispersa aussitôt dans différentes directions. » Einhard, cependant, dans son ouvrage (c'est la troisième description de la bataille de Ronseval) apporte deux changements principaux. Il remplace "toutes les troupes" de la version réécrite Annales du royaume franc sur « ceux qui marchaient à la toute fin du détachement » et ne cite que trois des nobles Francs tombés au combat (Eggihard, Anselme et Rouotland). La date exacte de la bataille - le 15 août - est connue grâce à l'épitaphe d'Eggihard, l'intendant de Charles (MGH, Poetae Carolini Aevi, Moi, 109 : " elle eu lieu le dix-huitième jour des calendriers de septembre "). Vingt ans plus tard, tout en décrivant les mêmes événements, un scribe inconnu Annales insère un message dont il n'est pas fait mention dans les premiers textes. Apparemment, attirer l'attention sur cet événement était important pour lui. Très probablement, tous les détails ont été tirés par lui de textes ultérieurs. Il dit que toute l'armée franque est entrée dans la bataille et affirme que de nombreux dirigeants francs ont été tués.
47 C'est-à-dire que Roland (préfet de la marque bretonne) est le héros de la célèbre épopée française Chanson de Roland.
48 À propos de cet événement, les Basques, qui s'appelaient eux-mêmes Escalduna-kami, composèrent par la suite une chanson : : qui vient, qu'est-ce que cela veut dire ?.. C'est un bruit sourd de l'armée qui s'approche [Karl]. La nôtre lui a répondu du haut des montagnes, ils ont soufflé du cor, le Basque aiguise ses flèches... Joignons-nous nos mains nerveuses, arrachent ces rochers, roulent-les du haut des montagnes sur la tête. . Mais les rochers, en dévalant, tombent; ils écrasent l'armée, le sang coule, les corps tremblent. Oh, que d'os sont écrasés! mer de sang! .. Le roi Karl galope dans une grande anxiété ... Courez, courons ! Et maintenant, escaldunks, laissons les rochers ; dépêche-nous, lançons des flèches derrière ceux qui courent. Ils courent, ils courent ! Où est la forêt de lances ? Où sont ces bannières multicolores qui soufflent au milieu Leurs armes, tachées de sang, ne brillent plus... cheno... Highlander, tu peux maintenant rentrer... serrer dans tes bras ta femme et tes petits, les cacher avec ta corne... La nuit les aigles voleront pour picorer les corps écrasés, tous ces os deviendront blancs à jamais " (Cité. Cité de : T.N. Granovsky Conférences sur l'histoire du Moyen Âge. M., 1986.S. 298.).
49 La défaite des gorges du Ronseval n'empêche pas Charles de faire la guerre. Déjà en 781, l'Aquitaine devint un royaume à part entière, dirigé par le plus jeune fils de Charles Louis. Dans les années 90, le nouveau roi Louis a entrepris des campagnes à court terme pour les Pyrénées, à la suite desquelles une frontière fortifiée de la Marque espagnole est apparue, constituée d'une zone frontalière fortifiée avec les villes de Gérone, Urhel et Vic. En 801, la ville arabe de Barcelone est prise, qui devient le principal centre de la marque espagnole, puis, en 806, la subordination de Pampelune.
50 Charles envahit à plusieurs reprises la Bretagne, le pays de la tribu celtique des Bretons (Bretons), leur imposant un tribut. Apparemment, Einhard parle ici de la victoire à court terme d'Audulf, réalisée par lui en 786. En 799, Karl organisa à nouveau une expédition, qui permit d'établir la paix dans ce territoire pendant plusieurs années. En 800, les chefs des Bretons prêtent serment d'allégeance à Charles à Tours. Cependant, ce pays ne s'est pas soumis à la fin, préservant ses propres coutumes et coutumes religieuses. En 811, les Britanniques se révoltent à nouveau.
51 La guerre avec Benevent est présentée par Einhard d'une manière extrêmement simplifiée, et il essaie de tout réduire à la peur d'Aragis pour Karl. En réalité, la guerre fut longue : les Benevente se révoltèrent constamment et les Francs durent à nouveau faire des campagnes punitives dans leur pays. La raison de cette guerre était l'intention d'Aragis, le duc bienveillant, un participant secret à la conspiration de 774 - 776, de devenir le successeur du roi lombard Desiderius, d'autant plus que sa femme était la fille du roi déchu. Charles, qui connaissait les plans de son rival du pape Hadrien, a décidé de soumettre les restes du royaume de Desideria. Aragis, qui n'a pas reçu le soutien opportun des alliés, a envoyé son fils aîné Rumold à Karl en otage avec de riches cadeaux afin d'arrêter l'attaque de Karl sur son territoire. Karl, ayant pris un otage, franchit néanmoins la frontière et arriva à Capoue. Aragis, se retirant à Salerne, envoya Charles en otages son deuxième fils Grimold et douze nobles Lombards, promettant une obéissance complète. Karl, ayant donné son accord, relâcha le fils aîné du duc à Bénévent, envoyant avec lui ses délégués prêter le serment d'Aragis et de son peuple, moyennant le paiement d'un tribut annuel. Cependant, dès que Charles a quitté l'Italie, Aragis a rompu son serment et a fait une alliance avec Byzance pour mener de nouvelles hostilités contre Charles. (En même temps, Adalgiz, le fils de Desiderius, se rendit avec son armée à Trévise et à Ravenne pour soumettre le nord du pays.) Toutes les réalisations militaires de Charles étaient menacées. Mais le 26 août 787, Aragis décède de manière inattendue, et son fils Rumold décède un mois avant cela, ce qui conduit à l'échec de l'accord byzantin-Bénévent, d'autant plus que le deuxième fils d'Aragis, Grimold, est toujours retenu en otage par Charles.
52 Adalgiz, le fils de Desiderius, après la mort de ses partisans, tenta de poursuivre les actions commencées contre Charles, prenant contact avec Ataberga, la veuve d'Aragis, et lançant une attaque contre les possessions papales. En réponse, Karl, malgré les appels à l'aide du pape, à savoir retourner en Italie et continuer à tenir Grimold en otage, fit le contraire. Il n'est pas allé en Italie et a libéré Grimold. Par la suite, cette action a aidé Charles, car lorsque la guerre avec Byzance a commencé, Grimold a soutenu l'armée franque, ce qui a conduit Charles à la victoire, à la suite de laquelle il a pris possession de l'Istrie.
53 Einhard appelle les Avars Huns.
54 En réalité, il n'y a pas eu de guerre bavaroise. Charles, depuis qu'il était au courant par le pape de la conspiration de Tassilon, qui avait conclu une alliance avec les Avars, a soumis la Bavière par des négociations diplomatiques (soutenues par des actions militaires), au cours desquelles une situation désespérée s'est produite pour Tassilon, l'obligeant à se soumettre . Tassilon a été contraint de comparaître devant le roi franc et de lui prêter un second serment d'allégeance. (Auparavant, il avait déjà prêté un tel serment, mais il a été rompu par lui.) Un an plus tard, à la Diète générale d'Ingelheim, Tassilon a été contraint d'avouer avoir tissé des intrigues avec sa femme et condamné à mort, que Karl a remplacé par emprisonnement dans un monastère. Le même sort était réservé à sa femme et à ses enfants. Après avoir aboli le pouvoir ducal, Charles céda la Bavière à ses comtes, annexant en même temps les régions slaves du sud de la Carantanie et de la Krajna à son territoire. Mais avant d'entreprendre une pleine occupation, le roi franc expulsa une grande partie de la noblesse bavaroise. Apparemment, Charles a eu des difficultés dans le processus d'assujettissement complet du pays, car six ans plus tard (en juin 794), lors du Sejm général à Francfort, Tassilon a été libéré du monastère pendant une courte période et emmené en ville pour une seconde renoncement à ses prétentions au pouvoir. ...
55 Cette tribu, constamment en guerre avec ses voisins, parmi lesquels ils étaient encouragés, était célèbre pour sa férocité et son caractère belliqueux.
56 Nous parlons des acclamations, les alliés de Charles dans la guerre avec les Saxons (voir note 42).
57 Ce n'était guère la vraie raison de la guerre. De Code Vatican IX v. on sait que les Wiltsy ont toujours été hostiles aux Francs et à leurs voisins alliés. « Ayant décidé que l'insolence [des Wilts] ne devait plus être endurée, le roi décida de leur faire la guerre et, équipant une énorme armée,., de passage en Saxe,., envahissant le pays des Viltsy, ordonna de dévaster tout par le feu et l'épée » (traduction de V. Ronin). Probablement, en déclenchant cette guerre, Charles a poursuivi l'objectif de renforcer et d'assurer la sécurité des frontières nord-est de son propre État.
58 Baltique, environ 850-900 milles de long et 100-200 milles de large.
59 Il n'y a pas eu de réelle soumission des vélatabats au pouvoir de Karl. Au contraire, cette campagne peut être considérée comme une mesure militaire importante pour renforcer les propres positions du roi franc sur la rive gauche de la Saxe et pour se protéger temporairement des raids ennemis. V Annales de la Moselle(entrée 788) il est dit que la campagne s'est terminée "sans aucune bataille sérieuse" (traduit par VK Ronin).
60 L'identification des Avars et des Huns est caractéristique non seulement d'Einhard, mais aussi de toute la littérature médiévale. voir également Les Chroniques de Fredegar (fuit. II, 57 ; III, 55, 65 ; IV, 72). Apparemment, cela était dû à la similitude des coutumes et des mœurs entre les Huns et les Avars. Les Avars désignent généralement les tribus d'Asie centrale d'origines diverses, unies sous le règne d'un seul chef, qui sont apparues en Pannonie dans la seconde moitié du VIe siècle et y ont créé un pouvoir politique, dirigé par le kagan (ou khagan). Ce peuple menait un mode de vie nomade, professait le paganisme et combattait exclusivement à cheval. Le centre des colonies avares était un camp fortifié appelé Ring (ou Hring, de l'allemand ring, ring), entouré de plusieurs anneaux de fortifications, très probablement en bois, entre lesquels se trouvaient des jardins et des bâtiments. Il y avait aussi la résidence du souverain suprême du kagan et l'or capturé par les Avars dans les guerres ou reçu en cadeau était conservé. Cette tribu, comme les Huns, est soudainement apparue sur leurs petits chevaux trapus dans des territoires étrangers, a saisi tout ce qui se présentait à eux, en particulier les décorations d'église, les trésors et les reliques, et, après avoir capturé la proie, a tout aussi soudainement disparu.
61 La guerre contre les Avars dura de 791 à 803. Les Avars étaient alliés au Tassilon (voir note 54). En lui promettant d'envahir les Francs en 788, ils remplissent leur obligation (ignorant le renversement du Tassilon) en déclenchant une guerre contre Charles. Cette guerre s'est poursuivie avec plus ou moins de succès. Le roi franc avait besoin de mobiliser toutes ses forces et de conclure une alliance avec les Slaves du sud (comme auparavant dans la guerre avec les Saxons) pour résister aux nomades. Annales du Royaume des Francs(entrée 796) c'est ainsi qu'est décrit l'un des événements les plus importants de cette guerre : « Heirik, le duc de Frioul, ayant envoyé son peuple avec le Slave Wonomir en Pannonie, pilla l'anneau de la tribu Avar qui resta calme pendant un longtemps (puisque [leurs] dirigeants, les Khagan et les Yugur, ont épuisé la guerre civile, [conduits] entre eux, ont été condamnés [à mort] et tués par les leurs) et ont envoyé les trésors collectés au cours des siècles par les anciens dirigeants à Le roi Charles au palais d'Aix-la-Chapelle "(traduit par VK Ronin tel que modifié) ...
62 Heirik est le souverain de la marque frioulane, créée en 776, après la soumission définitive du duché frioul des Lombards au pouvoir du roi franc. Sa mort (799) n'est pas liée à la guerre contre les Avars.
63 Cette guerre n'a pas été couronnée de succès car en 811 les Lynon se sont à nouveau rebellés.
64 Einhard semble ajouter l'Aquitaine pour rendre les réalisations de Charles plus impressionnantes.
65 Èbre.
66 Charles n'a pas reçu Dertos et son empire ne s'est pas étendu jusqu'à l'Èbre.
67 Einhard exagère en ajoutant la Calabre à l'empire de Charles.
68 Apparemment, Einhard parle de deux Pannonie, la Haute et la Basse. Cette division remonte au IIe siècle après JC. NS. Puis ces parties, déjà sous le règne de l'empereur Dioclétien (284 - 305), commencèrent à porter d'autres noms : la Haute Pannonie s'appelait la Première ou Savia, la Basse Seconde ou Valeria. La mention par Einhard des deux Pannonias est un hommage à la tradition.
69 À la suite des actions militaires de Charles, son état n'était que légèrement inférieur en taille à l'ancien Empire romain d'Occident, car Charles a conquis l'Italie, la Saxe, la Bavière, la Bretagne, l'Aquitaine, le nord de l'Espagne et les régions frontalières du sud-est.
70 Les lettres mentionnées par Einhard n'existent pas. Il est peu probable que l'auteur lui-même les ait vues.
71 Einhard fait plus probablement référence à Ardulf, roi de Northumbrie, qu'aux Irlandais, qu'il appelle « rois écossais ». D'un autre côté, Karl, bien sûr, pourrait avoir des relations diplomatiques avec les Irlandais.
72 Il n'y a pas non plus de telles lettres.
73 Harun al-Rashid, calife de Bagdad (786-809).
74 Karl envoya un ambassadeur au tombeau sacré et au lieu de la résurrection du Seigneur en 799. En novembre 800, l'ambassadeur revint et apporta les clés de ce sanctuaire, mais pas de Harun al-Rashid (Aaron), comme le dit Einhard, mais du patriarche de Jérusalem, et non comme soumission à l'autorité de Charles, mais comme signe de respect.
75 Parmi les cadeaux de Harun al-Rashid, envoyés par les ambassadeurs en 807, se trouvaient une horloge à eau, des candélabres, une tente, qui n'ont pas été mentionnés par Einhard.
76 Il est peu probable qu'il s'agisse du seul éléphant en possession du calife de Bagdad.
77 En 797, Charles envoya des ambassadeurs auprès du calife de Bagdad pour apporter un éléphant. Cinq ans plus tard (20 juillet 802), l'éléphant fut livré à Karl. Cet événement a été reflété dans la chronique, le nom de l'éléphant a été conservé - Abu-l-Abbas. L'éléphant a vécu à la cour franque pendant environ neuf ans. Karl, pendant les campagnes, emmenait l'éléphant avec lui avec les enfants et les serviteurs. Cela a continué jusqu'à ce que l'éléphant meure au cours d'une des campagnes de Charles au nord de la Saxe. Cet événement était considéré par les contemporains comme l'un des principaux événements tristes de l'année, puisque l'enregistrement suivant a été conservé dans les annales : « La même année, lorsque l'éléphant mourut, le roi d'Italie, Pépin, mourut également.
78 En fait, en ce qui concerne la reconnaissance du titre impérial de Charles à Byzance, les événements se sont déroulés un peu différemment. A cette époque à Byzance, l'impératrice Irina était au pouvoir, qui, dans la lutte pour le trône, aveugla en 797 son propre fils (Constantine IV) et avec qui Charles négociait. Avec la bénédiction du pape, Karl a envoyé des ambassades à Irina, proposant un mariage qui permettrait à Karl d'unir l'Occident et l'Orient sous son règne. Cependant, le projet de Charles sur le mariage dynastique a été rejeté par les sénateurs de Constantinople. Le 31 octobre 802, un coup d'État a lieu à Constantinople, Irina est destituée, Nicéphore I (802 - 811) monte sur le trône, qui refuse de reconnaître Charles comme empereur. En réponse, Karl, après une guerre assez longue (806 - 810), s'empara de Venise et de la Dalmatie, qui appartenaient nominalement à Byzance, mais étaient affaiblies en raison de conflits internes et, grâce à une alliance avec le calife de Bagdad Aaron, força Nicéphore, qui menait une guerre en Bulgarie, aller à des pourparlers de paix en 810. 12 ans après le début du conflit, l'empereur byzantin Michel Ier (811 - 813), successeur de Nicéphore mort en Bulgarie, reconnut formellement le nouveau titre d'empereur, comptant sur le soutien de l'Occident dans la lutte contre la Bulgarie, qui a vaincu l'armée byzantine en 811. Pour la reconnaissance de son titre impérial, Charles céda Venise et la Dalmatie à Michel Ier. scott, dumbass, matelas (scottus, sottus, cottus). Voir : MGH, Poète. parcelle. Moi, 492, 63.
96 Une grande partie des détails de ce chapitre et de ceux qui suivent sont tirés de La vie des douze Césars Suétone, qui parle d'Auguste (II, 68-93), de Tibère (III, 68-71), de Claude (V, 30-42), de Néron (VI, 51-52).
97 Pierre de Pise, grammaire et poète italien (VIII-début IXe siècles), est à la cour de Charles à partir de 783.
98 Alcuin, Flaccus Albinus, anglo-saxon de naissance, érudit et professeur, puis abbé de Tours.
99 Il est à noter que la culture de la cour carolingienne diffère peu de la culture des rois barbares. Karl lui-même ne savait que lire, ce qui n'était pas une mince affaire, mais pas écrire, mais il s'amusait volontiers avec de grandes lettres faites pour lui, qu'il devinait en tâtonnant.
100 Ce bâtiment, situé à l'intérieur du palais, était un modèle inaccessible pour les architectes de l'époque suivante. Très probablement, les architectes de Charles, avant de construire l'ensemble du palais, ont soigneusement étudié les premiers bâtiments de Rome, Ravenne, Milan, Thiers. Il est possible que l'idée d'une église-palais repose sur le principe de construction de l'époque de l'empereur Justin (565 - 578).
101 Il y a une lettre (Codex Carolinus, 67, MGH, Epistolae Merovingici et Karolini Aevi, I, 614) du pape Adrien I, dans lequel il permet à Charles de transporter du marbre et des mosaïques du palais de Ravenne pour une construction à Aix-la-Chapelle.
102 Il n'y avait alors que la messe du matin.
103 Charles a visité Rome en 774 - pendant le siège de Pavie, à l'invitation du pape Adrien Ier; en 781 - lors du couronnement de ses fils Pépin et Louis comme rois des Lombards et des Aquitains ; en 787 à Pâques et en 800 le jour de Noël, lorsque le pape Léon III le proclama empereur.
104 Léon III (795 - 816), romain de naissance. Dès son élection, il ressentit un net dédain de la part de l'aristocratie romaine. Après son élection au trône papal, il envoya à Charles les clés de Saint-Pétersbourg. Pierre et la bannière papale en reconnaissance de son autorité. Quatre ans après le début du règne de Léon III, une rébellion éclate à Rome contre le pape et les partisans de sa politique pro-franque. Le 25 avril 799, lors d'une procession religieuse, des conspirateurs armés ont kidnappé le pape et l'ont emprisonné à Saint-Pétersbourg. Sylvester, où les bourreaux ont reçu l'ordre de l'aveugler et de lui arracher la langue. Cependant, aidé d'amis, Léon III s'enfuit et se réfugie à Rome, puis à Spoletto et Paderborn (Westphalie), où se trouvait Charlemagne et où, semble-t-il, un accord fut trouvé sur la promotion de Charles au poste de chef de L'empire. Sous la protection des troupes royales, Léon III rentre à Rome. Karl l'y suivit et exigea que le pape se purifie des accusations de débauche et de violation des serments qui lui étaient reprochées. Le 23 décembre 800, le Pape jura solennellement dans l'Évangile qu'il était innocent. Deux jours plus tard, le jour de Noël, lors d'un service divin à la cathédrale du Vatican, le pape plaça la couronne impériale sur la tête de Charles, et les foules assemblées le proclamèrent empereur et Auguste. Les premières vies de Charlemagne par Einhard et le moine de Saint-Gall, 1907, p. 169) dit que la visite de l'empereur Otton III au tombeau de Charles en 1000 est décrite dans Chronique de Novaliciense III, 32 : « Après de nombreuses années [après la mort de Charles], l'empereur Otton III était à l'endroit même où Charlemagne a été enterré. Il est descendu au tombeau avec deux prêtres et Otto - le comte Lomello. L'empereur lui-même a fermé Le comte décrit les événements comme suit : « Nous sommes allés chez Karl. Il ne mentait pas, comme les cadavres mentent habituellement, mais s'asseyait comme s'il était vivant, couronné d'une couronne d'or. Dans ses mains, il tenait un sceptre, ses mains étaient dans des gants, à travers lesquels des ongles poussaient. Lui-même était dans une niche construite en calcaire et en marbre. Lorsque nous nous sommes approchés du lieu de sépulture, nous y avons fait un trou et sommes entrés, réalisant le danger de la forte odeur. Nous sommes immédiatement tombés à genoux et nous nous sommes inclinés devant lui. L'empereur Otton le couvrit d'une robe blanche, lui coupa les ongles et restaura ce qui manquait à son apparence. La fumée n'a pas encore touché des parties de son corps. Il manquait peu au bout de son nez. Otto a restauré l'or manquant. Puis il sortit une seule dent de sa bouche et, ayant posé une niche, retira "(traduit de l'anglais) Annales du royaume des Francs (enregistrées 817).
146 Un tel nom au début du IXe siècle. porté par le comte de Paris.
147 Ce nom est mentionné dans Annales du Royaume des Francs(dossiers 807-811).
148 Meginhard est mentionné comme l'un des comtes envoyés par Charles au roi danois en 810.
149 Rigvin, peut-être Rikon - Comte de Padoue, mentionné dans Annales du Royaume des Francs(entrée 814).
150 Edon, peut-être le comte de Vodo, qui accompagna Meginhart dans sa mission en 810.
151 Peut-être Bera, comte de Barcelone, c. 813 avant JC



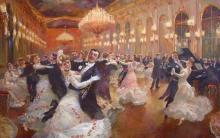


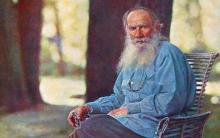




Caractéristiques orageuses de l'image du sanglier marfa Ignatievna
L'histoire de la création de "L'épopée de Gilgamesh"
Pourquoi la légende d'Icare est-elle interprétée d'une manière complètement différente du mythe grec antique ?
Héros de la mythologie grecque
Noms de la mythologie grecque antique